Mis en ligne le 29 octobre 2007
Paris IV, Deug, 2000
PLATON
Hippias Majeur
Introduction
Platon a consacré deux grands dialogues à chacun des deux fondateurs de la tradition sophistique dans la Grèce ancienne : le Protagoras, ou « Les Sophistes » (dans lequel on entrevoit Hippias d’Élis, 337 sq) et le Gorgias, « Sur la rhétorique ». Dans ces dialogues, il parle avec considération de ces penseurs, attribuant à Protagoras un magnifique discours sur l’origine des cités, et refusant de rendre Gorgias responsable de la perversion de la rhétorique, devenue entre les mains de ses élèves, Polos et surtout Calliclès, une arme pour la conquête du pouvoir. Hippias d’Élis, né sans doute autour de 450 et mort très âgé en 343, sera, bien que plus âgé que Platon (qui meurt en 348), l’un de ses contemporains. Il est donc un sophiste tardif et se réclame de cette école à l’époque où Platon fonde l’idée même de philosophie. C’est peut-être cette proximité qui conduira Platon à lui accorder non pas un, mais deux dialogues : l’Hippias Mineur, où l’on trouve un portrait satirique particulièrement savoureux du sophiste, et l’Hippias Majeur dont le sous-titre (attribué, comme tous les sous-titres, par les scoliastes alexandrins) est : « Sur le Beau ». On remarquera que ces deux dialogues portent sur des questions que nous qualifierions aujourd’hui « esthétiques » : si l’Hippias Majeur est composé comme une suite d’apories sur l’impossible définition de la beauté, l’Hippias Mineur est un exercice de critique littéraire. Hippias vient en effet de prononcer une conférence sur la supériorité d’Achille, le héros toujours courageux et sincère de l’Iliade, sur Ulysse, le héros ingénieux et menteur de l’Odyssée. Même si l’Hippias Mineur est ainsi nommé « mineur » en raison, non seulement de son infériorité supposée par rapport à l’Hippias Majeur, mais encore en raison, selon certains, de la paternité douteuse de Platon (pourtant confirmée par Aristote et Alexandre d’Aphrodise) (1), il reste que, dans le corpus généralement admis, Hippias d’Élis se voit consacrer à lui tout seul deux dialogues de Platon. Paradoxalement, nous connaissons beaucoup moins bien ce personnage que celui des autres sophistes : le portrait qu’en trace Platon est si caricatural et satirique, qu’on ne peut guère considérer cette charge comme un témoignage historique. Les critiques que Platon a adressées aux sophistes ont largement contribué à discréditer leur pensée, et ce n’est que depuis une date relativement récente (une cinquantaine d’années) qu’on s’est efforcé de reconstituer leur sagesse, sans a priori et en utilisant les rares fragments qui nous sont parvenus. Parmi les sophistes, Hippias est un de ceux qui a été le plus malmené par Platon, à tel point qu’un des pionniers dans l’entreprise de restauration de la tradition sophistique, Eugène Dupréel (auteur en 1948 de l’ouvrage fondamental Les Sophistes ; Protagoras, Gorgias, Prodicus, Hippias, éd. du Griffon à Neuchâtel) a tenté de retrouver la pensée d’Hippias, et a ainsi reconstruit une sagesse impressionnante, encyclopédique et universaliste, dont Platon ne nous donne qu’une image très déformée.
Aux yeux de Platon, Hippias le sophiste est en premier lieu d’une incroyable vanité : homme de spectacle, qui se produit en spectacle grâce à ses dons oratoires, il savoure les applaudissement du public et reste persuadé que tous l’admirent. Aussi sa vanité ne va-t-elle pas sans une certaine naïveté qui le fait tomber dans tous les panneaux que lui tend Socrate, alors que l’argumentation retorse et dissimulée de Socrate, qui semble en dire beaucoup moins que ce qu’il sait en vérité (Hippias au contraire ne se fait pas prier pour faire étalage de son savoir) peut sembler par comparaison trop laborieusement calculée. L’opposition posée par Hippias entre la sincérité courageuse d’Achille et la sournoiserie d’Ulysse (dans l’Hippias Mineur) se retrouve ici avec Hippias lui-même qui joue en quelque sorte le rôle d’Achille et Socrate celui d’Ulysse. Aussi n’est-il pas interdit de juger, comme le fera Nietzsche, le naïf contentement de soi du sophiste plus sympathique que l’esprit tortueux de Socrate. Hippias n’assume-t-il pas la responsabilité de ses thèses avec franchise, tout de même qu’il reconnaît avec honnêteté la logique des enchaînements que lui impose Socrate, tandis que Socrate ne prend pas la parole en son nom propre, mais au nom d’un interlocuteur anonyme qui aurait interrogé Socrate lui-même sur l’essence de la beauté (286 cd) ? Il est vrai que cet interlocuteur tend, au cours du dialogue, à se confondre avec Socrate lui-même, puisqu’il avoue en 298 bc que c’est bien « Socrate, fils de Sophronisque » devant lequel lui, Socrate, « rougirait de déraisonner. » Aussi peut-on dire qu’au caractère entier d’Hippias s’oppose la personnalité complexe puisque dédoublée de Socrate. C’est que le sophiste est un homme de l’apparence, la vérité n’étant à ses yeux que la vraisemblance, c'est-à-dire l’apparence de la vérité. Hippias n’existe que par la bonne image que lui renvoie son public enthousiasmé par ses beaux discours. Aucun doute ne vient effleurer en son esprit la jouissance de l’acteur qui sourit aux applaudissements. Hippias, qui ne se connaît lui-même que par l’apparence qu’il donne, ce qu’on nomme aujourd’hui son « image », est un homme extraverti ; Socrate est au contraire introverti, et s’adresse autant qu’à son interlocuteur, à cet autre qui lui est intérieur, qu’il ne nomme pas encore dans ce dialogue (qui fait partie des premiers rédigés) son « démon », mais qui est la voix jamais satisfaite de la raison, qui ne saurait se contenter des apparences. Avec le personnage philosophique de Socrate, ce que Platon médite, c’est l’éveil de la conscience de soi qui scinde l’unité naïve de la personnalité par le dédoublement en miroir de l'esprit devenu conscient de lui-même par l'acte de la réflexion. « L’Autre », cet interlocuteur déraisonnable et grossier qui ne se lasse pas de traquer la vérité et ne saurait se satisfaire de la conformité à l’opinion commune, cet « Autre » qui n'est que la voix de Socrate ventriloque, est en nous-mêmes, et ce qu’on appelle penser consiste précisément dans l’écoute de cette voix. En ce sens Socrate, dont l’esprit inquiet dialogue avec lui-même, est moderne ; Hippias appartient au contraire à des temps plus anciens où la mise en abîme de la conscience de soi n’avait pas encore entamé la confiance accordée aux apparences.
La question de la beauté, qui est au cœur de ce dialogue, recoupe cette problématique : quelle valeur accorder à l’apparence? La beauté apparente est-elle le signe d’une bonté réelle, comme les Grecs qui avaient coutume de lier les deux notions de kalos et d’agathos, l’ont longtemps cru ? A ce titre, Socrate, dont la laideur était légendaire et à laquelle Platon octroie une véritable dimension philosophique (Banquet, portrait de Socrate par Alcibiade), serait nécessairement mauvais et faux. En 294 a, Socrate évoque « une beauté plus apparente que réelle, qui est donc une tromperie (apatê) sur la beauté » : il suggère ainsi un divorce entre l’apparence et la vérité, dont l’éventualité semble n’avoir jamais inquiété Hippias. Il est vrai que la vérité selon Hippias peut difficilement entrer en conflit avec les apparences, puisqu’il prend soin de conformer son discours aux désirs de ses auditeurs. C’est ainsi que, devant les Spartiates (un peuple dont Platon admire l’austérité des mœurs et la constitution aristocratique), Hippias a le bon goût de ne parler ni d’astronomie, ni de géométrie, ni d’arithmétique, ni de la science du discours (« la valeur des lettres, des syllabes, des rythmes et des modes »), mais de la généalogie des héros et des récits relatifs à la fondation des cités (285 b-e). Hippias savourant les plaisirs et les applaudissements que son discours soulève est donc moins content de lui-même que de l’image des autres, son public, qui vient se réfléchir en lui. Voué à la seule extériorité, Hippias semble ainsi un miroir plutôt qu’un homme, tant il semble dépourvu d’opinion propre. C’est ainsi que dans Les Mémorables de Xénophon (IV, IV, 5-7) Socrate oppose sa constance à la versatilité d’Hippias : « Non content de dire toujours la même chose, c’est toujours sur les mêmes questions que je parle. Toi, évidemment, étant donné ton savoir universel, tu ne dis jamais les mêmes choses sur les mêmes questions. » Cette caricature du sophiste, qui n’existe que par l’approbation de ses admirateurs, ne correspond évidemment pas à la réalité. Aussi convient-il de présenter plus précisément le personnage historique d’Hippias.
Il est né à Élis, dans une cité qui se trouve au nord-ouest du Péloponnèse, ce qui le différence de la presque totalité des sophistes qui proviennent soit de la Grande Grèce (Italie du sud), soit de l’Ionie (les côtes égéennes de l’actuelle Turquie). C’est peut-être la raison pour laquelle il conduira de nombreuses ambassades à Olympie ainsi qu’à Sparte. On lui attribue un savoir encyclopédique, rendu possible par une technique d’apprentissage, sur laquelle nous avons fort peu de renseignements, qu’on nomme to mnêmonikon, la mnémotechnique : elle permet à Hippias, comme il est dit ici en 285 e, de réciter une liste de cinquante noms qu’il n’a pourtant entendue qu’une seule fois. Hippias, selon divers témoignages, était capable d’enseigner l’astronomie, la géométrie, l’arithmétique, la grammaire, l’eurythmie, la musique, la généalogie, la mythologie et l’histoire. Il prétendait non seulement tout savoir, mais aussi tout faire : dans l’Hippias Mineur, en 368 b, Platon nous rapporte comment Hippias s’était présenté à Olympie dans un costume solennel dont il se prétendait l’auteur exclusif, ayant fabriqué son anneau et le sceau qui l’ornait, son peigne et sa fiole à parfum, son manteau et sa tunique, et sa ceinture qu’il avait tressée lui-même et qu’il disait semblable aux plus luxueuses ceintures de Perse. L’intellectuel Platon se moque de ces prétentions, mais on peut deviner dans cet intérêt porté par Hippias à l’habileté des artisans un trait original : une société esclavagiste, comme celle de la Grèce ancienne, étant plutôt portée à juger vils les métiers manuels. Les leçons d’Hippias étaient très courues et grâce à elles il amassa une véritable fortune. Ses dons d’orateur lui permettent de conduire diverses ambassades envoyées par Élis, sa ville natale, en Sicile, à Athènes, à Sparte. On le disait l’auteur d’un certain Dialogue troyen dans lequel il imaginait une conversation entre Néoptolème, le jeune fils d’Achille, le héros de l’Iliade, et le vieux Nestor qui enseigne au jeune homme comment il faut se conduire dans le monde pour acquérir une noble réputation (286 a). On reconnaît le thème cher aux sophistes de l’éducation, qui est l’art de préparer les jeunes à la vie sociale et politique, c'est-à-dire les adapter le mieux qu’il est possible aux mœurs et aux coutumes de leur cité.
Quant à la sagesse d’Hippias, on ne peut la reconstruire que par conjectures : il semble en premier lieu que son encyclopédisme n’était pas simple pédantisme, mais qu’il se rattachait à une ontologie générale. Selon Hippias en effet, toutes les choses sont liées dans la nature par la vie universelle qui les anime, pensant comme Thalès que « le monde est plein de dieux » et que même les choses inanimées sont douées d’une âme, telle la pierre magnétique ou l’ambre (Diogène Laërce, dans Les Présocratiques, Pléiade 1087). C’est en raison de cette sympathie universelle que toutes les connaissances doivent être liées ensemble, et s’appeler mutuellement. Aussi Hippias reprochera-t-il à Socrate de chicaner sur le détail et de ne jamais considérer l’ensemble des choses. Ainsi : « Vous ne voyez jamais les choses d’ensemble, toi et tes interlocuteurs habituels : vous détachez, vous isolez le beau ou tout autre partie du réel, et vous les heurtez pour en vérifier le son. C’est pour cela que les grandes réalités continues des essences vous échappent. » (301 b). Et plus loin, Hippias critiquera Socrate pour n’avoir prononcé que « des épluchures et des rognures de discours mis en miettes » (304 a).
Le second point, sur lequel portait la sagesse d’Hippias, concerne l’opposition chère aux sophistes entre la nature et la loi. On se souvient que dans le Gorgias, Calliclès opposait à la loi, qui n’est au service que des plus faibles, la nature qui seule permet aux forts de donner toute leur puissance. La loi n’est alors qu’un artifice qui bride la nature des forts, et fait obstacle à l’épanouissement de leurs désirs et de leur volonté de vivre. Ce n’est pas en ce sens qu’Hippias opposait à la loi, selon lui relative aux cités et toujours susceptible d’être réformée, la nature qui était à ses yeux un droit universel (celui-là même que l’âge classique nommera bien plus tard « droit naturel »), qui vaut également pour toutes les cités, qu’elles soient grecques ou barbares, et pour tous les hommes, l’équivalent de cette loi non écrite des dieux qu’Antigone, dans la tragédie de Sophocle, oppose à la loi écrite de la cité au nom de laquelle agit le « tyran » Créon. Selon un passage des Mémorables de Xénophon (IV, IV, § 5 et sq), que Dupréel juge emprunté à la doctrine d’Hippias, ces lois non écrites et valant universellement seraient la prohibition de l’inceste et l’amitié, c'est-à-dire la gratitude que l’on doit à celui dont on est l’obligé. C’est ainsi que l’universalisme du savoir encyclopédique se redouble chez Hippias d’un universalisme juridique, au nom d’un naturalisme qui est un humanisme. Toute loi qui fait violence au droit de la nature est tyrannique et donc illégitime : « La loi n’est qu’un tyran pour les hommes et fait maintes fois violence à la nature. » (Hippias, dans le Protagoras, 337 d). Loi et nature s’opposent donc comme légalité et légitimité. Les sympathies démocrates d’Hippias le conduisaient ainsi à légitimer l’égalité politique entre les hommes et à donner le pas à l’amitié naturelle que les hommes ont les uns pour les autres sur le respect formaliste et souvent cruel des lois. Selon Eugène Dupréel, qui a donné une large importance à cette dimension de la pensée oubliée d’Hippias, la doctrine du grand sophiste annonce ainsi le cosmopolitisme stoïcien et même le catholicisme chrétien. Grand voyageur, l’un des rares Grecs à avoir fait l’effort d’apprendre les langues « barbares », il avait appris combien sont relatives les lois des diverses cités et combien est universelle et nécessaire l’éthique de l’amitié et de la concorde. Un fragment rapporte qu’Hippias « appelle “filles de l’océan” les deux continents d’Asie et d’Europe. » (Pléiade 1087) : pour Hippias, les patries barbares et la patrie hellène sont comme des sœurs.
On mesure par cette évocation combien le portrait tracé par Platon est éloigné de la vérité. Mais il n’est pas inutile d’essayer de connaître le véritable Hippias pour discerner les multiples allusions que fait Platon à sa pensée dans notre dialogue.
L’Hippias majeur relève du genre que les scoliastes alexandrins nomment « anatreptique » (de anatrepô, tourner sens dessus dessous, mais aussi ranimer, exciter) : il s’agit non de déclarer la vérité mais de tourner en tous sens les arguments pour éveiller la pensée. Après un long préambule dont le lien avec l’argument du dialogue est passablement énigmatique, la réflexion porte sur l’essence de la beauté. On remarque que le sujet central est amené par un détour qui paraît bien fragile : Hippias venant de faire l’éloge du beau discours qu’il vient de prononcer devant les Lacédémoniens, Socrate en profite pour lui demander ce qu’il entend par « beau ». Le dialogue procède alors par une série de définitions successivement avancées et successivement réfutées, jusqu’à l’aveu final de l’ignorance : « to khalepa ta kala, le beau est difficile ».
Le prologue met en scène la vanité du sophiste qui ne répugne pas à prononcer son propre éloge, évoque ses succès, l’argent qu’il récolte grâce à ses leçons, et l’habileté avec laquelle il sait se plier à la demande de son public, servant aux Lacédémoniens ce qu’il souhaitent lui entendre dire (281a-286c).
Le développement dialectique proprement dit commence avec la question de « Peux-tu me dire ce qu’est la beauté? » (286d) dont Socrate éprouve le besoin de préciser le sens jusqu’en 287d. Cette précision n’est en effet pas inutile puisqu’elle désigne l’ambiguïté de la beauté qui commandera toute la suite du dialogue, beauté en soi ou beauté des choses singulières. On peut alors distinguer dans la suite du dialogue deux grandes parties, la première qui témoigne de l’incompréhension (ou du refus) d’Hippias quant à la question posée, la seconde qui porte en effet sur ce qui est mis en jeu. Dans la première partie, Hippias ne peut répondre à la question « qu’est-ce que le beau? » qu’en énumérant un certain nombre de choses réputées belles : jeune fille, jument, lyre, marmite ; ou bien encore l’or, l’ivoire ou le marbre (287e-290d). Dans la seconde partie, il ne sera plus question des belles choses, mais du principe même de la beauté : le beau est d’abord ce qui convient (to prepon), c'est-à-dire ce qui est parfaitement ajusté à sa fonction (comme le bois de figuier pour une cuillère destinée à remuer la purée), ce qui entraîne un long examen sur la relativité des convenances et l’impossibilité de s’élever ici à un principe universel que l’unique essence du beau exige pourtant (290e-295c). Le beau est ensuite de qui est l’utile (to ôphelimon, avantageux, profitable) : 295c-297e. Enfin le beau est défini de façon plus « esthétique » comme ce qui procure à la vue ou à l’ouïe un plaisir sensible, cette dualité posant le difficile problème de son unité ou de sa pluralité (297e-303d). Dans un rapide épilogue, Platon soulève la question fondamentale du divorce possible entre agathon et kalon, le bon et le beau (304a), Hippias se livre à une critique acerbe de la méthode dialectique de Socrate (304ab) et Socrate fait enfin le constat de sa docte ignorance : « Pour moi, victime de je ne sais quelle malédiction divine, j’erre çà et là dans une perpétuelle incertitude. » (304c).
Plan du dialogue
Prologue (281a-286c)
Les belles choses
Définition de la question (286d-287d)
La collection des diverses beautés (287e-290c)
Le principe de la beauté
La convenance (290d-295c)
L’utilité (295c-297e)
Le plaisir esthétique : la vue et l’ouïe (297e-303)
Épilogue : 303e jusqu’à la fin.
Commentaire
Prologue
Le prologue : il porte sur la question du progrès des connaissances. Si la science progresse, il est juste que les modernes soient plus savants que les anciens, et fassent en conséquence payer leurs leçons un bon prix. Mais si, comme l’entend Socrate, la science régresse, il est juste que les modernes ne demandent rien pour leurs leçons. L’argent, étant marchandise universelle, ne peut être échangé que contre une marchandise, ici le savoir intellectuel. L’argent devient le plus petit dénominateur commun du savoir (Hippias se flatte d’avoir dépassé la recette de Protagoras en Sicile, pourtant dans un misérable trou, Inycos : 282e). Mesurer l’amplitude du savoir par l’argent, c’est l’évaluer sous l’angle exclusif de la quantité. Hippias sait beaucoup de choses, mais il ne sait pas ce qu’il sait. Si le savoir est accumulation (quantité) il progresse ; si le savoir est lucidité de la conscience, il peut fort bien régresser, étouffé au contraire sous le poids des connaissances acquises. On pourrait dire que le sage socratique ne se soucie pas de la richesse acquise (comme Anaxagore, sage à l’ancienne mode, imprévoyant qui a laissé se dilapider son héritage — 283a —, à l’inverse du prévoyant Thalès...), mais uniquement de l’éveil de l’esprit. Comme l’écrit Dupréel : « Dans la science, Hippias voyait avant tout un progrès technique, et Prodicus [qui fut le maître de Socrate et dont Socrate reprendrait ici les idées et la critique de la polymathie d’Hippias] de son côté y découvrait une réforme de l’âme, une conversion. » (Les Sophistes, p. 198). A l’inverse de Socrate, Hippias infatué de son savoir, ne sait pas seulement ce qu’il sait. C’est ainsi que la mnémotechnique finit par faire obstacle à la réminiscence. C’est ainsi encore que l’accumulation de l’écrit finit par étouffer, nullement à stimuler, la puissance maïeutique de l’esprit (Phèdre).
La question porte donc sur la nature du savoir : est-il accumulation de connaissances ou au contraire conscience progressive d’une essentielle ignorance? Aussi le savoir d’Hippias vaut davantage que le savoir des anciens sages de la Grèce, Pittacos, Bias, Thalès, Anaxagore (ce dernier étant le maître du jeune Socrate) : 281c. Hippias en sait même davantage que ses contemporains et rivaux, que Socrate lui rappelle malicieusement, pour piquer sa vanité : Gorgias, Prodicos, Protagoras (282 b-d).
En écrivant ainsi l’équation bouffonne qui veut qu’un savoir est d’autant plus profond qu’il rapporte davantage d’argent, Socrate fait une satire des temps modernes : Athènes selon Platon étouffe sous le poids des richesses et la démocratie est devenue une société du spectacle où tout se vend et tout s’achète, y compris la sagesse. A cette ploutocratie, décrite en Rép VIII (description de l’état oligarchique, fondé sur l’amour des richesses, et né de la perversion de la société timocratique, fondé sur l’amour de l’honneur : 550c-555a), Platon oppose la vertu de Lacédémone, l’unique cité de la Grèce que le luxe n’a pas corrompu et qui, au nom des valeurs traditionnelles, conserve ses traditions et résiste au triomphe universel du marché. C’est ainsi qu’à Lacédémone, Hippias n’a pas pu convertir son savoir en richesse, il n’a tiré des Lacédémoniens « pas la moindre obole » (283 c). Hippias, auteur d’un dialogue troyen entre Néoptolème et Nestor, sait pourtant enseigner la vertu (arêtê), qu’on estime hautement à Lacédémone. L’enseignement de la vertu est en effet un domaine dans lequel les sophistes prétendent être experts, et c’est la question qui détermine le dialogue du Ménon. Pour les sophistes, enseigner la vertu, c’est former des citoyens, et l’éducation sophistique est surtout une éducation civique. Toutefois, en cette matière, les Spartiates s’en remettent aux traditions, et ne consentent pas à modifier les coutumes (284a). A Sparte, la tradition tient lieu de vérité, les meilleures lois sont les lois de nos pères, et l’éducation civique est chose nationale (epikhôria, 285 a), qu’on ne confie pas aux étrangers : « il est contraire à leurs lois d’élever les enfants selon une méthode étrangère » (xenikê paideusis, 284c). Les Lacédémoniens pensent donc que les anciens en savent plus que les modernes. Ils s’opposent donc sur ce point à Hippias, qui juge néfaste ce légalisme qui n’est qu’un fétichisme de la loi : seule la nature est, pour le sophiste, universelle, la loi doit toujours pouvoir être réformée. C’est ainsi que pour les Lacédémoniens, « la loi est inflexible » alors que pour Hippias il se peut qu’elle engendre le mal, si elle est mal faite (284 cd). En outre, les Lacédémoniens, en s’en remettant aux coutumes de leurs pères, placent les conventions héritées du passé plus haut que la nature, contredisant ainsi le naturalisme (qui est un rationalisme) juridique d’Hippias. Hippias, optimiste et progressiste, blâme donc le conservatisme de Lacédémone et rencontre là une cité fermée sur elle-même, indifférente aux sirènes de la modernité et opposant son patriotisme (« leur méthode nationale », 285 a) peut-être borné à l’universalisme du sophiste. Hippias reconnaît cependant que les lois de Lacédémone sont des bonnes lois (eunomos, 283 e).
La question du progrès se redouble donc d’une autre, parallèle : celle qui porte sur l’autorité respective des pères et des fils. 282 e : Hippias, grâce à son savoir, donne à son père le butin qu’il a gagné à Inycos ; le père tient donc sa richesse du fils, et non l’inverse. 283 e : Hippias à Lacédémone n’a su persuader ni les jeunes gens, ni les pères (mais on peut supposer que les jeunes Lacédémoniens n’ont d’autre choix que celui que choisissent pour eux leurs pères). 285 a : Socrate suggère que Hippias, avec ses leçons de vertu civique, entreprend de se substituer aux pères : « D’après toi-même, les fils des Lacédémoniens se conformeraient mieux au droit en suivant les leçons d’Hippias et moins bien en suivant celle de leurs pères. » Et c’est bien là en effet ce que pense Hippias. On n’oubliera pas que le maître de la cité moderne, le turannos qui trouve sa figure la plus héroïque dans le personnage d’Œdipe, ne parvient au pouvoir que par le meurtre de son père. Le conservatisme de Lacédémone accorde par principe aux seuls pères, c'est-à-dire au poids de la tradition, l’autorité politique. Il est donc hostile à Hippias, qui veut ouvrir l’horizon étroit des cités à l’universalité du genre humain, et substituer à la loi héritée des pères, la loi librement formulée par le débat des fils. Pourtant, le progressisme d’Hippias accorde plus de valeur à la jeunesse tournée vers l’avenir qu’à l’âge mûr déjà chargé de passé. Le dialogue troyen, sage leçon du vénérable vieillard Nestor au jeune Néoptolème, va donc à l’encontre des idées d’Hippias lui-même. Sa sagesse ne semble pas trop lui tenir à cœur puisqu’il ne dédaigne pas d’en inverser les principes pour mieux s’adapter aux goûts de son auditoire.
Si Hippias se prétend savant en vertu, et si les Lacédémoniens ne veulent recevoir de leçons de vertu de personne, et surtout pas d’un étranger, de quoi peut bien parler Hippias à Lacédémone? Car, intarissable, il vient y faire des discours et, selon du moins son propre témoignage, il est chaleureusement applaudi : « Tu dis, Hippias, qu’ils t’applaudissent et qu’ils écoutent tes discours avec plaisirs : quels discours, par les dieux? » (285 bc). Ainsi le dialogue prend insensiblement la chemin du beau en se portant sur des discours privé de tout contenu réel : puisque les Lacédémoniens ne veulent pas entendre Hippias sur la vertu, il ne reste plus au sophiste qu’à briller par la forme du discours. Comme si la beauté n’était que la parure d’un discours vide. Ce discours vide, qui soulève l’enthousiasme des Spartiates, c’est celui qui porte sur les généalogies et la fondation de la cité (285 d), c'est-à-dire précisément sur ce passé dont Hippias souhaiterait pourtant, au nom de l’avenir, s’affranchir. Hippias ressemble alors à un homéride, tel Ion qui récite devant les Grecs la geste des héros devant les murailles de Troie. Si l’on dépouille Hippias de sa soi-disant science pédagogique, qui le fait moderne, on découvre sous ce masque la très ancienne figure de l’aède. Mais comme nous savons que ce sont là des contes d’autrefois, Hippias, qui se flatte si fort d’être moderne et en avance sur son temps, ressemble pourtant à Lacédémone aux petites vieilles qui radotent des histoires de l’ancien temps : « Tu tiens auprès des Lacédémoniens l’office des vieilles femmes auprès des enfants, celui qui consiste à leur raconter de belles histoires. » (286a). Curieux et ironique retournement, qui fait du partisan de la modernité un ancêtre radoteur! Hippias, optimiste et progressiste, en est réduit à Lacédémone, par pur opportunisme, à rapporter des contes de bonne femme. Hippias sent bien qu’il y a à Lacédémone une tradition qui est foncièrement hostile à sa sagesse, à son optimisme comme à son modernisme. Aussi essaie-t-il de s’en sortir en évoquant son dialogue entre Néoptolème et Nestor (ironie de ce discours dans lequel, contre les convictions d’Hippias, c’est le vieux qui fait la leçon au jeune), et ses prochains auditeurs athéniens, Eudicos, fils Apémantos ou l’école de Philostrate, qui le demande (286 ab) : on peut imaginer qu’à Sparte, c’est le vieux Nestor qui fait la leçon au jeune Néoptolème, mais qu’à Athènes, le jeune Néoptolème ne se soumet pas si aisément à l’autorité du vieillard. Ainsi Hippias changerait de ton selon le public devant lequel il vient parader.
Pour se faire applaudir à Sparte, Hippias renie donc sa propre sagesse. L’éloge de la vieillesse que devait déclamer le Discours troyen contredit toutes les idées d’Hippias. Il n’en croit donc pas un mot. Il dit pourtant que c’était un beau discours. Qu’est-ce donc que la beauté? Ou plutôt : comment donner un contenu précis à la beauté, puisqu’elle semble être elle-même indifférente au contenu du discours? La beauté serait donc question de forme, non de fond. concept problématique, puisque concept sans objet, notion sans contenu. Ainsi, nous savons, ou croyons savoir, ce que sont la généalogie, la loi, l’amour de la cité, dont il vient d’être question. Ces notions ont évidemment un contenu. La beauté, quant à elle, est plus énigmatique, puisqu’il semble qu’elle puisse revêtir tout contenu, quel qu’il soit. On peut discuter du contenu de l’idée de loi, mais on ne doute pas qu’elle ait en effet un contenu ; il est plus difficile d’assurer que la notion de beauté a un contenu, puisque tout sujet est peut-être indifféremment susceptible de beauté. Socrate esquive ainsi la discussion frontale avec Hippias et déplace l’examen du fond vers la forme. Puisque la beauté est ce qui reste à Hippias quand on vide sa sagesse de son contenu véritable, comme le font les Lacédémoniens, qu’est-ce donc que la beauté? Il est même permis de se demander si la beauté n’est pas un autre nom pour l’opportunisme. Déjà Gorgias avait mis en évidence l’importance du kairos dans l’art de l’éloquence : l’orateur doit toujours tenir compte des circonstances, et s’adapter à l’humeur de son auditoire. Hippias semble bien avoir retenu cette leçon, lui qui sert, contre ses propres idées, aux Lacédémoniens un discours sur la sagesse du vieux Nestor et le respect qu’on doit accorder aux ancêtres dont les généalogies (qui, il est vrai, ne sont pour Hippias que des listes à apprendre par cœur) gardent la mémoire. La beauté en ce sens n’aurait pas de contenu propre, puisqu’elle n’est que flatterie qui donne à chacun ce qu’il désire entendre. Comme Socrate le dira explicitement dans le Gorgias, la rhétorique et la sophistique ne sont que des espèces du genre plus général de la flatterie (463a).
Désormais, Socrate cessera d’être un interlocuteur aimable, qui fait mine de se renseigner sur les activités et les succès du grand sophiste : l’examen va porter sur la beauté, qui a le pouvoir de rendre un discours séduisant, de susciter les applaudissements, indépendamment de son contenu. La rupture de ton est marquée par l’intervention d’un tiers, un interlocuteur « récent » qui demande impérieusement : « Peux-tu me dire ce qu’est la beauté? ti esti to kalon » (286d). Au ton courtois du début du dialogue, le nouveau venu substituera une ironie féroce et peu respectueuse des bienséances : il est « malappris, apaideutos » (288d). Le sophiste, maître du discours, veille à ce que l’échange entre les interlocuteurs reste toujours décent et harmonieux ; le philosophe introduit en revanche une parole plus âpre, qui veut la vérité et ne se contentera pas de généralités vagues et conciliantes. A la paix civile, il préfère la guerre dialectique. D’entrée de jeu, Socrate s’identifie par mimétisme à ce tiers inclus, qui marque l’irruption dans le dialogue de la conscience inquiète de la vérité, et peu soucieuse des bienséances ni des vraisemblances : « Vois-tu quelque empêchement à ce que je fasse son personnage, présentant des objections à tes réponses, de manière à me faire entièrement préparer par toi? Car j’ai quelque habitude de présenter des objections (antilepsis). » (287a). En posant la question de la beauté, Socrate, après ce long prologue, définit le véritable enjeu du débat (ou du combat, puisque en 286d il parle de « retourner vers son adversaire pour reprendre le combat »). En s’avouant vaincu par cet interlocuteur énigmatique, Socrate oppose par avance sa docte ignorance à l’étalage du savoir auquel se livre volontiers le sophiste.
A- Les belles choses
La méthode socratique
En un court mais essentiel avertissement, Socrate précise le sens de la question : elle porte sur la beauté elle-même, et non sur les belles choses, dont ce qui précède laisse entendre qu’elles sont sans doute innombrables : « Les choses belles sont toutes belles par l’effet de la beauté : ta kala panta tô kalô esti kala. » (287c). Hippias, pourtant, n’entend pas la question, et ne voit aucune différence (ouden diapherei, 287d) entre l’universelle idée de la beauté et les choses toujours singulières qui nous apparaissent belles. En formulant ainsi la question, ici comme dans beaucoup d’autres dialogues, Socrate invite la pensée à se convertir du phénomène vers l’essence, des choses singulières vers l’idée universelle ou, pour reprendre la célèbre image de Rép VII, de l’ombre sensible vers la forme intelligible. Nombreux sont les dialogues de Platon qui s’ouvrent sur une semblable démarche : ainsi le Ménon pose la question de l’essence de la vertu à laquelle Ménon, élève de Gorgias, répond en énumérant les actions réputées vertueuses, ou bien encore dans le Théétète, le jeune homme qui porte ce nom répond à Socrate, à la question « qu’est-ce que la science? », en énumérant un certain nombre de disciplines dignes à ses yeux de passer pour science. A cette méthode, qui dévalue le sensible pour le placer sous la dépendance de l’intelligible, Hippias qui, de son propre aveu, ne voit aucune différence (287d) entre l’idée de la beauté et les beautés sensibles, ne comprend rien. Hippias, optimiste, progressiste, se faisant l’avocat de la nature, fait confiance aux apparences, il se fie aux phénomènes. La beauté, il veut l’étreindre et la posséder, et ne doute pas de cette heureuse issue ; c’est peut-être pourquoi il ne sait pas encore la penser.
La collection des diverses beautés
« Une belle fille » : Hippias, sûr de son succès, n’en doute pas, la beauté est comme une femme qu’on peut étreindre. Il fait ici preuve d’un bon sens rustique qui le rend plutôt sympathique. Dans le Banquet, cercle de lettrés raffinés qui se piquent d’homosexualité, c’est plutôt la beauté d’un homme, en l’occurrence Alcibiade, dont on souhaiterait faire l’éloge (bien qu’Alcibiade lui-même doive se résigner à ne pas entendre son éloge, mais à prononcer au contraire celui de Socrate, dont la laideur est fameuse). En soutenant qu’une femme, non un homme, incarne la beauté, Hippias rétablit l’amour du beau dans ce qu’il nommerait volontiers lui-même « la nature », sans se préoccuper des formes déviantes ou perverses de l’amour. Hippias est non seulement un homme simple, il est encore un homme « sain ». On sait par Athénée qu’Hippias aurait prononcé un éloge de Thargélie de Milet « qui prit mari quatorze fois, était très belle de corps et très savante » (Présocratiques, Pléiade, 1086). En outre, il y a quelque flatterie dans sa réponse : qu’il n’y ait rien de plus beau que de posséder une belle femme, c’est là un précepte qui est assuré d’établir une connivence dans une société d’hommes, comme celle que forme dans ce dialogue Hippias et Socrate (sans parler de l’interlocuteur malappris, qui ne fait guère de manières). Socrate ressent cette connivence, et propose alors une belle jument, la plus noble conquête de l’homme, après la femme toutefois, comme l’énonce une plaisanterie qui se veut bien virile. Pourtant, quand Socrate parle d’une belle lyre, on sent Hippias plus réticent (il se contente de répondre « oui » sans autre commentaire) : sans doute y a-t-il quelque chose d’efféminé dans le jeu subtil du citharède. Mais quand il propose enfin une belle marmite (et Socrate prend un malin plaisir à insister : « une marmite bien polie, bien ronde, bien cuite, comme ces belles marmites à deux anses, de près de vingt litres et qui sont belles », 288d ; on fabriquait à Athènes, dans le quartier du Céramique, de fort beaux vases), Hippias se fâche : c’est là un instrument de cuisine, réservé aux esclaves donc, et par conséquent peu digne de figurer dans une conversation entre hommes libres et nobles. Socrate ne suggère-t-il pas en outre que pour Hippias, une belle femme n’est qu’un vase en lequel le généreux sophiste souhaite ardemment déverser sa liqueur? Qu’est-ce donc qui décidera du caractère noble ou ignoble de la beauté? Socrate, prenant à Hippias sa propre thèse sur le relativisme des lois (opposé à l’universalité de la nature) et la retournant contre son auteur, a beau jeu de mettre en évidence la relativité des diverses beauté : c’est ainsi que le plus beau des singes est laid en comparaison de l’homme, que la plus belle marmite est laide en comparaison de la femme, et que le plus beau des êtres humains est laid en comparaison d’un dieu (289ab). En invoquant Héraclite, Socrate évoque le sage selon lequel toute valeur est fluctuante, et l’opinion toujours variable tient lieu de vérité parmi les hommes. En se limitant à l’inventaire des choses sensibles, la pensée ne réussit pas à atteindre un critère de vérité qui ait valeur absolue, elle est emportée par le tourbillon des valeurs relatives. La vérité ne saurait se trouver dans les choses, mais seulement dans les idées. Il faut donc reprendre la question dès le commencement, et s’interroger sur la beauté elle-même, et non plus sur les belles choses : « le beau en soi (auto to kalon), ce qui pare toute chose et la fait apparaître comme belle en lui communiquant son propre caractère » (289d).
De la forme déterminée à la matière indéterminée
Pourtant, cette conversion du sensible vers l’intelligible, Hippias qui accorde crédit à l’apparence et croit possible d’étreindre et de posséder la beauté singulière du phénomène (l’amour est pour lui, selon le premier degré de la dialectique diotimienne, amour d’un beau corps, non de la beauté elle-même), éprouve quelque difficulté à la réaliser. N’avait-il pas annoncé, dès le début du dialogue, qu’il ne voyait aucune différence (ouden gar diapherei, 287d) entre la beauté en soi et les belles choses? Pour Hippias, s’élever de la perception d’un beau corps à la pensée de tous les beaux corps, ce n’est donc nullement se détourner du sensible pour se tourner vers l’intelligible, c’est au contraire ne plus considérer la forme toujours singulière du bel objet pour ne considérer que la matière indéterminée, susceptible d’une infinité de formes, qui le constitue. Le principe universel de la beauté est ainsi non intelligible, mais matériel au contraire : « le beau n’est rien d’autre que l’or, to kalon ouden ê khrusos, 289e ». Une telle réponse ne doit guère nous étonner de la part d’un homme qui mesure la valeur de chaque chose à son pesant d’or : Hippias ne nous a-t-il pas déclaré, d’entrée de jeu, que c’est à l’importance de la recette qu’on mesure la force d’une performance oratoire, et qu’un sage est d’autant plus sage qu’il est plus fortuné? Ce faisant, Hippias se révèle incapable de s’élever à un principe qui soit réellement absolu : pourquoi l’or plutôt que l’argent, ou l’ivoire, ou n’importe quelle autre matière précieuse? Hippias ne sait que proposer, en matière de beauté, que des sensations, incapables de démontrer leur propre légitimité, et non des raisonnements démonstratifs, seuls capables d’établir la véracité de leurs propres principes. La sensation, qui est une impression de l’âme tournée vers l’extériorité, est aliénée et ne saurait donc connaître sa propre nécessité ; seule l’âme qui se connaît elle-même, convertie en son intériorité, est susceptible de fonder en vérité son propre discours. Il est aisé à Socrate de le démontrer : les deux plus célèbres statues de l’antiquité grecque, toutes deux œuvres de Phidias, effigies géantes l’une d’Athéna au Parthénon, l’autre de Zeus dans le temple d’Olympie, ne sont pas en or, mais d’or et d’ivoire, selon le mot grec « chryséléphantine ». Si la tunique d’Athéna est en effet en or, son corps divin, son visage, ses mains et ses pieds sont en revanche en ivoire (290b). Il faut en conclure que la beauté ne vient pas de la matière, si précieuse qu’on l’imagine, mais de son emploi judicieux selon les éléments qui la composent. Hippias le reconnaît lui-même en 290c : la belle matière n’est belle que « quand elle est employée à propos : to prepôn, le convenable, ce qui convient, ce qui est en rapport avec sa fin (290c). » Pour la première fois, l’examen dialectique semble ici s’affranchir enfin du sensible, parvenir à un principe intelligible de la beauté et non plus à une impression sensible reçue par une âme distraite d’elle-même et encore aliénée au spectacle de l’extériorité. On peut donc dire que c’est ici seulement que s’accomplit la rupture qui transporte l’âme du sensible vers l’intelligible, et que l’on passe de la simple description des belles choses au principe de la beauté elle-même : le principe de convenance. Indépendamment de la matière qui la constitue, la beauté proviendrait donc du parfait ajustement de la substance, composée de matière et de forme, à la fin que prescrit son usage. Principe qui se révélera pourtant bientôt insuffisant lui-même, puisqu’il aliène la beauté à l’usage de l’objet, qui est donc considéré ici comme un moyen et non comme une fin, comme un outil plutôt que comme une œuvre d’art qui vaut par elle-même, indépendamment de toute fin qui lui serait extérieure. Aussi va-t-on passer de l’effigie des dieux (l’Athéna chryséléphantine de Phidias) aux instrument de cuisine (retour de la marmite, comme un retour du refoulé), avec la cuillère en bois de figuier, plus belle puisque plus convenable, que la cuillère en or.
B- Le principe de la beauté
La convenance (to prepôn)
En posant la convenance au principe de la beauté, Hippias est bien grec, et sa réponse mérite d’être appréciée, plus que Socrate ne semble le faire. C’est en effet un sujet digne d’étonnement qu’en toutes choses la forme qui convient le mieux, c'est-à-dire qui est la mieux ajustée à la fin qu’on se propose de réaliser, est aussi la plus belle. C’est pourquoi les Grecs avaient coutume de dire que la beauté, qui signifiait dans leur esprit la perfection de la forme à laquelle on ne peut plus rien ajouter ni rien retrancher — selon l’adage apollinien « rien de trop, mêden agan » — était synonyme du bien, non du bien moral, mais de ce bien qui désigne le travail bien fait, comme nous parlons encore aujourd’hui de « belle ouvrage » pour désigner du bon travail : le kalos est toujours également agathos. C’est ainsi que le geste de l’athlète qui lance le disque le plus loin sera aussi le geste le plus beau, comme l’éternise la célèbre statue du discobole par Myron, ou bien encore que le meilleur arc (celui qui enverra la flèche avec la plus grande force) sera aussi l’arc le plus beau. Cette coïncidence est en effet troublante, et il se peut bien que la beauté soit la convenance, c'est-à-dire qu’elle consistât dans le geste ou dans l’œuvre qui atteint le meilleur résultat avec le minimum de moyens.
Pourtant, Socrate, au lieu d’apprécier à sa juste valeur la réponse d’Hippias, cherche aussitôt à déstabiliser son interlocuteur. Il s’empresse en effet de revenir dans cette cuisine, où le noble Hippias refuse de descendre, alors même qu’on s’entretenait des statues des dieux qui sont dans les temples. « Cet homme est un malappris, amathês, il est sans éducation » déclare Hippias au sujet de l’interlocuteur hypothétique qui parle par la bouche de Socrate (290 e). Rien à voir avec Hippias lui-même qui, comme le fait ici remarquer malicieusement Socrate, est si bien chaussé (291 a) : non seulement Socrate lui-même allait nu-pieds, mais Hippias est très fier de ses chaussures, qu’il a fabriquées lui-même selon l’Hippias Mineur, et Socrate ne peut s’empêcher d’ironiser ici cette prétention à la parure et à la parade, si conforme à ce besoin de plaire qui motive le sophiste. Qu’apprenons-nous dans la cuisine? Que pour tourner la soupe aux légumes dans la marmite, mieux vaut une cuillère en bois de figuier qu’une cuillère en or. Socrate prend encore ici un malin plaisir à s’appesantir sur le détail des opérations culinaires que Hippias jugerait décent de passer sous silence : « La cuillère en bois de figuier donne à la purée un parfum agréable, et en outre, avec elle, on ne risque pas de briser la marmite, de répandre la purée, d’éteindre le feu et de priver les convives d’un plat appétissant » (290 e). Le fond de l’argument laisse ici entendre que, si la beauté est ce qui convient, alors il y a une beauté aussi pour les choses les plus communes et les plus viles, du moins selon le jugement que portaient les hommes libres sur les instruments du travail servile. Socrate piège ici Hippias à son propre snobisme, lui qui est si soucieux de paraître sous son meilleur jour et aime tant à se faire admirer pour sa science dans toute la Grèce. Aussi Hippias s’empresse-t-il de détourner la discussion du terrain méprisable des instruments de cuisine, pour élever la notion de convenance dans le registre plus noble de ce qui est estimé aux yeux de la communauté des hommes libres.
La cuillère en bois de figuier répondait à un souci de convenance pratique ; mais c’est maintenant une convenance éthique et sociale qu’invoque Hippias : « Ce qu’il y a de plus beau pour un mortel, c’est d’être riche, bien portant, honoré de toute la Grèce, de parvenir à la vieillesse après avoir fait à ses parents morts de belles funérailles, et enfin de recevoir de ses propres enfants de beaux et magnifiques honneurs funèbres » (291 d-e). Selon le sophiste, aux yeux duquel l’opinion tient lieu de vérité et l’apparence tient lieu de beauté, il n’est rien de plus beau ni de plus convenable que de vivre conformément aux coutumes de son pays et d’être hautement estimé de ses concitoyens. Socrate aura alors beau jeu de montrer que le convenable selon Hippias n’est qu’un conformisme, qu’il ne saurait donc prétendre avoir une valeur absolue, mais au contraire seulement relative à ce qui est jugé estimable dans la cité. C’est ainsi qu’Achille (292 e), qu’Hippias lui-même avait pourtant choisi pour héros dans l’Hippias Mineur, n’a pas enterré son vieux père Pélée et n’a pas été davantage enterré par ses proches parents, lui qui est mort sous les murs de Troie et son cadavre déchiré par les charognards. Il y a pourtant de la beauté dans la vie d’Achille, et c’est précisément cette beauté héroïque que célèbre Homère dans l’Iliade. Et Héraklès (293 a) qui, pour échapper au poison de la tunique de Nessus, se jette dans le bûcher qu’il a lui-même allumé au sommet du mont Œta, est encore un héros célébré partout, et sa mort n’est pourtant guère convenable selon les critères avancés ici par Hippias. On pourrait ajouter à ces divers exemples que Platon emprunte à la mythologie, la mort de Socrate lui-même, si peu convenable puisque condamné légalement à la mort, et pourtant non exempte d’une grande beauté, aux yeux de Platon du moins, pour lequel il ne saurait y avoir de mort plus grande et plus héroïque. L’interlocuteur malappris (mais ici le manque d’éducation est en vérité le refus assumé du conformisme auquel Hippias adhère) sous lequel se travestit Socrate ne saurait se satisfaire de la réponse d’Hippias, plus soucieuse de reconnaissance sociale que de vérité. C’est pourquoi la beauté dont nous parle Hippias n’est pas l’essence même de la beauté, qui doit demeurer toujours invariable, mais c’est au contraire une beauté relative, aliénée au jugement du public et dépendante des goûts et des modes. Il ne s’agit donc que d’une beauté apparente, et non d’une beauté véritable, comme un homme ridicule, déclare Hippias lui-même faisant ainsi inconsciemment son autoportrait, qui mettrait un vêtement et des chaussures qui lui iraient bien, ce qui le ferait paraître à son avantage (294 a). La beauté du sophiste consiste en l’art de cultiver les apparences, dans le but de se faire admirer et reconnaître. Elle n’est donc qu’une apparence et non une réalité, to phainesthai et non to einai (294 e). Mais en ce cas, la prétention du sophiste à tout savoir s’effondre : il n’y a en effet de savoir que de l’être, l’apparence ne donnant lieu qu’à un savoir-faire. La science exige des lois qui valent « pour l’opinion universelle et dans tous les temps » (294 c) ; elle ne saurait se satisfaire de simples usages qui ne sont en vigueur que dans une certaine société, à une certaine époque (2). Si la beauté n’est qu’une apparence, il n’y a donc pas de science de la beauté, mais seulement une habileté à paraître à la mode, à se plier au le goût du jour, et il faut renoncer à l’idée d’une science du beau, en laquelle cependant Hippias se déclarait expert au début du dialogue (294 de). On peut dire qu’ici le sophiste n’est pas réfuté, il est plutôt démasqué : sa prétendue science n’est qu’une habileté à gagner l’estime des hommes, à se faire admirer du public, son amour des « convenances », du « convenable », n’est qu’un conformisme, puisqu’il se reconnaît lui-même prêt à sacrifier la vérité pour l’apparence. Peut-être est-ce précisément parce qu’il se sent démasqué, qu’Hippias cherche à fuir la scène où il ne brille que par son vêtement de parade : « Donne-moi seulement quelques instants de réflexion solitaire » (295 a) implore-t-il, instants que Socrate, ou plutôt l’interlocuteur malappris, inflexible, lui refuse.
L’utile (to khrêsimon)
« A notre avis, le beau c’est l’utile » (295 c), to khrêsimon : l’utile, le profitable, l’avantageux, ce dont on peut tirer parti. En avançant cette notion, la réflexion ne progresse guère, tant le convenable est proche de l’utile : il s’agit chaque fois d’un moyen qui permet d’atteindre la fin qu’on se propose. Il est vrai que la convenance témoignait d’un certain conformisme, comme le progrès dialectique a su le mettre en évidence, tandis que l’utile est une notion plus simplement pragmatique. Il reste que la beauté est toujours comprise comme la forme la plus efficace pour obtenir le résultat désiré, le maximum d’effet avec le minimum de moyen. Si pourtant Socrate reprend la démonstration, c’est sans doute parce que Hippias, comme nous l’avons constaté, est davantage démasqué que réfuté : quelque soit le désir de reconnaissance sociale qui motive le sophiste, l’équation proprement grecque du beau et du bon n’a pas été réfutée. Cette réfutation est précisément l’objet du passage que nous commentons maintenant.
En réduisant la beauté au ni trop ni trop peu de la plus grande utilité, on la pose relativement à une fin qui lui reste extérieure. Tant que cette fin est indéterminée, l’idée du beau demeure vide de tout contenu. L’utile n’est en effet qu’une simple capacité, une puissance (to dunaton) pour obtenir un effet, quelque soit cet effet. En tant que pure puissance, il peut engendrer le mal (to kakon) tout autant que le bien (to agathon) : 296 c. Et si cette distinction se redouble de celle de l’ignorance et de la science (296 a : « c’est la science qui est la chose la plus belle et l’ignorance qui est la plus honteuse »), c’est parce que Platon pense que nul n’est méchant volontairement, c'est-à-dire qu’il n’y a pas de puissance propre du mal, que l’on poursuit donc toujours le bien et que celui qui fait le mal ne peut le faire que sans savoir qu’il le fait. L’utilité, qui n’est qu’une simple capacité, ne saurait suffire pour produire la beauté : il faut encore que cette capacité soit au service du bien. Est alors bon, pour chaque chose ou pour chaque être, tout ce qui participe à l'accomplissement de son essence, à l'épanouissement de sa plénitude. C'est par le « bien » que chaque existence est « en pleine forme », qu'elle atteint la perfection de sa forme, à laquelle rien ne manque, que tout supplément ne ferait qu’affaiblir. Ainsi dit-on de l'arc qu'on tient bien en main, et dont la portée est grande, qu'il est un « bon » arc. Le beau ne saurait donc être utile qu'en tant qu'il concourt à cette excellence, et dans cette mesure seulement. C’est ainsi que ce qui est utile pour détruire ou diminuer la plénitude d’une existence ne participe nullement à l’idée du beau : le feu est utile pour détruire le temple, mais le temple incendié est moins beau que le temple qui paraît dans toute sa splendeur.
Il faut donc corriger notre première proposition, et dire que le beau est l’utile qui accomplit en son être l’existence pour laquelle il est utile. C’est ce que signifie ici cette notion d’ « avantageux », ou de « profitable » (to ôphelimon, 296 e) avancée maintenant par Socrate. Tandis que l’utile ne désigne qu’une aveugle puissance, l’avantageux est la puissance de la science qui vise donc le bien, et non le mal, et permet ainsi d’accomplir une existence non encore parvenue dans l’état de sa plénitude. On remarque toutefois la circularité d’une telle définition, qui conduit à une sorte de confusion entre le moyen et la fin : qu’est-ce en effet que la beauté, sinon cette accomplissement de l’être que vise l’avantageux, pourtant identifié à la beauté? La beauté serait ainsi à elle-même sa propre cause, à moins qu’on ne nomme « bien » la plénitude de l’être accompli, et « beau » l’avantageux qui réussit à réaliser cette plénitude... En ce cas, le beau ne serait pas le bien, contrairement à ce que les Grecs ont toujours affirmé, mais seulement « quelque chose comme le père du bien » (297 b). Mais on sent bien qu’on pourrait tout aussi bien dire que le bien est le père du beau, ce qui serait en effet plus conforme à la philosophie de Platon, qui considère que le bien est « l’idée des idées ». Le débat tourne en rond, et ne parvient pas à donner un contenu véritable à l’idée de beauté. Il conduit en outre à distinguer entre le bien et le beau, conclusion qui ne saurait satisfaire un esprit grec, que ce soit celui d’Hippias ou celui de Socrate (297 c) : que le beau ne soit pas le bien et que le bien ne soit pas le beau, c’est là, aux yeux d’Hippias comme de Socrate, « la conclusion la moins satisfaisante où nous soyons encore arrivés. » Plus profondément, en identifiant la beauté au mêden agan de la forme de meilleure convenance, on en fait un moyen en vue d’une fin, et nullement une fin en soi : convenable à quelle fin, utile à quelle fin, avantageux à quelle fin? Ces notions ne sont pas réfutées par Socrate, mais elles se révèlent plutôt vides de tout contenu : ce formalisme est incapable de dire réellement ce qu’est la beauté. « Pour moi, avoue alors Socrate, je ne sais plus de quel côté me tourner ; je suis en détresse (aporô) » (297 d).
Le plaisir esthétique (la vue et l’ouïe)
Aux définitions objectives de la belle forme, selon le principe du convenable, de l’utile ou de l’avantageux, succède maintenant une nouvelle définition qu’on peut dire subjective de la beauté : le beau est l’agréable, c'est-à-dire ce qui procure du plaisir au sujet qui l’éprouve. Renversement : la beauté n’est plus pensée comme une propriété de l’objet mais comme un sentiment du sujet (sentiment de plaisir). On passe ainsi de la théorie du beau à une analyse du sentiment esthétique. Ce retournement étant à l’origine de ce qu’on nomme depuis le XVIIIe siècle « esthétique », qui s’est alors substitué à la philosophie de l’art, le texte de Platon prend ici une direction étonnamment moderne. Ce n’est pourtant pas en ce sens qu’il faut le lire, car il ne s’agira nullement de sentiment esthétique, mais bien de subjectivité, c'est-à-dire de ce qui fait qu’un sujet est un sujet, autrement dit une existence capable de se connaître elle-même.
En définissant la beauté comme plaisir esthétique (aisthêsis signifie sensation), Socrate prend soin de préciser à quelle sorte de sensation convient l’expérience de la beauté. Tout plaisir sensible, en tant qu’il est plaisir, ne participe pas en effet de la beauté, et il est bien des formes de l’agréable esthétique qui ne sauraient être qualifiées de belles. Comment faire le tri? Puisque nous sommes dans le domaine de la sensation, il n’existe que cinq types de plaisir possibles, puisque nous n’avons que cinq sens : la vue, l’ouïe, le toucher, le goût et l’odorat. Les trois derniers sont immédiatement discrédités par Socrate, au nom non seulement de l’opinion commune, mais aussi de l’intime conviction des deux interlocuteurs du dialogue : « Si nous disions que manger est non pas agréable, mais beau, tout le monde se moquerait de nous ; de même si nous appelions une bonne odeur belle au lieu de bonne. Quant à l’amour, tout le monde aussi nous soutiendra qu’il est fort agréable, mais aussi qu’il est fort laid, et que, pour cette raison, ceux qui s’y livrent doivent se cacher pour le faire. » (299 a). Bien entendu, le manger vaut ici pour le goût, l’odeur pour l’odorat et l’amour pour le toucher. Restent donc comme candidats pour le plaisir esthétique participant à l’idée du beau, ceux de la vue et ceux de l’ouïe (3). Il est vrai qu’il s’agit là d’un résultat simplement empirique, héritage de la tradition ou préjugé de l’opinion (« tout le monde se moquerait de nous ») et non d’une vérité rationnellement démontrée. Cependant, semble confirmer cette opinion le fait que les arts cultivés par les hommes relèvent en effet de la vue (peinture, sculpture) ou de l’ouïe (musique, rhétorique — « de beaux discours » — et poésie — « de belles fables, ai muthologiai » : 298 a). En revanche, on discerne mal ce que serait un art du goût, de l’odorat et encore moins du toucher. C’est un fait que les arts cultivent ces deux types de sensations de préférence aux autres, un fait sur lequel toute réflexion proprement esthétique doit s’interroger. Socrate avance une curieuse explication, presque à la fin du dialogue : « Ces plaisirs [ceux de la vue et de l’ouïe], considérés ensemble ou séparément, sont les plus innocents et les meilleurs de tous, asinestatai kai beltistai » (303 e), asinês signifiant à la fois innocent, inoffensif, qui ne fait pas de mal, et aussi intact, non endommagé. Il faut peut être comprendre que l’odorat (qui se délecte d’une effluve qui émane du corps odorant, et suppose donc que ce corps se désagrège ou s’évapore), le goût (qui ne s’éprouve qu’à la condition de faire fondre l’objet dans la bouche) et le toucher (dont le contact finit par user l’objet) ne peuvent jouir de leur objet qu’en se l’appropriant, en le consommant ou à tout le moins, en le modifiant, tandis que la vue et l’ouïe jouissent du bel objet sans que celui-ci ne soit atteint ni modifié par ces sensations, donc dans le respect de son intégrité. Seuls l’œil et l’oreille jouissent du bel objet sans franchir la distance qui le sépare d’eux. On trouve ici une sorte d’ébauche du caractère désintéressé du sentiment esthétique, thèse qui deviendra fondamentale dans l’esthétique de Kant.
Le développement, peut-être un peu embrouillé, portera alors sur le caractère commun, ou essence du plaisir esthétique, qu’il s’actualise dans le plaisir de la vue ou dans celui de l’ouïe. Si l’on dit que l’un et l’autre participent également de la beauté, il faut en conclure que la beauté ne se trouve ni dans l’un ni dans l’autre, mais dans ce qui leur est commun en tant qu’il sont plaisirs, en tant qu’ils procurent le sentiment de l’agréable au sujet qui les ressent. « La vue et l’ouïe ont donc une qualité identique par l’effet de laquelle ils sont beaux, un caractère commun qui se rencontre à la fois dans chacune de ces deux sortes et dans les deux ensembles » (300 a). Le problème posé est celui qu’on nommera plus tard celui du « sens commun ». En effet, nous ne percevons pas un monde visible, puis un monde audible, puis un monde plein de saveurs, d’odeurs et de qualités tactiles : nous percevons, globalement et simultanément, un seul et même monde sensible. Il faut donc que les diverses impressions sensibles soient rapportées à une activité de l’esprit qui en opère la synthèse. L’unité du sensible n’est pas le fait des sens eux-mêmes, mais de l’âme qui les considère. Platon développera ce problème difficile dans le Théétète (184d sq. : on se reportera, sur ce site même, à mon commentaire du Théétète). La beauté passerait alors de l’ordre du sensible à l’ordre de l’intelligible, et le caractère commun qui fait belles les sensations de la vue et de l’ouïe proviendrait de l’acte de l’âme qui s’applique à ces sensations. Cette analyse est latente, mais jamais explicite, dans le texte de l’Hippias Majeur. C’est pourtant cette pensée, qui veut que l’unité de la vue et de l’ouïe ne soit pas sensible, mais intelligible, qui détermine une curieuse et difficile digression sur la méthode.
On apprend dans le Phèdre (265 c-266 c) que la méthode dialectique consiste dans le travail successif de l’analyse — qui dissocie une pensée dans les notions élémentaires qui la composent — et de la synthèse — qui recompose l’unité de cette multiplicité distincte. C’est contre le premier temps, celui de l’analyse, que proteste alors Hippias : « En vérité, Socrate, vous ne voyez jamais les choses d’ensemble, toi et tes interlocuteurs habituels : vous détachez, vous isolez le beau ou toute autre partie du réel, et vous les heurtez pour en vérifier le son. C’est pour cela que les grandes réalités continues des essences vous échappent. » (301 b). Et plus loin : « Je répète ce que je disais tout à l’heure : ce sont là des épluchures de discours mis en miettes » (304 b). Nous avons vu en effet que l’universalisme ou l’encyclopédisme d’Hippias suppose l’unité du savoir : chaque notion n’a de sens que par son appartenance au tout qui lui donne vie. En l’isolant, on perd le sens, et il ne reste du mot qu’un son vide et creux. Il ne faut donc pas chercher la beauté dans les éléments qui la composent (les sensations de la vue et de l’ouïe) mais dans l’idée générale qui lui donne sens : « Ce qui est beau, ce qui est précieux, c’est de savoir, avec art et beauté, produire devant les tribunaux, devant le Conseil, devant toute magistrature à qui l’on a affaire, un discours capable de persuasion » (304 a-b). Remarquer la circularité de cette définition : est beau le beau discours, la notion définie figurant dans sa propre définition. Pourtant, Hippias n’en démord pas : la beauté est ce qui apparaît telle au public de ses admirateurs. Hippias confond les applaudissements avec la vérité et se satisfait de l’apparence de la beauté, sans se soucier de son être authentique. Il reste persuadé que cette conception de la beauté est toujours véritable, et refuse de se perdre dans le détail de l’analyse. Platon en revanche affirme qu’une définition globale de la beauté, ainsi posée dogmatiquement, est illégitime, puisqu’elle n’est pas fondée en démonstration. Avant d’énoncer la définition générale de la beauté, il faut donc s’interroger sur les éléments qui la composent, et parvenir ainsi lentement à la définition philosophique du beau, qui sera toujours le résultat d’une longue analyse et jamais le préalable d’une discussion. Pour Hippias, on pose les définitions d’abord, et on procède ensuite aux analyses particulières. Pour Platon, toute définition posée d’emblée n’est qu’un préjugé ; il faut d’abord se livrer à une minutieuse analyse avant de parvenir à la vraie définition, qui ne peut être que le résultat final d’une recherche. On peut formuler ainsi le paradoxe platonicien : nous ne parlons pas, c'est-à-dire nous ne pensons pas, parce que nous connaissons les définitions des mots que nous employons ; c’est inversement pour connaître ces définitions que nous parlons et dialoguons ensemble. L’exemple de la beauté, ici étudiée, montre parfaitement l’opposition de ces deux méthodes : pour Hippias, est beau tout ce qui est estimé tel par l’assemblée des hommes libres. C’est donc sous le postulat de la souveraineté de l’opinion que se développe toute sa pensée, et tous les cas particuliers viendront se plier à ce principe. Pour Platon, qui déclare ne pas savoir ce qu’est la beauté, il faut inversement partir des affirmations singulières de la beauté pour tenter de remonter, par induction, à la loi générale de la beauté. Or, ce parcours est problématique, car nous ne sommes plus certains de la continuité du sens, que postulait pourtant Hippias. C’est ainsi que l’unité de deux sensibles — la vue et l’ouïe — peut fort bien ne pas être un sensible, mais un intelligible, comme nous l’avons vu tout à l’heure. De même, dit ici Socrate, la somme de deux impairs n’est pas impaire, mais paire au contraire (301 d-302 b) ; ou bien encore, le produit de deux irrationnels peut être un entier, et non un irrationnel (« les éléments étant irrationnels, l’ensemble peut être ou irrationnel ou rationnel » : 303 b). C ’est ainsi, par exemple, que
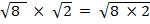

L’encyclopédisme d’Hippias, qui suppose « l’essentielle continuité de l’être », et que « ce qu’est l’ensemble, les éléments le sont aussi, et ce que sont les éléments, l’ensemble le doit être » (301 e), méconnaît donc les modalités beaucoup plus complexes de la participation des éléments à l’idée du tout. Sa méthode n’est en fin de compte que l’universelle tyrannie d’un préjugé, fondée ici sur le goût du succès et l’amour de l’opinion publique.
Dans le cas qui nous occupe, il s’agit de déterminer quel est le caractère commun aux plaisirs de la vue et de l’ouïe, qui tous deux participent de la beauté. Ce ne saurait être qu’ils sont des plaisirs sensibles, puisque nous avons déjà remarqué qu’il existe des plaisirs sensibles, tels ceux du toucher, de l’odorat ou du toucher, qui sont étrangers à la beauté : ce n’est donc pas dans le plaisir sensible lui-même que consiste l’essence du beau. Peut-être même, suggère ici Socrate, la beauté, qui réside dans les plaisirs sensibles de la vue et de l’ouïe, n’est pas elle-même sensible, mais consiste en une opération de l’âme, donc dans un intelligible. La question posée porte donc sur le mode de participation des plaisirs esthétiques à l’essence de la beauté : la notion générique appartient-elle au même genre (c'est-à-dire le genre sensible) que les éléments qui la composent, ou bien au contraire relève-t-elle d’un genre qui leur est étranger (donc du genre intelligible)? « A quelle catégorie appartient donc la beauté, Hippias? A celle dont tu as parlé [sous-entendu : le genre étant alors de même nature que les éléments qui le composent] [...] Mais ne pourrait-il se faire qu’il en fût de la beauté comme des nombres, quand nous disions que le couple étant pair, les éléments peuvent être soit pairs soit impairs ; ou encore que, les éléments étant irrationnels, l’ensemble peut être ou irrationnel ou rationnel? [sous-entendu : le genre étant alors d’une autre nature que les éléments qui le composent] » (303 b). Ce qui revient à demander si la beauté, que nous éprouvons à l’occasion de plaisirs sensibles, est elle-même sensible ou bien au contraire intelligible.
En ouvrant la voie à une hypothétique essence intelligible du beau, le dialogue sort de la caverne où il s’agitait vainement depuis le début et suggère une origine toute spirituelle de la beauté. Le beau serait alors, dans le monde sensible, comme l’ombre, ou le reflet, d’une beauté intelligible qui n’appartient qu’à l’âme et qui serait fondée dans la vertu propre de l’âme, qui est de se connaître elle-même, c'est-à-dire dans l’autonomie de la conscience de soi, qui est l’acte fondateur de la connaissance rationnelle. La beauté serait alors comme le rayonnement perçu par les sens, de façon analogique, de la royauté de l’esprit libre, capable de penser par lui-même, sans invoquer l’autorité ni s’aliéner à l’opinion. Plus tard, Le Banquet montrera comment toute beauté sensible a la valeur d’un signe divin qui oriente celui qui la contemple vers un modèle intelligible qui n’a de réalité que pour l’esprit. Et pour le néoplatonisme, et pour Plotin en particulier, la beauté, dont la forme la plus haute est alors la grâce, sera pensée comme le rayonnement de l’âme qui éclaire et transfigure le visage et le regard de l’être intelligent (c'est-à-dire conscient de lui-même), l’illumination d’une chair par l’esprit qui s’incarne en elle. Hippias, qui ne croit que ce qu’il voit et ne connaît la beauté que par les belles choses, et non par la beauté elle-même, est incapable de s’élever à ces hauteurs. Quant à Platon lui-même, il lui faudra, pour accomplir ce dévoilement, construire la dialectique ascendante du Banquet et de La République, c'est-à-dire convertir le regard de l’âme, de la caverne où se projette l’écran sensible, vers le soleil intelligible qui illumine son intérieur, ce qui revient à fonder la philosophie elle-même. Dans l’Hippias Majeur, nous n’en sommes pas encore là : nous ne dépasserons pas l’aporie du sensible, et la voie de l’esprit, cherchée, n’est pas encore trouvée.
Conclusion
La question est posée ; elle demeure irrésolue. Ni Hippias, qui s’en tient au sensible et éprouve de grandes difficulté à s’élever jusqu’à l’intelligible, ni Platon, qui n’est pas en mesure, avant la rédaction du Banquet et du Phèdre, de résoudre le problème de la participation des belles choses à l’idée de la beauté, ne peuvent répondre. Une voie est donc ouverte, elle n’est pas encore explorée, tant la réflexion est difficile et nouvelle. Et tout le dialogue se conclut par le proverbe : « To khalepa ta kala : c’est une chose difficile que la beauté (littéralement : les belles choses sont difficiles) » (304 e). Ce qui est en effet difficile, ce n’est pas la beauté elle-même, pour laquelle chacun croit posséder, à l’instar d’Hippias, une définition générale, c’est la participation des belles choses à l’idée de la beauté.
On remarquera encore que c’est à propos de ce problème spécifiquement platonicien, celui de la participation du sensible à l’intelligible, que l’interlocuteur malappris, qui conduit depuis le début le jeu dialectique, se démasque et devient enfin celui qu’il est. En 298 b, Socrate évoque en effet « l’homme devant lequel je rougirais plus que devant tout autre de déraisonner et de parler pour ne rien dire! — Quel homme? — Socrate, fils de Sophronisque. » Pour chaque homme qui pense, il n'est de plus terrible juge de la vérité que la pensée qui est en lui. Avant de conclure le dialogue, Platon revient encore une fois sur l’extrême proximité de « cet homme qui ne cesse de disputer avec moi et de me réfuter. C’est un homme, en effet, qui est mon plus proche parent et qui habite ma maison » (304 d). La « maison » est ici l’habitacle de l’âme : chaque fois que l’âme attentive rentre en elle-même, elle entend la voix de ce démon intérieur qui la questionne sur l’essence de la beauté, vers laquelle nous porte l’amour, qui est en nous le désir de l’immortel. Comme si Platon voulait nous faire comprendre que c’est seulement ici, dans cette dernière partie du dialogue, que ce qui se situe au cœur même de la pensée se trouve véritablement mis en jeu.
On remarquera enfin que le dialogue se termine par une dernière hypothèse, suggérée plutôt que véritablement examinée, et qui joue le rôle d’une pirouette finale. Socrate avance en effet l’idée que le caractère commun aux plaisirs de la vue et de l’ouïe, c’est qu’ils sont avantageux (ôphelimon, 303 e) à celui qui les éprouve : il faut comprendre que le plaisir esthétique épanouit l’existence de celui qui le ressent, à l’inverse de certains plaisirs (ceux de la drogue par exemple) qui détruisent au contraire ceux qui les éprouvent. On trouve la première ébauche de ce qui sera longuement développé dans le Philèbe. Cependant, il est clair qu’avec cette notion d’avantageux, on revient en arrière (que la beauté soit « l’avantageux » est en effet la thèse que Socrate avait proposée, puis examinée, en 296 e et sq), et que le dialogue, incapable d’ouvrir une issue, est condamné à tourner en rond : « Notre entretien ne revient-il donc pas sur ses pas? » (304 a).
NOTES
1- L’authenticité de l’Hippias Majeur n’a guère été contestée, à la notable exception toutefois de Wilamowitz, mais qui n’a pas été suivi sur ce point par les spécialistes.
2- Dans Minos ou sur la Loi, dialogue apocryphe sans doute rédigé à la fin du IVe siècle BC, il est question de la relativité des lois selon les cités qui les adoptent, et c’est précisément les lois concernant l’enterrement des parents qui sont alors prises en exemple : « Les mêmes hommes n’usent pas toujours des mêmes lois, et celles-ci varient avec les hommes [...] Même chez nous, tu n’es sans doute pas sans savoir, pour l’avoir entendu dire, quelles étaient autrefois nos lois à l’égard des morts : on immolait des victimes avant d’enlever le cadavre et on engageait des femmes pour recueillir les os dans une urne, et à une époque plus ancienne, on ensevelissait les morts dans la maison même. Or, nous, nous ne faisons rien de tout cela. » (315 c-d).
3- On remarquera cependant que dans le Philèbe, lorsque Platon entreprend de dénombrer les sensations pures et sans mélange, il nommera les plaisirs procurés par la vue, par l’ouïe et par l’odorat (51 b). Dans l’Hippias Majeur en revanche, l’odorat n’est pas jugé digne de figurer parmi les plaisirs sensibles participant à l’idée du beau.
