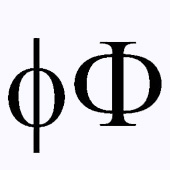|
PETIT ECHANGE AVEC CHATGPT
APHORISMES
ETRE ET EXISTER
ENSEIGNER LA PHILOSOPHIE
L'ESTHETIQUE DE L'ABSTRACTION (1)
ESTHETIQUE DE L'ABSTRACTION (2)
ESTHETIQUE DE L'ABSTRACTION (3)
ESTHETIQUE DE L'ABSTRACTION (4)
PRINCIPES DE PHILOSOPHIE ESTHETIQUE
LA PEINTURE HOLLANDAISE AU SIECLE D'OR
LES FANTOMES DE L'OPERA
ON DEVRAIT DIRE...
QU'EST-CE QUE LE NEOREALISME ?
LA STAR, LA VIVANTE ET LE SANS POURQUOI
ESTHETIQUE DU PARADIS TERRESTRE (1)
LE REALISME SELON CEZANNE
NOTE SUR WITTGENSTEIN
ENTRETIEN
CEZANNE ET LA FORCE DES CHOSES
MANTEGNA : ANCIENS ET MODERNES
LE TABLEAU ET LE MIROIR
LE JARDIN A LA FRANCAISE
REMBRANDT, BETHSABEE
PHILOSOPHIE ET RHETORIQUE
LES RELIGIONS DU LIVRE
DU CARACTERE A LA CARICATURE
QUELLE VANITE QUE LA PEINTURE...
LES GROTESQUES
LE ROSSIGNOL ET LA DIVA
LA STATUE AMOUREUSE
L'INTERPRETATION DE L'OEUVRE D'ART
DE L'IDEE DU BEAU A L'ESTHETIQUE
CARAVAGE ET L'OPERA
|
L'ESTHETIQUE DE L'ABSTRACTION (2)
Baudelaire : l'abstraction poétique et l'esthétique de l'Allégorie
L’Art dit « abstrait » domine l’art mondial pendant une soixantaine d’années au cours du XXe siècle (de 1910, date prétendue – elle serait de 1913 – de la première aquarelle abstraite de Kandinsky, et rédaction Du Spirituel dans l’art, publié en 1912, jusqu’aux années soixante-dix : invention de Marcel Duchamp en père de l’art contemporain et naissance de l’art conceptuel), à tel point qu’il a pu apparaître à certains comme une sorte d’accomplissement de l’histoire de l’art en général, et de l’art moderne en particulier, et ouvrir une voie nouvelle qui était destinée à être explorée des siècles durant. Il semble pourtant en contradiction avec l’orientation esthétique de la « modernité », qui définit l’appréciation de la beauté non plus comme une forme idéale conçue par l’esprit (théorie académique du beau idéal) mais comme une forme rencontrée, appréhendée par les sens (aisthêsis) et par conséquent toujours singulière et sensible : seule est esthétique le jugement qui affirme, de cette rose-ci que je vois à l’instant, qu’elle est belle (Kant, Critique de la faculté de juger, § 8). Rien de moins « abstrait », semble-t-il, que la beauté « esthétique ». Le démontre par exemple le fait que le surréalisme, demeuré fidèle à cette pensée de la beauté comme événement effectivement vécu (le coup de foudre de « l’amour fou ») et non comme forme rigoureusement pensée, ou « composée », a donné lieu en peinture à un art qui a toujours refusé l’abstraction, et ne s’est jamais totalement coupé de la figuration. Il y a incontestablement eu, dans l’inspiration qui conduit à l’abstraction, une dimension anti-esthétique, qui se tourne vers la spiritualité plutôt que vers l’expérience sensible (Kandinsky), vers un formalisme tout intellectuel, parfois même mystique (théosophie : Kandinsky et Mondrian), plutôt que vers l’impression naïvement ressentie : les artistes regroupés autour de la revue Cercle et carré (revue fondée par Michel Seuphor en 1929, qui groupe les constructivistes, adepte d’une abstraction géométrique : Mondrian, Pevsner, Hans Arp, Le Corbusier) recherchent une sorte de schématisation géométrique des formes qui tendent par là à devenir idéales, et nullement « esthétiques ». Déjà, le cubisme, dans son prolongement qu’Apollinaire nommait « l’orphisme » (en référence à son poème Le Bestiaire, ou le cortège d’Orphée de 1908, livre d’art en lequel chaque animal est décrit par un quatrain d’Apollinaire et un bois de Raoul Dufy), qui s’affirme en 1912 avec l’exposition de La Section d’Or, et tend à la disparition de l’objet dans le flux lumineux (František Kupka, Jacques Villon, Robert Delaunay, André Lhote, Albert Gleizes) rêve de restaurer la beauté de parfaite proportion créée par la première renaissance (Piero della Francesca), et de retrouver le nombre d’or de la parfaite harmonie. Dans le même esprit, le prince Matila Ghyka publie en 1931 un ouvrage qui se donne l’apparence d’être savant : Le Nombre d’Or, rites et rythmes pythagoriciens dans le développement de la civilisation occidentale (Gallimard), précédé d’une lettre-préface par Valéry, chantre d’une poétique de l’intellect plutôt que de l’ivresse des sens. A cet académisme de la forme pure et idéale se rattache encore ce néo-cubisme idéalisé qui se fit connaître en 1918 sous le nom de « purisme », et dont Amédée Ozenfant et Le Corbusier (Charles-Edouard Jeanneret) signaient la même année le manifeste : une stylisation décorative du cubisme, qu’on retrouve également chez le peintre Juan Gris (il a également participé à la Section d’Or), certes figuratif, mais qui est tenté par l’abstraction, et qui prolonge l’inspiration du cubisme synthétique par la création de formes pures, d’un équilibre tout « classique ». L'œuvre et l'enseignement d'André Lhote expriment alors le même désir d'assagir la fragmentation cubiste en la soumettant par la synthèse aux lois de l'harmonie classique.
La notion même d’abstraction suppose que l’esprit s’abstrait et se dégage des formes sensibles, pour ne considérer qu’un monde purement spirituel, qui ne doit rien à l’aisthêsis. L’idée d’abstraction est apparue à la fin du XIXe siècle chez les historiens d’art (par exemple Aloïs Riegl, dans Questions de style. Fondements d’une histoire de l’ornementation, 1893), à propos de motifs décoratifs qui ne doivent plus rien à l’imitation des phénomènes, et obéissent à la seule loi de leur pure spontanéité, au seul mouvement de leur arabesque. Riegl y démontre rigoureusement, en se référant aux arts appliqués (tapisserie ou ornementation) que les formes obéissent à une dynamique qui leur est propre, ce qu’il nomme une « volonté d’art » (il faut entendre que les formes tendent, comme par une sorte de volonté propre, qui n’est pas la volonté de l’artiste, mais celle de la forme elle-même, vers leur épanouissement), qu’il existe, pour reprendre l’intitulé d’un livre d’un grand historien d’art qui se situe dans cet héritage, Henri Focillon, une Vie des formes (1934), indépendante des impératifs de l’imitation, qui suit des lois qui lui sont propres. Riegl montre ainsi comment un motif très ancien, très courant dans l’art de l’Egypte antique, qu’il nomme la « palmette », en vérité une fleur de lotus stylisée, connaît un développement extraordinaire, tout à fait indépendant de son modèle – la fleur de lotus – dans les arts mésopotamiens, phéniciens, perse, et se prolonge jusque que dans le motif en feuille d’acanthe de l’art grec ; un autre motif, celui du rinceau végétal, domine l’art l’ornemental de l’art grec et romain, et se prolonge jusque dans les rinceaux de l’ornementation byzantine, et même le décor floral de l’arabesque sarrasine. De même que la fleur de lotus ou la ramure obéissent aux lois du développement végétal, de même il existe une embryologie et une morphogénèse autonomes des motifs décoratifs (dans l’ornementation comme dans la musique, le motif l’emporte sur le modèle, et l’orientation esthétique n’est pas étrangère à cette substitution), palmette égyptienne ou rinceau grec. Le « motif » devient le module d’une variation ornementale, et comme pour le musicien un thème donné à partir duquel le créateur improvise une libre arabesque. Chaque « style », qui peut alors être compris comme la cohérence formelle du jeu ornemental dont le motif définit le thème, peut encore être considéré comme une sorte de syntaxe, grammaire et lexique, des structures et des formes qu’il est susceptible d’engendrer. L’abstraction naît ainsi naturellement de l’autonomisation de la forme, selon les lois « grammaticales » qui la gouvernent, d’une stylisation ou d’une schématisation qui tend à obéir à ses propres rythmes et symétries, et par là même à s’affranchir de toute servitude mimétique. C’est vers le dernier quart du XIXe siècle, que le mot de « grammaire » émigre du vocabulaire de la linguistique à celui des arts plastiques : Charles Blanc publie en 1867 la première édition d’un ouvrage qui aura une influence considérable sur les théories pointillistes d’un Seurat comme sur l’esthétique symboliste et fin-de-siècle, la Grammaire des arts du dessin, architecture, sculpture, peinture. Cette introduction de la « grammaire » dans la vie des formes connaît immédiatement une grande fortune : Edouard Guichard publie en 1872 une Grammaire de la couleur en trois volumes ; Jules Bourgoin publie en 1880 une Grammaire élémentaire de l’ornement, pour servir à l’histoire, à la théorie et à la pratique des arts et à l’enseignement ; Charles Blanc publie en 1881 une suite à son précédent ouvrage, intitulée Grammaire des arts décoratifs ; et Aloïs Riegl tente une synthèse dans sa Grammaire historique des arts plastiques (1897-98). Le succès de la formule témoigne de l’émancipation de la forme plastique du modèle sensible, et de l’ancienne dépendance qui la soumettait à l’imitation de la nature, tandis que l’œuvre revendique une autonomie formelle, formes et couleurs n’obéissant qu’aux lois de leur composition, par symétries, rythmes alternés et contrastes simultanés. Le cours que Vassily Kandinsky publie en 1926, alors qu’il enseigne au Bauhaus, Point, ligne, plan, doit beaucoup à cette idée d’une « grammaire » des formes (1) : il s’agit de définir les forces propres, sur le « Plan Originel », depuis le point qui constitue pour le peintre une sorte d’atome formel et coloré qui centre la composition, jusqu’à la ligne, qui naît de la force qui meut le point, sombre et froide quand elle est horizontale comme la mort, lumineuse quand elle est verticale et prend son élan vers la hauteur, ou bien encore diagonale, froide et bleue quand elle est descendante, chaude et rouge quand elle est ascendante. On devine par là que, si l’abstraction fait son deuil du monde sensible (du moins dans sa forme la plus radicale : dans l’entre-deux-guerres, les néo-cubistes se disaient à la fois abstraits et figuratifs), elle ne renonce pourtant pas à des effets sensibles, inventant alors, à la manière de Kandinsky, ce qu’on pourrait appeler une « esthétique de la forme pure ».
Cependant, si « abstrait », dans « art abstrait », signifie épuré de toute inscription dans le monde sensible, comment serait-il possible de parler d’une « esthétique abstraite » ? Dans un remarquable ouvrage devenu un classique, Kenneth Silver a montré combien les audaces des premières années du XXe siècle rentrent dans l’ordre après 1918 et revêtent volontiers l’apparence du conformisme tant politique qu’artistique (2). La modernité de l’après-guerre se réclame d’un cubisme « synthétique », c'est-à-dire dans le langage de l’époque « constructeur », qu’on oppose volontiers au cubisme « analytique » et « destructeur » de l’avant-guerre. L’abstraction semble alors avoir partie liée avec un académisme d’inspiration classique, en tous points opposé à l’orientation esthétique. Aussi a-t-elle particulièrement triomphé dans l’entre-deux-guerres, qui voit le triomphe d’un néo-néo-classicisme (pas seulement dans les arts dits « totalitaires », mais aussi dans l’art français : le Palais de Chaillot, qui remplace en 1937 l’ancien « Trocadéro », en est un bon témoin) et exprime de diverses façons le désir d’un « retour à l’ordre » susceptible de refouler les pulsions anarchiques qui auraient dominé avant-guerre (fauvisme, expressionnisme), et qu’on juge alors responsables de la catastrophe. Même l’école du Bauhaus, fondée par Walter Gropius en 1919 à Weimar (il est transféré à Dessau à partir de 1925), où enseigneront des maîtres de l’abstraction, tels Johannes Itten, Vassily Kandinsky ou László Moholy-Nagy, et malgré son engagement social (les nazis l’accuseront de « bolchevisme culturel » ; ils fermeront le Bauhaus en 1933), épure les formes pour les mettre en accord avec les standards de production, promouvant (architecture, mobilier et arts décoratifs) un style géométrique en grande partie issu du cubisme, bien éloigné de l’idée même de l’esthétique. La beauté de la forme se définit alors par l’excellence de sa fonctionnalité, et non par sa force de suggestion ni son impact sur l’imagination créatrice. Il est à nouveau possible de définir un concept du beau, et l’on rêve d’une alliance retrouvée entre l’art et la science.
Il y a là une contradiction – du moins apparente – qu’il nous faut penser : l’art abstrait se veut d’un côté à la pointe de l’art moderne ; mais, d’un autre côté, en cultivant des formes épurées et idéales, il semble repousser l’idée même d’une « esthétique », qui se trouve pourtant à l’origine de ce que nous nommons, depuis Baudelaire, la « modernité ». Comment l’art abstrait peut-il accomplir – c'est-à-dire à la fois parfaire et achever – l’idée de la modernité si son intellectualisme fait de lui, d’une part, un art anti-esthétique, et si d’autre part la modernité trouve précisément dans l’esthétique son essence et sa vérité ?
Que l’art moderne prenne le parti de l’esthétique – qui conçoit la beauté comme événement subjectivement vécu et non comme forme objectivement déterminée – cela est sensible dès le commencement, c'est-à-dire dès le moment où l’idée de la modernité prend conscience d’elle-même. Le contenu spécifique de cette notion est parfois dilué dans des généralités aux contours indécis. C’est ainsi que Denys Riout consacre en 2000 une assez copieuse étude intitulée Qu’est-ce que l’art moderne ? «(« Folio-Essais », Gallimard), dont le premier chapitre est consacré à l’art abstrait et qui passe en revue divers mouvements artistiques, en incluant les œuvres de l’art « contemporain ». La notion de modernité est pourtant moins imprécise, et plus rigoureusement limitée dans le temps.
Il faut attendre 1863 et la publication par Baudelaire du Peintre de la vie moderne, inclus dans le recueil des Curiosités esthétiques, pour que la notion de modernité acquière un contenu déterminé. Il y définit une poétique nouvelle, en rupture radicale avec le sentiment de la nature, le paysage romantique, le lyrisme de la confession amoureuse, le chant de la nostalgie ; bien au contraire, le poète moderne choisira d’habiter le « capitale infâme », prenant en horreur la « nature », il errera dans les grandes cités modernes avec leur cortège de misérables et d’abandonnés, aux épanchements de l’amour romantique il substituera le tragique et le sordide du spectacle nocturne de la prostitution, il se perdra dans la foule des grands boulevards où chacun est seul en compagnie de milliers d’autres. Dans ce texte inaugural, Baudelaire reprend une formule déjà esquissée dans les Salons, selon laquelle l’essence de la modernité, ou plus précisément de l’art moderne, se compose pour moitié du transitoire, du fugitif et du contingent, et pour moitié de l’éternel, sans qu’il soit dit nulle part comment le beau chez les modernes réussit à concilier deux attributs aussi contradictoires, à allier le transitoire avec l’éternel, le fugitif avec le permanent, et le contingent avec le nécessaire. Il appartient à l’alchimie poétique, cette « alchimie de la douleur » pour reprendre le titre de l’un des sonnets des Fleurs du Mal (n° 81 : « Par toi je change l’or en fer / et le paradis en enfer »), d’extraire la beauté mystérieuse des grandes cités modernes que l’industrie pollue, où s’amasse un prolétariat que l’exode rural contraint à chercher du travail dans des agglomérations labyrinthiques. A l’existence monotone et régulière de la campagne, où toute la vie s’écoule au sein d’un cercle relativement fermé – la communauté villageoise – au rythme de la nature et de la prière – la cloche de l’église – la ville moderne substitue une existence agitée et décentrée, parcourue d’un mouvement rapide, qui brasse des foules immenses au milieu des divertissements les plus divers, multipliant les probabilités de la rencontre et augmentant paradoxalement, par là même, le sentiment de solitude qui livre les hommes à eux-mêmes, prisonniers de leurs rêves et étrangement indifférents aux destins des autres. On pense au texte célèbre de Tocqueville, un auteur pourtant jamais cité par Baudelaire, qui prophétisait à la fin de La Démocratie en Amérique (tome I : 1835, tome II : 1840), la vaine hâte des foules modernes et la solitude de ceux qui se laissent emporter par le flot, tels des somnambules anesthésiés : « Je vois une foule innombrable d’hommes semblables et égaux qui tournent sans repos sur eux-mêmes pour se procurer de petits et vulgaires plaisirs, dont ils emplissent leur âme. Chacun d’eux, retiré à l’écart, est comme étranger à la destinée de tous les autres : ses enfants et ses amis particuliers forment pour lui toute l’espèce humaine ; quant au demeurant de ses concitoyens, il est à côté d’eux, mais il ne les voit pas ; il les touche et ne les sent point ; il n’existe qu’en lui-même et pour lui seul, et, s’il lui reste encore une famille, on peut dire du moins qu’il n’a plus de patrie » (chap. 37 : « Quelle espèce de despotisme les nations démocratiques ont à craindre »). La ville moderne est à la fois encombrée et déserte, et la foule qui la parcourt frénétique et solitaire. Que fait le peintre de la vie moderne ? « Ainsi il va, il court, il cherche. Que cherche-t-il ? A coup sûr, cet homme, tel que je l’ai dépeint, toujours voyageant à travers le grand désert d’hommes, a un but plus élevé que celui d’un pur flâneur, un but plus général, autre que le plaisir fugitif de la circonstance. Il cherche ce quelque chose qu’on nous permettra d’appeler la modernité ; car il ne se présente pas de meilleur mot pour exprimer l’idée en question. Il s’agit pour lui de dégager de la mode ce qu’elle peut contenir de poétique dans l’historique, de tirer l’éternel du transitoire » (3). Reprenant la même idée quelques lignes plus loin, Baudelaire écrit : « La modernité, c’est le transitoire, le fugitif, le contingent, la moitié de l’art, dont l’autre moitié est l’éternel et l’immuable » (4). L’avant dernière phrase qui conclut Le peintre de la vie moderne, qui fut en vérité un dessinateur plutôt qu’un peintre, Constantin Guys toujours nommé ici par ses initiales (plus exactement « M. G. », pour « Monsieur Guys ») pour préserver l’anonymat essentiel de celui qui entreprend de n’être qu’un œil, et comme un objectif toujours à l’affût de la « circonstance », reprend la même idée cette fois en forme d’épitaphe : « Il a cherché partout la beauté passagère, fugace, de la vie présente, le caractère de ce que le lecteur nous a permis d’appeler la modernité » (5). Et dans le premier chapitre du même essai (« I- Le Beau, la Mode et le Bonheur »), Baudelaire avançait déjà la même idée : « Le beau est fait d'un élément éternel, invariable, dont la quantité est excessivement difficile à déterminer, et d’un élément relatif, circonstanciel, qui sera, si l’on veut, tour à tour ou tout ensemble, l’époque, la mode, la morale, la passion » (6). L’idée se trouve au principe de la poétique baudelairienne, puisqu’on la trouvait déjà dans le compte rendu du Salon de 1846 : « Toutes les beautés contiennent, comme tous les phénomènes possibles, quelque chose d'éternel et quelque chose de transitoire, – d'absolu et de particulier. La beauté absolue et éternelle n'existe pas, ou plutôt elle n'est qu'une abstraction écrémée à la surface générale des beautés diverses. L'élément particulier de chaque beauté vient des passions, et comme nous avons nos passions particulières, nous avons notre beauté » (7).
En 1863, qui est aussi l’année du Salon des Refusés que les historiens considèrent souvent comme l’inauguration de l’art moderne (8), Baudelaire pense le destin de l’art moderne à partir du point exact où venait de s’achever la vaste construction de la philosophie hégélienne de l’art. Hegel avait parfaitement compris que l’art de la modernité devait se fonder sur des bases entièrement nouvelles, une très longue période – en vérité, selon Hegel, de l’origine de l’art jusqu’au début du dix-neuvième siècle – étant en train de s’achever, et cet achèvement rendant nécessaire la création d’un concept d’art entièrement nouveau. On sait que Hegel définissait l’œuvre d’art (telle qu’elle fut longtemps vivante, mais qui apparaissait désormais, en ce premier quart du XIXe siècle, comme « une chose du passé ») : la représentation sensible de l’Absolu. Seul est « absolu » l’esprit qui, en tant qu’il est rationnel, trouve dans la seule conscience de lui-même la source inépuisable de sa richesse, la vérité spéculative de l’infinité qui le fait autonome (absolvere = délier). C’est ce cercle de la rationalité – ce « connais-toi toi-même » de l’esprit que les Grecs ont pour la première fois posé au fondement de la philosophie – que l’artiste s’efforce de rendre sensible dans la forme d’un objet matériel. Ce pourquoi la beauté est objective, sa valeur est universelle et nécessaire, l’expression de l’Idée ne donnant jamais lieu chez Hegel à un quelconque expressionnisme : l’œuvre d’art a valeur de connaissance, elle est un moment nécessaire de l’histoire de la vérité, et non une catharsis, qui n’est jamais que la manifestation contingente d’une subjectivité individuelle (dans l’œuvre, ce n’est pas l’artiste, c’est l’art, c'est-à-dire l’Idée du Beau, qui s’exprime), l’œuvre d’art doit en quelque sorte matérialiser le spirituel, ou spiritualiser le matériau, et produire ainsi dans l’extériorité sensible la forme la plus adéquate au cercle de la conscience de soi, la plus apte à représenter l’autonomie de l’esprit. C’est pourquoi la belle forme, selon cette doctrine toute « classique », se réfère à elle-même par des lois de symétrie et de proportion qui se font échos, non pourtant dans l’immobilité morte du cristal (symétrie géométrique), mais au contraire dans la représentation de la vie organique, forme symbolique de la vie de l’esprit, que son développement dialectique déstabilise et met en marche (symétrie dynamique). La parfaite incarnation des dieux grecs, que leur beauté isole du monde, symbolise à merveille l’indifférence de l’esprit pour tout ce qui n’est pas issu de son propre fonds. Ce pourquoi l’art classique excelle dans la sculpture, plutôt que dans la peinture : la silhouette de la blanche statue se découpe sur le ciel grec, tel qu’en elle-même l’éternité la change, affranchie de l’architecture (à l’inverse de la sculpture égyptienne) et sans daigner accorder un regard au monde environnant. Aussi les dieux grecs sont-ils aveugles, jouissant de leur perfection et ignorant un monde nécessairement indigne de leur beauté. L’autarcie de la beauté grecque apparaît alors comme la réalisation sensible de l’autonomie de l’esprit, dont l’essence s’accomplit dans la figure circulaire de la conscience de soi, unique contenu de ce que Hegel nomme « le savoir absolu ». Or, c’est précisément ce modèle de parfaite beauté qui vient à faillir au seuil de la modernité : la froideur et la raideur du style néoclassique démontrent combien les modernes sont désormais incapables de retrouver et de recréer la grâce et la jeunesse immortelles qui font vivre si miraculeusement les dieux grecs. Pour la première fois dans l’histoire de l’art, le modèle classique n’est plus en mesure de régénérer l’inspiration, et l’esprit ne sait plus reconnaître dans une forme sensible la représentation de sa plus haute vérité spéculative, c'est-à-dire de son essence même. La raison en est que l’art romantique a conduit l’œuvre d’art jusqu’au point de sa dissolution dans le purement spirituel, et que l’image matérielle, abandonnée dans l’extériorité, n’est plus désormais en mesure de représenter adéquatement le mouvement de la pensée se connaissant elle-même. A l’unité merveilleuse – du fini et de l’infini, du matériau et du concept, du contenu et de la forme, du monde et de l’esprit – que la statuaire grecque avait réussie – un temps seulement – à réaliser, succède l’indépassable dualité de la prose du monde d’une part, abandonnée à la contingence et à la grisaille quotidienne, à l’indétermination d’une vie privée d’esprit, et du développement logique – et non plus esthétique ni phénoménologique – du pur concept d’autre part, qui seul hérite de la tâche d’accomplir le mouvement de réalisation de la vérité, non toutefois dans le monde, selon la tentative illusoire mais nécessaire de la phénoménologie, mais dans le royaume du pur esprit, c'est-à-dire dans les sciences logiques où l’esprit n’exerce sa dialectique qu’à l’égard de lui-même, demandant alors à la philosophie de penser l’unité encyclopédique du système des sciences effectives. C’est pour n’avoir pas connu cette radicale scission de la vérité et du monde, de l’essence et de l’existence, que don Quichotte, chevalier errant, en quête du Graal dans un monde sans Graal, tombe du sublime dans le ridicule.
Ce monde sans vérité – abandonné de Dieu, dont le royaume n’est plus de ce monde – monde des capitales modernes, des foules anonymes, monde de la machine et de la maîtrise technique de la terre, monde de la richesse qui se voue corps et âme au culte du présent, monde de l’immanence voué à l’affirmation du seul sens de la Terre –le Ciel a perdu toute signification pour les hommes – où pourrions-nous donc en trouver la beauté ? Il faut en effet une radicale métamorphose de l’idée même de l’art pour inventer une beauté moderne, beauté de l’apparence qui n’est qu’apparence, et non plus l’ombre de l’Idéal (l’idée étant désormais rigoureusement inconciliable avec le sensible), du phénomène sans essence, de la simple diaprure des apparences, du miroitement du voile de Maya, de la surface qui nous enseigne, selon Nietzsche, à devenir « superficiels par profondeur » (9).
Tel est très exactement le pari esthétique dont Baudelaire relève le défi. Lui aussi commence à penser l’art sur les ruines du classicisme et du beau idéal, et en prenant pour point de départ le constat d’échec du néoclassicisme, ce vain pastiche de la beauté grecque à jamais perdue. Dans une lettre qu’il écrit en 1838 à son beau-père le colonel Aupick, Baudelaire – il n’a que dix-sept ans – se permet de critiquer le style héroïque que prisait sans doute celui auquel il ne pardonnera jamais d’avoir osé prendre la place du père : « Tous les tableaux du temps de l'Empire, qu'on dit fort beaux, paraissent souvent si réguliers, si froids ; leurs personnages sont échelonnés comme des arbres ou des figurants d'opéra. Il est sans doute bien ridicule à moi de parler ainsi des peintres de l'Empire qu'on a tant loués ; je parle peut-être à tort et à travers ; mais je ne rends compte que de mes impressions » (10). Le naturel vertueux de l'antiquité évoque maintenant les poses affectées et l'artifice d'un décor d'opéra. Malgré les réserves sans doute hypocrites qu'il émet à l'adresse de son beau-père, qui n'admettait pas qu'on parle sans respect des choses militaires, Baudelaire conservera l'impression de son adolescence et ne modifiera pas son jugement. Dans sa relation de l'Exposition universelle de 1855, section des beaux-arts, Baudelaire dénonce ce qu'il y a de truqué dans cet art pourtant si soucieux de proclamer sa vertu et son authenticité : « Quand David, cet astre froid, et Guérin et Girodet, ses satellites historiques, espèces d'abstracteurs de quintessence dans leur genre, se levèrent sur l'horizon de l'art, il se fit une grande révolution » (11). Il s'agissait, précise plus loin Baudelaire, « de ramener le goût français vers le goût de l'héroïsme ». Mais il s'agit d'un héroïsme de théâtre et de figures de carton, d'un monde artificiel et sans vie : « Je me rappelle fort distinctement le respect prodigieux qui environnait au temps de notre enfance toutes ces figures, fantastiques sans le vouloir, tous ces spectres académiques [...] Tout ce monde, véritablement hors nature, s'agitait, ou plutôt posait sous une lumière verdâtre, traduction bizarre du vrai soleil » (12). C'est ainsi que l'idéal néoclassique de l'école davidienne apparaît aux yeux de Baudelaire comme une dépouille vide, un accessoire de théâtre. Dans un article de 1852, intitulé « L'École païenne » (repris avec variantes en 1857 dans « Quelques caricaturistes français »), Baudelaire se déclare enthousiaste pour une série de gravures par Daumier, intitulée Histoire ancienne, qui caricaturent les héros de l'antiquité en vieux acteurs misérables et ridiculement emphatiques : « Daumier s'est abattu brutalement sur l'antiquité et sa mythologie, et a craché dessus. Et le bouillant Achille, et le prudent Ulysse, et la sage Pénélope, et Télémaque ce grand dadais, et la belle Hélène, qui perdit Troie, et la brûlante Sapho, cette patronne des hystériques, et tous enfin nous apparurent dans une laideur bouffonne qui rappelait ces vieilles carcasses d'acteurs classiques qui prennent une prise de tabac dans les coulisses. Eh bien! J'ai vu un écrivain de talent pleurer devant ces estampes, devant ce blasphème amusant et utile. Il était indigné, il appelait cela une impiété. Le malheureux avait encore besoin d'une religion » (13). Nous ne saurons pas si cet « écrivain de talent » n'est pas Baudelaire lui-même, portant le deuil du sublime, d'une grandeur devenue sans réalité. Douze ans plus tard, en 1864, dans son opéra bouffe La Belle Hélène, Jacques Offenbach met en scène les dieux de l'Olympe comme autant de bourgeois ventripotents et libidineux, transposition énorme et désopilante du sublime antique dans la vénalité débridée du Second Empire. Baudelaire aime à citer un vers qu'il est bien le seul à dire célèbre (il serait d'un certain Berchoux, ou de Bernard Clément...) : « Qui nous délivrera des Grecs et des Romains? » (14). Qui nous délivrera de la nostalgie de l'Idéal ? En vérité, le style néoclassique inspiré de David, subtilement dépravé par Ingres dans le sens du phantasme, se prolongera et viendra mourir, après avoir été contaminé par le goût romantique du pittoresque, dans le style néo-grec d'un Gérôme (Baudelaire consacre quelques pages à cette école dans son Salon de 1859). Depuis que l'on sait que les temples antiques étaient coloriés de couleurs vives, depuis que la curiosité ethnologique et le goût du folklore se sont appliqués à la Grèce ancienne, la Grèce a cessé d'être un monde idéal pour devenir une société historique. Dans Le combat de coqs (1847) par Gérôme, scène supposée de la vie quotidienne qui se déroule dans une cour sous les yeux d'une adolescente et d'un adolescent, la première intéressée par le second et le second intéressé par les coqs, le peintre, écrit Baudelaire, « essaie de surprendre notre curiosité en transportant ce jeu dans une espèce de pastorale antique » (15). Nous sommes alors bien loin de la Grèce de Winckelmann, non pas dans l'utopie de l'Idéal mais dans les rencontres pittoresques de la vie quotidienne, c'est-à-dire dans la banalité fallacieusement embellie par l'art.
Pourtant, si l’idéal grec, si le modèle classique sont maintenant impuissants à nous délivrer le canon de la beauté, à nous révéler le secret de la « divine proportion », où trouverons-nous la beauté ? On cite souvent le sonnet n° 17 des Fleurs du Mal, intitulé « La Beauté » pour rattacher abusivement la poétique baudelairienne à l’idéal néoclassique. On ne saurait faire un contresens plus profond, se rendant par là même incompréhensible l’esthétique de la modernité, si radicalement nouvelle, développée dans Le Peintre de la vie moderne. Quand on lit le grand recueil poétique de Baudelaire, celui qui le consacre véritablement en créateur de la modernité poétique, il faut toujours garder à l’esprit que les 126 poèmes qui le composent sont rigoureusement numérotés, et qu’ils se succèdent en six parties certes fort inégales : « Spleen et idéal » (85 poèmes), « Tableaux parisiens » (18 poèmes), « Le Vin » (5 poèmes), « Fleurs du mal » (9 poèmes), « Révolte » (3 poèmes) et enfin « La Mort » (6 poèmes), sans compter les six pièces condamnées (5 appartenaient à « Spleen et Idéal » et 3 à « Tableaux parisiens »). Le sonnet « La Beauté » est en effet consacré à l’idéal classique de la beauté, dont l’éternité fait toute la substance, la perfection toute l’inhumanité et la sublimité toute la stérilité :
Je suis belle, ô mortels! comme un rêve de pierre,
Et mon sein, où chacun s'est meurtri tour à tour,
Est fait pour inspirer au poète un amour
Éternel et muet ainsi que la matière.
Je trône dans l'azur comme un sphinx incompris;
J'unis un cœur de neige à la blancheur des cygnes;
Je hais le mouvement qui déplace les lignes,
Et jamais je ne pleure et jamais je ne ris.
Les poètes, devant mes grandes attitudes,
Que j'ai l'air d'emprunter aux plus fiers monuments,
Consumeront leurs jours en d'austères études;
Car j'ai, pour fasciner ces dociles amants,
De purs miroirs qui font toutes choses plus belles:
Mes yeux, mes larges yeux aux clartés éternelles!
Une telle muse pétrifiée n’inspire que « d’austères études », arithmétique du nombre d’or ou théorie des proportions, elle est incapable d’amour ni de vie : son sein de marbre n’est pas nourricier (« mon sein où chacun s’est meurtri tour à tour »), l’idole classique est privé de mouvement (« Je hais le mouvement »), sans larme, sans rire (« Et jamais je ne pleure et jamais je ne ris »), immortelle parce que déjà morte – son éternité n’inspire au poète que le silence de la matière sans esprit : « Eternel et muet ainsi que la matière » – ce sphinx sans âme laisse entrevoir le vide qui le hante par son regard sans intériorité (« De purs miroirs »), tel celui des dieux aveugles qu’évoquait Hegel au sujet de l’art classique. L’éternité qui fait toute la beauté classique, auquel l’art néoclassique s’efforce en vain de communiquer la vie, n’est que l’éternité morte, une éternité de néant, immortalité ou continuité illimitée du temps plutôt qu’éternité. A cet idéal stérile que la modernité réfute, dont l’échec du néoclassicisme démontre la parfaite vacuité, le poète oppose alors, dans les cinq poèmes suivants, tous consacrés au même thème, une variation qui constitue une sorte de phénoménologie de la beauté chez les modernes. Le sonnet 18 oppose aux grâces vulgaires du type gracieux et fade de la beauté romantique (les « beautés de vignette », les illustrations de Gavarni pour les journaux de mode, pittoresques et sagement licencieuses), la beauté criminelle de Lady Macbeth (« C’est vous, Lady Macbeth, âme puissante au crime »), celles des héroïnes tragiques d’Eschyle (Electre, ou Clytemnestre), et la beauté sculpturale et torturée de Michel-Ange (« Ou bien toi, grande nuit, fille de Michel-Ange »). Au regard vide du sphinx classique, Baudelaire oppose donc le regard ardent du désir infini et de la passion farouche. Seul peut-être beau le visage que brûle le désir. Le sonnet 19, l’un des plus curieux des Fleurs du Mal, imagine une géante voluptueuse dont le corps prend les dimensions d’un paysage où le poète enfant peut s’ébattre, jouer et dormir (« Dormir nonchalamment à l’ombre de ses seins / Comme un hameau paisible au pied d’une montagne »). La beauté devient alors l’objet d’une rêverie à la fois érotique et enfantine, le fantasme sexuel d’un corps devenu monde où le poète peut se réfugier et disparaître, tel le nouveau-né dans les bras de la mère. Le sonnet 20, « Le Masque », est consacré à une statue d’Ernest Christophe (musée d’Orsay) qui avait inspiré à Baudelaire un long développement dans son Salon de 1859 (16), et dont l’ambivalence avait su troubler le poète. Une femme nue et robuste porte devant elle un masque souriant, gracieux et coquet (« un visage souriant et mignard, un visage de théâtre », écrit Baudelaire dans son Salon), assez bien ajusté pour qu’on puisse le prendre, sous un certain point de vue, pour son visage même ; mais le véritable visage se découvre quand on tourne autour de la statue : les traits grossiers, la tête violemment rejetée en arrière, elle se pâme, de douleur ou de jouissance, entre l’orgasme du plaisir ou le spasme de l’agonie. Ainsi le masque de convention que la femme compose en société (assez semblable aux « beautés de vignettes » auxquelles faisait allusion le sonnet 18) dissimule les traits d’une bacchante bestiale ou d’une malade à l’article de la mort : « En faisant un pas de plus à gauche ou à droite, vous découvrez le secret de l'allégorie, la morale de la fable, je veux dire la véritable tête révulsée, se pâmant dans les larmes et l'agonie. Ce qui avait d'abord enchanté vos yeux, c'était un masque, c'était le masque universel, votre masque, mon masque, joli éventail dont une main habile se sert pour voiler aux yeux du monde la douleur ou le remords ». La force de l’allégorie consiste en ce qu’elle démontre la fièvre du désir sous l’apparence de la santé, et les larmes de la douleur sous le sourire de la courtoisie (c’est à cette seconde signification seulement que le poème des Fleurs du mal est sensible) :
Et, regarde, voici, crispée atrocement,
La véritable tête, et la sincère face
Renversée à l'abri de la face qui ment.
Pauvre grande beauté ! le magnifique fleuve
De tes pleurs aboutit dans mon cœur soucieux:
Ton mensonge m'enivre, et mon cœur s'abreuve
Aux flots que la Douleur fait jaillir de tes yeux !
Le dernier poème qui clôt ce cycle consacré à la beauté, le n° 21 intitulé « Hymne à la beauté », est sans doute celui qui exprime le plus profondément l’esthétique du poète. Loin d’être muette, blanche, immobile comme le sphinx de la perfection classique, la beauté baudelairienne, la plus vénéneuse des fleurs du mal, est puissamment érotique : son regard enivre comme le vin, ses baisers versent un philtre fatal, elle répand un parfum qui fait défaillir. Elle n’évoque plus une divinité inaccessible, mais plutôt l’idole de la prostitution, pour les faveurs de laquelle ses amants vont jusqu’au crime :
De tes bijoux l’Horreur n’est pas le moins charmant,
Et le Meurtre, parmi tes plus chères breloques,
Sur ton ventre orgueilleux danse amoureusement.
A la figure éternelle et surhumaine de la beauté classique, Baudelaire oppose donc une beauté vénale et peut-être diabolique, qui insuffle à la platitude de la vie moderne le charme exotique, étrange et bizarre (« le beau est toujours bizarre ») des fantasmes du désir et des soupirs de la jouissance :
Que tu viennes du ciel ou de l'enfer, qu'importe,
O Beauté! monstre énorme, effrayant, ingénu!
Si ton œil, ton souris, ton pied, m'ouvrent la porte
D'un Infini que j'aime et n'ai jamais connu?
De Satan ou de Dieu, qu'importe? Ange ou Sirène,
Qu'importe, si tu rends, – fée aux yeux de velours,
Rythme, parfum, lueur, ô mon unique reine! –
L'univers moins hideux et les instants moins lourds?
Les poèmes suivants approfondissent cette dimension purement érotique de la beauté moderne : « Parfum exotique » (22), « La Chevelure » (23-25), « Sed non statiata » (26-27), « Le serpent qui danse » (28). ). Le poème 29 annonce une rupture dans cette série : Une Charogne. Du « rêve de pierre », du « sphinx incompris » de la beauté classique à la grande Prostituée, préfigure de la Salammbô de Flaubert, des Salomé de Gustave Moreau ou d’Oscar Wilde, qui est aussi celle de Richard Strauss, de l’Hérodiade de Mallarmé, la beauté s’est faite chair, la magicienne sans doute satanique qui endort la douleur dans les bras de la volupté, telle qu’on la voit parader la nuit, idole fardée, dans le halo des réverbères, « le regard du démon embusqué dans les ténèbres, ou l’épaule de Messaline miroitant sous le gaz » (17), appâtant le micheton sur les trottoirs de « l’énorme catin », de la « capitale infâme » (18). De l’azur grec où se dessinait sa silhouette blanche, Baudelaire a fait descendre la beauté dans l’étalage de la marchandise qui, en chaque rue de la grande cité, excite le désir des hommes.
Ainsi la révolution accomplie par Baudelaire fait-elle descendre la beauté poétique du ciel platonicien des essences éternelles sur la terre boueuse des grandes capitales, des métropoles de la modernité, du royaume des formes pures au théâtre fantastique de la convoitise. On comprend alors en quel sens la poésie de la modernité sera nécessairement une célébration du fugace et du contingent, l’instantané aléatoire d’une rencontre dans le sein de la foule toujours mouvante, toujours passante. Comment, pourtant, en faisant ainsi redescendre la beauté du ciel sur la terre, en découronnant le poète dont l’auréole traîne dorénavant dans la boue des boulevards (19), pourrait-on ne pas détruire la magie du poème, dérivée du poète-mage tel que le romantisme l’avait consacré ? Si le beau n’est qu’une anecdote circonstancielle, à quoi bon encore lui consacrer le monument du poème ? Il faut bien que la contingence, dans l’interprétation désormais esthétique de la beauté, ne soit pas une simple banalité, mais une rencontre, ce que Baudelaire nomme une « circonstance » (20), digne encore d’être magnifiée par l’invocation poétique. Flaubert, qui écrit en prose, apprend à se résigner à la « prose du monde » (Hegel), et c’est même là toute la leçon de son éducation sentimentale (démarche qui conduit pourtant à la renaissance paradoxale d’une nouvelle poésie). Mais Baudelaire, qui veut que ne soit pas négligé le ministère du poète, continue à composer des poèmes, et ne peut, sans se nier lui-même, résumer toute sa poétique à l’évocation de la pure et simple banalité. Il s’agit donc de savoir, dans un monde voué à l’immanence, où nul ne peut plus s’affranchir de l’anneau du temps qui passe, quel événement peut encore être digne du poème, échapper à l’insignifiance d’une vie désormais consacré au culte de la mode éphémère (un chapitre du Peintre de la vie moderne est consacré à la mode : « I- Le Beau, la Mode et le Bonheur »), et s’élever au-dessus du quotidien, être érigée dans la dimension éternelle du mythe. Cette mythologisation de l’aléatoire, ou transfiguration poétique de la contingence, Baudelaire la nomme « allégorie ». L’allégorie est la figure fondamentale de la poétique de la modernité.
« L'allégorie prend en vous des proportions à vous-même inconnues ; nous noterons, en passant, que l'allégorie, ce genre si spirituel, que les peintres maladroits nous ont accoutumés à mépriser, mais qui est vraiment l'une des formes primitives et les plus naturelles de la poésie, reprend sa domination légitime dans l'intelligence illuminée par l'ivresse » (21).
Paris change! mais rien dans ma mélancolie
N'a bougé ! palais neufs, échafaudages, blocs,
Vieux faubourgs, tout pour moi devient allégorie,
Et mes chers souvenirs sont plus lourds que des rocs (22).
Qu’est-ce que Baudelaire nomme une « allégorie » ? Quelque chose comme une sensation transfigurée dans le mythe. Sensation : l’allégorie baudelairienne est en effet esthétique et non intellectuelle. Elle naît d’une rencontre singulière ; « cette rose que je vois » et non la rose en général. Pourtant cette sensation est une sensation doublement singulière, en ce sens que toutes les sensations sont sans doute singulières, mais qu’elles ne sont pas toutes esthétiques. La singularité de la sensation esthétique c’est qu’elle entre en résonance avec le Mythe qui lui donne une dimension universelle. Cette résonance, ou plus exactement cette correspondance mythique qui a pouvoir de généraliser le singulier tout en conservant la singularité des qualités esthétiques, se fait entendre quand le singulier sensible fait écho, par le souvenir, aux images profondes qui sommeillent au fond de la mémoire. La correspondance est esthétique, parce que la sensation, d’une part, est nécessairement singulière, mais le souvenir de son côté est également singulier, se référant à un moment unique, daté, de notre passé. Les images qui persistent en notre mémoire ne sont pas des images isolées, elles se trouvent au centre de notre histoire et entrent elles-mêmes en résonance avec un grand nombre de nos souvenirs. C’est pourquoi l’objet de la sensation, tout en demeurant singulier, entre en « correspondance » avec d’autres objets tout aussi singuliers qui lui sont surimposés par une sorte de « métaphore », et par cet effet de sens, s’élèvent, si du moins ils rencontrent un poète qui soit capable de réussir cette transmutation, jusqu’à la généralité du Mythe. Cette collision de deux singularités engendre énigmatiquement une signification allégorique capable de s’élever au général ; et l’on peut dire de la même façon que de la collision, ou de la correspondance de deux événements datés, naît une figure qui peut prétendre à l’éternel. On peut comprendre en effet que la correspondance de deux singularités ne saurait être elle-même singulière, car elle ne pourrait en ce cas réunir les deux singularités qu’elle met en correspondance, puisque chacune d’elle ne renverrait qu’à elle-même. C’est pourquoi la correspondance de deux singularités s’ouvre nécessairement au général (ce en quoi se réunit le singulier sensible), et de deux temporalités à l’éternel (ce en quoi se rassemble la dispersion temporelle). Ainsi se trouve résolue par Baudelaire l’une des grandes énigmes de la troisième Critique, à savoir l’indétermination en laquelle se perd l’objet du jugement esthétique, qui reste le grand inconnu de cette équation. La difficulté à le cerner provient évidemment de ce qu’il s’agit d’un objet imaginaire, l’imagination prenant les devants dans le schématisme sans concept du jugement réfléchissant, et l’entendement cherchant à énoncer à sa suite la règle de la métamorphose des formes. Pourtant, cet objet imaginaire est tout aussi bien un objet mémoriel, qui fait écho aux anciens souvenirs, « en une ténébreuse et profonde unité ». Il résonne dans l’espace intérieur où se tisse le poème. Kant laissait sans solution la question de l’universalité objective du jugement esthétique, ou plutôt la repoussait sans concession. La seule universalité pensable à laquelle puisse accéder le jugement esthétique, est une universalité subjective, par le jeu de l’imagination et de l’entendement, c'est-à-dire par le génie créateur stimulé par la rencontre esthétique. Toutefois, ce jeu pourrait n’être qu’un jeu d’associations qui ne renverraient qu’à l’histoire personnelle de celui qui les fait naître (allégorie subjective), et dont la production n’intéresserait en conséquence que le psychanalyste, mais non le poète ni l’artiste en général. Pour que l’œuvre produite soit géniale, et non simplement cathartique, il faut encore que l’imagination donne lieu à un objet déterminé, qui possède la propriété contradictoire d’être à la fois absolument singulier et source d’un jeu de correspondances qui l’ouvre au général (allégorie objective). Par exemple ce Cygne (la majuscule est toujours chez Baudelaire le « signe » de l’allégorie, bien que cela ne doit pas être entendu de façon trop mécanique, et soumis à vérification) est à la fois cet oiseau dérisoire rencontré effectivement dans le Paris dévasté d’Haussmann, mais aussi le poète égaré dans les décombres de la modernité, tel cet oiseau incapable de prendre son envol, « Comme les exilés, ridicule et sublime », et par cette généralisation mythique allégorise tout le décor qui l’environne, faisant de la mère livrée au vainqueur après la mort du père une Andromaque en pleurs, et de l’exilé sous le ciel de Paris la figure mythique d’un Ovide ressuscité, et de la poétique mélancolique des Tristes :
Je vois ce malheureux, mythe étrange et fatal,
Vers le ciel quelquefois, comme l'homme d'Ovide,
Vers le ciel ironique et cruellement bleu,
Sur son cou convulsif tendant sa tête avide,
Comme s'il adressait des reproches à Dieu!
Andromaque et Ovide : l’antiquité vainement invoquée par les spectres lunaires du néoclassicisme trouve une vie nouvelle en s’incarnant mythiquement dans les « circonstances » de la vie moderne ressuscitée par la métaphore du souvenir (Andromaque livrée à Pyrrhus, telle le veuvage de la mère profané par le beau-père Aupick). L’allégorie baudelairienne naît ainsi du phénomène rencontré qui réactualise par un jeu du hasard une image ancienne, qui, parce qu’elle est ancienne, est nécessairement la marque d’une douleur, d’une déchirure (on ne se souvient que de ce qu’on ne sait pas oublier). L’allégorie pathétise ainsi le paysage du présent, transfigurant le phénomène dans sa plus littérale singularité en hiéroglyphe d’une blessure inguérissable qui hante l’imaginaire du poète, mais qui trouve ainsi par métaphore un équivalent objectif pour l’incarner, et par la force de cette équivalence, ou « hypotypose » (Kant, Critique de la faculté de juger, § 59), réussit à donner une envergure générale à ce qui serait autrement demeuré dans le secret impartageable de la subjectivité. Alchimie de la Douleur : transfigurer le phénomène sensible en allégorie de l’inoubliable. Et c’est bien ainsi que le génie « retrouve à volonté » les déchirements de l’enfance (23), les premières blessures laissant dans l’âme une cicatrice ineffaçable, qui projette son ombre sur les « circonstances » du voyage bien hasardeux de la vie. En ressuscitant l’Irrémédiable (24), qui ne passe pas et toujours demeure présent, le poète transfigure la rencontre aléatoire, l’instantané qui prélève la figure sur le fugitif, dans le mythe éternel de l’irrémédiable : « Ainsi, dans l'exécution de M. G. se montrent deux choses : l'une, une contention de mémoire résurrectionniste, évocatrice, une mémoire qui dit à chaque chose: "Lazare, lève-toi!"; l'autre, un feu, une ivresse de crayon, de pinceau, ressemblant presque à une fureur. C'est la peur de n'aller pas assez vite, de laisser échapper le fantôme avant que la synthèse n'en soit extraite et saisie » (25).
On comprend ainsi que la poésie ne consiste plus dans l’essor qui porte l’âme du sensible à l’intelligible – l’albatros poétique ne réussit plus à prendre son envol, et les hommes d’équipage se moquent, non sans raison, de cette poétique du sublime qui patauge en vérité dans la boue de la réalité – mais inversement dans la chute, ou du moins dans l’incarnation aléatoire et souvent dérisoire, « ridicule et sublime », de l’empreinte profonde et cuisante du souvenir dans tel objet singulier qui se donne soudain à nos regards. La correspondance, source de toute allégorie, est ainsi constituée par cette rencontre d’une double singularité, l’une mémorielle, religieusement douloureuse (le religieux vient ici peut-être de la répétition rituelle et grave célébrée par la réminiscence poétique), l’autre fugitive et circonstancielle. La correspondance, source de toute poésie, naît de la coïncidence hasardeuse de la « vie antérieure » (Les Fleurs du Mal, n° 12), solennelle et sacrée, avec la circonstance présente, contingente et fugitive. Ainsi pouvons-nous comprendre la formule antinomique qui énonce l’essence de la modernité dans les arts : « La modernité, c’est le transitoire, le fugitif, le contingent, la moitié de l’art, dont l’autre moitié est l’éternel et l’immuable ».
Cette correspondance, qui fait naître le mythe ou l’allégorie à l’intersection de deux singularités, est nécessairement fugace. L’événement poétique scintille dans l’instantané, et le poète est comme un voleur de feu, un voleur d’étincelles, il est l’orpailleur du fleuve Temps. Le surgissement de la correspondance, qui compose cette « circonstance » à l’affût de laquelle est toujours le regard de l’artiste moderne, est un événement rare et peu probable ; aussi fallait-il ce grand concours d’hommes et de femmes pressés, courant en tous sens, qui fait le spectacle continu des grandes capitales, pour nous révéler l’éventualité d’une telle occasion d’art. Le célèbre sonnet « A une passante » (Les Fleurs du Mal, n° 43) fait ainsi paraître soudain le veuvage de la mère, ineffaçablement gravé dans l’esprit inconsolé de l’enfant, à jamais révolté que la mère se console avec le colonel Aupick, sous la forme d’une idole de l’Irrémédiable surgie miraculeusement du fleuve toujours mouvant de la foule : « Longue, mince, en grand deuil, douleur majestueuse / Une femme passa, d’une main fastueuse / Soulevant, balançant le feston et l’ourlet ». Démarche chaloupée de la Femme Fatale, semblable au balancement de la frégate sur les flots : « Elle s’avance, glisse, danse, roule avec son poids de jupons brodés qui lui sert à la fois de piédestal et de balancier […] Elle a sa beauté qui lui vient du Mal, toujours dénuée de spiritualité, mais quelquefois teintée d’une fatigue qui joue la mélancolie » (26). Cette résurrection d’une mère, que son remariage a profanée, est infiniment peu probable, et l’apparition a quelque chose de surnaturel, comme celle d’une revenante surgie des profondeurs de la mémoire, fantôme surnaturel qu’il faut saisir en un instant avant qu’il ne se dissipe : « Ainsi, dans l'exécution de M. G. se montrent deux choses: l'une, une contention de mémoire résurrectioniste, évocatrice, une mémoire qui dit à chaque chose: "Lazare, lève-toi!"; l'autre, un feu, une ivresse de crayon, de pinceau, ressemblant presque à une fureur. C'est la peur de n'aller pas assez vite, de laisser échapper le fantôme avant que la synthèse n'en soit extraite et saisie » (27). Ce pourquoi le peintre de la vie moderne, « M. G. », cet artiste de la circonstance, n’est nullement un peintre, mais plutôt un dessinateur qui n’emploie la couleur que pour relever le trait incisif du dessin, empreinte quasi instantanée de la rencontre impressionnante qui enfonce le sceau brûlant de l’Allégorie dans l’âme impressionnable de l’enfant-poète.
On savait depuis le XVIIIe siècle, c'est-à-dire depuis la naissance du regard proprement esthétique, que le dessin ou l’esquisse sont des arts de l’urgence. Diderot, lassée des grâces trop complaisantes et fades de l’art Régence ou Louis XV, à la recherche d’une poétique nouvelle, de l’énergie, du barbare et du sauvage, vantait la « fureur » qui anime le trait du grand dessinateur, et préférait l’inachevé de l’esquisse à la finition trop parfaite du tableau d’académie : « Les esquisses ont communément un feu que le tableau n’a pas. C’est le moment de chaleur de l’artiste, la verve pure, sans aucun mélange de l’apprêt que la réflexion met à tout ; c’est l’âme du peintre qui se répand librement sur la toile. La plume du poète, le crayon du dessinateur habile, ont l’air de courir et de se jouer » (28). Ce feu du dessin, qui exprime la joie de créer, non de mettre le point final à ce qui est déjà fait, cet enthousiasme de l’esquisse qui est une apologie du présent intensément vécu, est encore selon Diderot le trait caractéristique de l’époque « moderne » : « « Un peintre ancien a dit qu’il était plus agréable de peindre que d’avoir peint. Il y a un fait moderne qui le prouve : c’est celui d’un artiste qui abandonne à un voleur un tableau fini pour un ébauche » (29). Le véritable modèle du peintre, selon Diderot, n’est pas le modèle « mannequiné » qui pose fastidieusement dans l’atelier, mais ce qu’il appelle fort précisément « les phénomènes de l’instant » que l’œil doit saisir dans le mouvement de leur passage, la pose ne durant alors qu’un centième de seconde, que dont le crayon du dessinateur doit tenter de fixer d’un trait, et plus difficilement encore le pinceau du peintre. C’est ainsi qu’à propos d’une marine de Joseph Vernet, un tableau il est vrai et non une esquisse, Diderot écrit : « Allez à la campagne, tournez vos regards vers la voûte des cieux, observez bien les phénomènes de l’instant, et vous jurerez qu’on a coupé un morceau de la grande toile lumineuse que le soleil éclaire, pour le transporter sur le chevalet de l’artiste » (30). Et ce sont bien ces « phénomènes de l’instant » que le peintre de la vie moderne, selon Baudelaire, prélève sur le flux mouvant des apparences et élève à la solennité de l’Allégorie.
Cet art de l’instantané, de la circonstance prise sur le vif, est aussi, et nécessairement, un art de l’énergie, du coup d’œil infaillible, de l’instinct plutôt que du calcul : « un génie qui dérive plutôt de l’instinct que de l’étude » (31). Delacroix, le plus grand peintre de son temps selon Baudelaire, qui sait donner forme aux fantasmagories du désir et de l’imagination, sait aussi combien le dessin est un art de l’instantané qui réussit d’un trait à éterniser le fugace : « Il disait une fois à un jeune homme de ma connaissance : ‟Si vous n’êtes pas assez habile pour faire le croquis d’un homme qui se jette par la fenêtre, pendant le temps qu’il met à tomber du quatrième étage sur le sol, vous ne pourrez jamais produire de grandes machines”. Je trouve dans cette énorme hyperbole la préoccupation de toute sa vie, qui était, comme on le sait, d’exécuter assez vite et avec assez de certitude pour ne rien laisser s’évaporer de l’intensité de l’action ou de l’idée » (32). Si bien que l’on peut dire, de l’œuvre du peintre de la modernité, qu’elle n’est paradoxalement finie qu’à la condition de n’être pas finie. L’oxymore de la modernité gît dans le secret d’une « ébauche parfaite », achevée et de parfaite finition, un inachevé auquel on ne peut plus rien ajouter ni retrancher, au prix d’en détruire l’effet. C'est ainsi que « la méthode » du peintre de la vie moderne a cet « avantage incomparable, qu’à n’importe quel point de son progrès, chaque dessin a l’air suffisamment fini ; vous nommerez cela une ébauche si vous voulez, mais l’ébauche parfaite » (« parfaite » est ici mis pour « achevée ») (33). Il y a là comme un équivalent pictural d’une règle qui vaut également pour l’art poétique, et qui conçoit l’artiste dans le temps de la création dans une situation semblable à celle du duelliste : « Il s’établit alors un duel entre la volonté de tout voir, de ne rien oublier, et la faculté de mémoire qui a pris l’habitude d’absorber vivement la couleur générale et la silhouette, l’arabesque du contour » (34). Le soir, sous la clarté de la lampe, M.G. reprend les esquisses du jour et leur donne les couleurs de la vie, « s’escrimant » pour que l’esquisse schématique, « synthétique », prenne vie et se fasse chair, « s’escrimant avec son crayon, sa plume , son pinceau, faisant jaillir l’eau du verre au plafond, essuyant sa plume sur sa chemise, pressé, violent, actif, comme s’il craignait que les images ne lui échappe, querelleur quoique seul, et se bousculant lui-même » (35). Dans le poème n° 87 des Fleurs du Mal étrangement intitulé « Le Soleil », Baudelaire compare également son art à l’escrime hasardeuse toujours aliénée à la circonstance : « Le long des vieux faubourgs […] / Je vais m’exercer seul à ma fantasque escrime / Flairant dans tous les coins les hasards de la rime / trébuchant sur les mots comme sur les pavés / Heurtant parfois des vers depuis longtemps rêvés » (36). Et dans « Le Confiteor de l’artiste », exaspéré par l’insensibilité et l’immuabilité de l’immense nature, desquelles peuvent seuls nous sauver les hasards de la rencontre, Baudelaire conclut ce poème en prose par cette phrase : « L’étude du beau est un duel où l’artiste crie de frayeur avant d’être vaincu » (37). C’est bien ainsi, dans ce jeu mortel où l’imagination affronte l’immensité vide du réel, que l’artiste doit tenir le crayon ou le pinceau, comme le bon escrimeur relève le défi de la mort et empoigne fermement sa lame.
M. G. n’est pas le peintre de la modernité, il est le peintre de la « vie moderne », et rien ne définit mieux son art que la vivacité de son trait, l’extrême mobilité de sa main, l’ingénuité de son œil, la fulgurance de son instinct, la qualité encore sauvage et barbare de la force vitale qui l’anime. Cet art de l’esquisse, plein de verve, de « fureur » et d’intensité, est en vérité une expression exaltante de la pulsion de vie. Le peintre de la vie moderne est d’abord et avant tout un grand vivant. Son âme toujours curieuse, toujours à l’affût, est « éclatante » : « tous ses ouvrages sont signés de son âme éclatante » (38), « sa nature, si curieusement et mystérieusement éclatante » (39). La vitalité est encore en lui intacte, non encore énervée par la civilisation, et son dessin est semblable à ceux des sauvages et des primitifs : « Il dessinait comme un barbare, comme un enfant » (40) (ce qui nous éclaire sur l’invention, par la modernité, de « l’art naïf ») ; « j’ai, ajoute encore Baudelaire, vu un grand nombre de ces barbouillages primitifs » (41). Toujours affairé, cet homme pressé est « tyrannisé par la circonstance » (42), « ainsi il va, il court, il cherche » (43), curieux de tout, insatiable de spectacles et d’immédiateté : « La curiosité peut être considérée comme le point de départ de son génie […] Il se précipite à travers cette foule à la recherche d’un inconnu dont la physionomie entrevue l’a, en un clin d’œil, fasciné. La curiosité est devenue une passion fatale, irrésistible ! » (44). Cet « homme-enfant », au regard ingénu et barbare, est ivre de la vie comme un convalescent qui veut jouir du sursis que la maladie lui accorde (Baudelaire se réfère ici à la nouvelle de Poe) : « Revenu récemment des ombres de la mort, il aspire avec délices tous les germes et tous les effluves de la vie » (45). Il est encore « un génie pour lequel aucun aspect de la vie n’est émoussé » (46), il est « l’amoureux de la vie universelle [qui] entre dans la foule comme dans un réservoir immense d’électricité », comme pour recharger les batteries de la vie à la pile énorme des énergies accumulées dans les grandes cités (47). « Il regarde couler le fleuve de la vitalité, si majestueux et si brillant. Il admire l’éternelle beauté et l’étonnante harmonie de la vie dans les capitales, harmonie si providentiellement maintenue dans le tumulte de la liberté humaine » (48). Comme les enfants toujours avides de spectacles (« le génie n’est que l’enfance retrouvée à volonté ») (49), il boit littéralement, comme un enfant au diaporama, les fantasmagories du spectacle de la vie : « Pour la plupart d’entre nous, surtout pour les gens d’affaires, aux yeux de qui la nature n’existe pas, si ce n’est dans ses rapports d’utilité avec leurs affaires, le fantastique réel de la vie est singulièrement émoussé. M. G. l’absorbe sans cesse ; il en a la mémoire et les yeux pleins » (50). Et si cet « archiviste de la vie » (51), cet éternel témoin des « pompes de la vie » (« Pour définir une fois de plus le genre de sujets préférés par l’artiste, nous dirons que c’est la pompe de la vie, telle qu’elle s’offre dans les capitales du monde civilisé, la pompe de la vie militaire, de la vie élégante, de la vie galante ») (52) a choisi le dessin pour exprimer cet irrésistible vitalité qui le possède (« Il a commencé par contempler la vie, et ne s’est ingénié que tard à apprendre les moyens d’exprimer la vie ») (53), c’est parce qu’il est un art de la fureur et de l’ivresse, de l’urgence et de la passion : « Ainsi, dans l'exécution de M. G. se montrent deux choses: l'une, une contention de mémoire résurrectionniste, évocatrice, une mémoire qui dit à chaque chose: "Lazare, lève-toi!"; l'autre, un feu, une ivresse de crayon, de pinceau, ressemblant presque à une fureur. C'est la peur de n'aller pas assez vite, de laisser échapper le fantôme avant que la synthèse n'en soit extraite et saisie » (54).
On s’étonnera peut-être de cette étrange formule, « art mnémonique » à laquelle Baudelaire a recours pour désigner cet art de l’instantané qui prélève le trait de la beauté sur le mouvant des phénomènes, qui réussit à « synthétiser » par l’épure la forme évanescente dans le mouvement de la foule. On peut, pour le comprendre, se référer à l’article « Art mnémonique » dans L’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert, puisqu’il existe précisément un article ainsi intitulé (55). Cette notion d’art mnémonique provient d’une ancienne tradition, que Cicéron attribuait dans l’antiquité au poète Simonide de Ceos (Ve siècle BC), et qui relevait surtout de l’art rhétorique, proposant à l’orateur, pour soutenir sa mémoire défaillante, un certain nombre d’artifices qui s’apparentent à des recettes mnémotechniques. Cette méthode a été renouvelée à la Renaissance sous la forme du « théâtre de mémoire » (56). L’Encyclopédie des Lumières répudie ces méthodes étranges, qui ne sont pas sans rapport à la Renaissance avec les sciences occultes, et qui paraissent aux modernes charger la mémoire plus qu’elles ne l’aident, par des allégories compliquées qui ont pour objet d’illustrer les idées. C’est ainsi, écrit le rédacteur, que la Logique est représentée par Aristote méditant, une clé dans sa main droite, un marteau dans la gauche, un étau devant lui sur lequel se trouve un morceau d’or fin et un morceau d’or faux… « Ce qui est absurde, remarque l’auteur de l’article, parce que ces choses ont besoin de tant d’explications que le travail de la mémoire en est doublé ». Ces figures, précise encore l’auteur, qui sont censées apporter un secours à la mémoire, sont des « schèmes », ou des « schématismes » qui permettent de fixer l’esprit sur une figure que retient plus facilement la mémoire visuelle : « certaines figures et schématismes, qui font qu’une chose se grave mieux dans la mémoire ». Ces procédés paraissent étranges aux modernes, sans doute plus accoutumés à la pensée abstraite, et pour lesquels la pratique de l’allégorie a été délaissée au profit du raisonnement. L’allégorie n’est plus pour nous une méthode bien légitime de la présentation de l’idée, qui s’affirme par le développement de son sens propre plus que par l’analogie nécessairement approximative de l’image. L’allégorie antique est une idée illustrée. L’allégorie moderne, telle que Baudelaire la pense, est inversement une rencontre sensible mystérieusement élevée dans la solennité de l’éternel. A l’inverse de l’allégorie logique de la mnémotechnie des anciens, l’allégorie des modernes n’est pas morte, elle seule est au contraire en mesure de prélever, sur le « fleuve de la vitalité », un fragment de vie et d’en transposer l’image dans l’organisation du poème ou dans la composition du dessin. C’est en ce sens que l’imagination comme la mémoire baudelairiennes sont « schématisantes », en ce sens que, par instinct et non par raisonnement, elles réussissent, comme le démontre le crayon de M.G., la synthèse instantanée du flux toujours mouvant des apparences. Le dessin propose non pas une copie fidèle du réel (ce pourquoi Baudelaire, élogieux envers M.G., est fort sévère envers la photographie), mais une sorte d’épure, de schème suscité par le génie du trait, une forme synthétique prélevée sur l’évanescence. Aussi Baudelaire souligne-t-il toujours la « synthèse » effectuée sur le réel par l’imagination poétique, opération quasi alchimique de transmutation qui extrait de l’éphémère et du futile l’éternel et l’inoubliable. C’est ainsi que, dans le chapitre du Salon de 1859 qu’il consacre à « la reine des facultés », à savoir l’imagination, Baudelaire écrit : « Mystérieuse faculté que cette reine des facultés […] Elle est l’analyse, elle est la synthèse […] C’est l’imagination qui a enseigné à l’homme le sens moral de la couleur, du contour, du son et du parfum. Elle a créé au commencement du monde l’analogie et la métaphore » (57). « Sens moral », pour la raison que l’imagination réussit à s’extraire de la singularité sensible, à laquelle l’esprit, sans son secours, demeurerait inexorablement aliéné. Par la magie du crayon de M. G., écrit encore Baudelaire, « La fantasmagorie a été extraite de la nature. Tous les matériaux dont la mémoire s'est encombrée se classent, se rangent, s'harmonisent et subissent cette idéalisation forcée qui est le résultat d'une perception enfantine, c'est-à-dire d'une perception aiguë, magique à force d'ingénuité! » (58) ; et le dernier poème de « Spleen et Idéal » (« L’Horloge », n° 85) enseigne que « les minutes, mortel folâtre, sont des gangues / Qu’il ne faut pas lâcher sans en extraire l’or ! ». L’imagination se dégage de l’étreinte du réel en le transmuant en son épure schématique, par la couleur qui se met au service du trait (l’aquarelle), par le dessin (le contour), et qui immatérialise le phénomène en le sublimant dans la mémoire en sa seule forme musicale (le son) et son parfum (« Les parfums, les couleurs et les sons se répondent ») : « C’est l’imagination qui a enseigné à l’homme le sens moral de la couleur, du contour, du son et du parfum » (59). Dans Le Peintre de la vie moderne, Baudelaire évoque semblablement le trac du dessinateur, « C'est la peur de n'aller pas assez vite, de laisser échapper le fantôme avant que la synthèse n'en soit extraite et saisie » (60). On comprend alors que le peintre de la vie moderne est surtout le peintre de la vie en soi, de la courbe exacte qui est comme le graphe de la vie, le peintre lui-même étant comme le sismographe de la circonstance. La vie, en sa forme la plus essentielle, se résume peut-être dans le pouvoir synthétique du schématisme de l’imagination qui réussit à extraire du sensible la quintessence de l’Idée, de l’allégorie poétique. M.G. n’imite pas la nature, il la traduit et la transpose plutôt dans l’arabesque fondamentale qui enregistre le mouvement incessant de la vie. Il fait apparaître, dans la foule des passants, les lignes de force des grands courants qui traversent ce fleuve de la vitalité universelle, il traduit l’image du réel dans le tracé des lignes de vie qui la parcourent, il sublime les formes dans la quintessence de l’arabesque et du contour qui les résume dans l’instantané : « Il s'établit alors un duel entre la volonté de tout voir, de ne rien oublier, et la faculté de la mémoire qui a pris l'habitude d'absorber vivement la couleur générale et la silhouette, l'arabesque du contour » (61). L’art de la modernité n’est donc pas un art d’imitation, mais plutôt de transposition : il s’agit non plus de peindre le spectacle de la vie, son théâtre, ses apparences, mais la vie elle-même, sur le modèle de ce que Schopenhauer (que Baudelaire ignorait) disait de la musique : qu’elle n’exprimait pas l’objectité de la volonté, c'est-à-dire le monde comme représentation, mais la Volonté elle-même, le jeu infini de la vie avec elle-même. Un tel art, dont Baudelaire répète volontiers que son opération fondamentale est d’abstraction, peut être en effet « abstrait », en ce sens qu’il prétend rendre visible, non les phénomènes visibles de la vie, mais la vie elle-même, son serpentement et les lignes de force qui la parcourent, la vie intense qui ondule et frémit dans le courant du fleuve. Et c’est bien ainsi en effet que l’art qu’on dira plus tard « abstrait » a voulu se définir et prendre conscience de lui-même au début du vingtième siècle.
Il n’est donc pas faux de juger en ce sens que l’art pourtant quasi photographique, en ce qu’il a d’instantané, de M. G., pratique une sorte d’abstraction paradoxalement esthétique, qui extrait, de la matière indifférenciée de la sensation, du divers toujours mouvant des phénomènes, le trait fulgurant qui distingue et désigne, par une sorte d’épure, de schème stylisé, la forme soudain détachée de l’informe. Dans le chapitre qu’il consacre à la couleur dans le Salon de 1846, Baudelaire souligne paradoxalement l’abstraction du monogramme tracé par le schématisme de l’imagination : « L’art n’étant qu’une abstraction et un sacrifice du détail à l’ensemble, il est important de s’occuper surtout des masses » (62) ; dans le même Salon, commentant la formule toujours recommencée selon laquelle la beauté est un mixte d’éternel et de transitoire, d’absolu et de particulier, Baudelaire ajoute : « La beauté absolue et éternelle n’existe pas, ou plutôt elle n’est qu’une abstraction écrémée à la surface générale des beautés diverses » (63). Il faut entendre alors que c’est précisément par cette opération d’abstraction que l’éternel peut être extrait du fugitif, non pas en ce sens vaguement platonicien selon lequel l’opération du poète consisterait à induire, du phénomène, l’idée invariable dont il est l’expression sensible, mais par des voies moins intellectuelles, de façon plus instinctive et sauvage, selon l’acte quasi réflexe de l’œil sensible réagissant à l’afflux des sensations, à ce que Baudelaire nomme « l’émeute des détails » (64), et opposant à cette pression exercée par le phénomène surgissant le trait spirituel qui réussit à la fois à en exprimer l’élan et à en contenir la forme. Aussi le dessin baudelairien ne vise-t-il nullement à la pureté d’une forme essentielle, académique, mais plutôt à une sorte d’arabesque, ou sinuosité vivante, qui rend compte de la vague toujours recommencée de l’éblouissement sensible, par une opération d’abstraction qui est tout entière esthétique, non intellectuelle ni philosophique. Dans son essai sur L’Œuvre et la vie de Delacroix (1863), Baudelaire souligne combien le trait du crayon, la ligne du dessin, est un être spirituel et abstrait qu’on ne rencontre pas dans la nature : « Pour parler exactement, il n’y a dans la nature ni ligne ni couleur. C’est l’homme qui crée la ligne et la couleur. Ce sont deux abstractions qui tirent leur égale noblesse d’une même origine » (65). Ce serait pourtant interpréter ce texte à contresens que d’identifier cette ligne abstraite à celle de l’épure géométrique, et de confondre ainsi le schématisme sans concept de l’imagination libre, dans le jugement réfléchissant, avec celui de l’imagination liée à l’entendement, dans le jugement déterminant, schématisme spéculatif, non immédiat, mais construit au contraire par la médiation de la synthèse catégoriale. A l’inverse, le schématisme spontané du jugement réfléchissant est celui d’un esprit non savant, mais au contraire enfant, ludique et voluptueux : « Un dessinateur-né (je le suppose enfant), continue Baudelaire, observe dans la nature immobile ou mouvante de certaines sinuosités, qu’il s’amuse à fixer par des lignes sur le papier, exagérant ou diminuant à plaisir leurs inflexions. Il apprend ainsi à créer le galbe, l’élégance […] Une figure bien dessinée vous pénètre d’un plaisir tout à fait étranger au sujet. Voluptueuse ou terrible, cette figure ne doit son charme qu’à l’arabesque qu’elle découpe dans l’espace » (66). Ce qui n’est sans doute pas sans rapport avec la formule à laquelle recourt le poète dans Le Peintre de la vie moderne : « Il s’établit alors un duel entre la volonté de tout voir, de ne rien oublier, et la faculté de la mémoire qui a pris l’habitude d’absorber vivement la couleur générale et la silhouette, l’arabesque du contour » (67). Nous voici donc conduits, par l’approfondissement des principes qui inspirent l’esthétique baudelairienne, à une sorte d’abstraction esthétique dont l’arabesque serait l’emblème. Ne retrouvons-nous pas par cette analyse les intuitions que développait, à la fin du siècle et en historien de l’art, Aloïs Riegl ? Une voie se dessine alors, qui permet peut-être de réconcilier l’esthétique avec l’art abstrait.
NOTES
1- Georges Roque, Qu’est-ce que l’art abstrait ? Une histoire de l’abstraction en peinture (1860-1960), « Folio-Essais », Gallimard, 2003, p. 356 sq.).
2- Kenneth E. Silver, Vers le retour à l’ordre. L’avant-garde parisienne et la première guerre mondiale, 1914-1925, Flammarion, 1991 [1989]
3- Charles Baudelaire, Le Peintre de la vie moderne, chap. IV : « La Modernité », dans Œuvres complètes, éd. établie par Y. le Dantec et Cl. Pichois, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 1961, p. 1163. Ce volume de la Pléiade est par la suite abrégé en « Œuvres complètes ».
8- Par exemple Gaëtan Picon, 1863 : naissance de la peinture moderne, Skira, 1974 (republié ensuite, avec une postface d’Alain Bonfand, en « Folio-Essais »).
9- « O ces Grecs ! Ils s’entendaient à vivre : ce qui exige une manière courageuse de s’arrêter à la surface, au pli, à l’épiderme ; l’adoration de l’apparence, la croyance aux formes, aux sons, aux paroles, à l’Olympe tout entier de l’apparence ! Ces Grecs étaient superficiels – par profondeur ! » (Le Gai Savoir, « Avant propos », § 4 ; Œuvres philosophiques complètes, éd. Colli et Montinari, tome V, Gallimard, 1967, p. 19.
10- Baudelaire, Correspondance, éd. Cl. Pichois et J. Thélot, « Folio classique », 2000, p. 39.
11- Charles Baudelaire, « Exposition universelle – 1855 », dans Œuvres complètes, p. 961.
15- « Salon de 1859 », Œuvres complètes, p. 1056.
16- Id. p. 1094-95.
17- Le peintre de la vie moderne, « XII- Les Femmes et les Filles », dans Œuvres complètes, p. 1189
18- Le Spleen de Paris, « Epilogue » : « Je voulais m’enivrer de l’énorme catin / Dont le charme infernal me rajeunit sans cesse. / Que tu dormes encore dans les draps du matin / Lourde, obscure, enrhumée, ou que tu te pavanes / Dans les voiles du soir passementés d’or fin / Je t’aime, ô capitale infâme ! » (Œuvres complètes, p. 310).
19- Spleen de Paris, « Perte d’auréole » : « Tout à l'heure, comme je traversais le boulevard, en grande hâte, et que je sautillais dans la boue, à travers ce chaos mouvant où la mort arrive au galop de tous les côtés à la fois, mon auréole, dans un mouvement brusque, a glissé de ma tête dans la fange du macadam. Je n'ai pas eu le courage de la ramasser » (Œuvres complètes, p. 299-300).
20- Le peintre de la vie moderne (II- Le croquis de mœurs) : « Observateur, flâneur, philosophe, appelez-le comme vous voudrez; mais vous serez certainement amené, pour caractériser cet artiste, à le gratifier d'une épithète que vous ne sauriez appliquer au peintre des choses éternelles, ou du moins plus durables, des choses héroïques ou religieuses. Quelquefois il est poète; plus souvent il se rapproche du romancier ou du moraliste; il est le peintre de la circonstance et de tout ce qu'elle suggère d'éternel » (Œuvres complètes, p. 1155-1156).
21- Les paradis artificiels : Le poème du haschisch, « IV- L’Homme-Dieu », dans Œuvres complètes, p. 376.
22- « Le Cygne », Les Fleurs du mal, n° 89
23- « L'homme de génie a les nerfs solides; l'enfant les a faibles. Chez l'un, la raison a pris une place considérable; chez l'autre, la sensibilité occupe presque tout l'être. Mais le génie n'est que l'enfance retrouvée à volonté, l'enfance douée maintenant, pour s'exprimer, d'organes virils et de l'esprit analytique qui lui permet d'ordonner la somme de matériaux involontairement amassée » Le Peintre de la vie moderne, « III, L’Artiste, homme du monde, homme des foules et enfant » ; dans Œuvres complètes, p. 1159.
24- L’avant-dernier poème (n° 84) de la première partie des Fleurs du mal, « Spleen et Idéal » (« L’Horloge » en est le dernier), est intitulé « L’Irrémédiable » : en une suite d’images saisissantes, il évoque la chute de l’Ange, de l’Idéal dans la boue, tout ce « Qui donne à penser que le Diable / Fait toujours bien tout ce qu’il fait » : « Une Idée, une Forme, un Etre / Parti de l’azur et tombé / Dans un Styx bourbeux et plombé / Où nul œil du Ciel ne pénètre ». Il faudrait aussi citer ici le poème intitulé « L’Irréparable » (n° 54), qui évoque en termes saisissants la forme moderne de la damnation, l’angoisse paradoxale du néant, qui « ronge avec sa dent maudite / Nôtre âme, piteux monument », l’Irréparable qui est sœur damnée de l’irrémissible : « Adorable sorcière, aimes-tu les damnés ? / Dis, connais-tu l’irrémissible ? ». C’est de cette fatalité sans objet et sans nom que Baudelaire aperçoit le reflet chatoyant dans la peinture véhémente et fervente d’un Delacroix : « Tout, dans son œuvre, n'est que désolation, massacres, incendies ; tout porte témoignage contre l'éternelle et incorrigible barbarie de l'homme. Les villes incendiées et fumantes, les victimes égorgées, les femmes violées, les enfants eux-mêmes jetés sous les pieds des chevaux ou sous le poignard des mères délirantes ; tout cet œuvre, dis-je, ressemble à un hymne terrible composé en l'honneur de la fatalité et de l'irrémédiable douleur » (L’œuvre et la vie de Delacroix, V ; Œuvres complètes, p. 1132).
25- Le Peintre de la vie moderne, « V- L’art mnémonique », dans Œuvres complètes, p. 1168.
26- Le Peintre de la vie moderne, « XII- Les Femmes et les Filles » ; dans Œuvres complètes, p. 1187-88.
27- Le Peintre de la vie moderne, « V- L’Art mnémonique » ; dans Œuvres complètes, p. 1168
28- Diderot, Salon de 1765 ; dans Œuvres esthétiques, éd. Paul Vernière, Garnier Frères, 1968, p. 542-544.
29- Diderot, Pensées détachées sur la peinture, vers 1775 ; dans Œuvres esthétiques, éd. Paul Vernière, Garnier Frères, 1968, p. 759.
30- Diderot, Salon de 1765, dans Œuvres esthétiques, éd. Paul Vernière, Garnier Frères, 1968, p. 569.
31- Baudelaire, Le Peintre de la vie moderne, « V- L’Art mnémonique » ; dans Œuvres complètes, p. 1169.
32- Baudelaire, L’œuvre et la vie d’Eugène Delacroix, § VI ; dans Œuvres complètes, p. 1135.
33- Baudelaire, Le Peintre de la vie moderne, « V- L’Art mnémonique » ; dans Œuvres complètes, p. 1168.
35- Baudelaire, Le Peintre de la vie moderne, « III- Artiste, homme du monde, homme des foules et enfant » ; dans Œuvres complètes, p. 1162.
36- Charles Baudelaire, Œuvres complètes, p. 79.
37- Le Spleen de Paris, « III- Le Confiteor de l’artiste », dans Œuvres complètes, p. 232.
38- Baudelaire, Le Peintre de la vie moderne, « III- Artiste, homme du monde, homme des foules et enfant » ; dans Œuvres complètes, p. 1156.
42- Le Peintre de la vie moderne, « IV- La Modernité » ; dans Œuvres complètes, p. 1165
44- Le peintre de la vie moderne, « III- L’Artiste, homme du monde, homme des foules et enfant » ; dans Œuvres complètes, p. 1158.
45- Ibid. Il s’agit de la nouvelle d’Edgar Poe intitulée « L’Homme des foules ».
50- Le Peintre de la vie moderne, « IV- La Modernité » ; dans Œuvres complètes, p. 1166.
51- Le Peintre de la vie moderne, « VI- Les Annales de la guerre » ; dans Œuvres complètes, p. 1169.
52- Le Peintre de la vie moderne, « VIII- Le Militaire » ; dans Œuvres complètes, p. 1175.
53- Le Peintre de la vie moderne, « IV- La Modernité » ; dans Œuvres complètes, p. 1165-66.
54- Le Peintre de la vie moderne, « V- L’Art mnémonique » ; dans Œuvres complètes, p. 1168.
55- Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, sous la direction de Diderot et d’Alembert, tome I, A-Azymites, 1751, p. 718-719. Cet article est reproduit dans l’Appendice VIII de l’ouvrage de Paolo Rossi, Clavis universalis, Jérôme Millon, trad. franç. 1993, p. 246-248.
56- On consultera sur ce thème très riche en premier lieu l’ouvrage précédemment cité : Paolo Rossi, Clavis universalis, Jérôme Milon, 1993 [1960], chap. III à V ; et l’ouvrage qui lui succède : Frances Yates, L’Art de la mémoire, Gallimard, 1975 [1966]. Le texte, traduit de l'italien, de Giulio Camillo, Le Théâtre de mémoire, a été publié en 2001 aux éditions Allia.
57- Baudelaire, Salon de 1859, « III- La Reine des facultés » ; dans Œuvres complètes, p. 1037.
58- Le Peintre de la vie moderne, « III- L’Artiste, homme du monde, homme des foules et enfant » ; dans Œuvres complètes, p. 1162.
59- Baudelaire, Salon de 1859, « III- La Reine des facultés » ; dans Œuvres complètes, p. 1037.
60- Le Peintre de la vie moderne, « V- L’Art mnémonique » ; dans Œuvres complètes, p. 1168.
62- Baudelaire, Salon de 1846, « III- De la couleur » ; dans Œuvres complètes, p. 882.
63- Id., « XVIII- De l’héroïsme de la vie moderne » » ; dans Œuvres complètes, p. 950.
64- « Un artiste ayant le sentiment parfait de la forme, mais accoutumé à exercer surtout sa mémoire et son imagination, se trouve alors comme assailli par une émeute de détails, qui tous demandent justice avec la furie d'une foule amoureuse d'égalité absolue » (Le Peintre de la vie moderne, « V- L’Art mnémonique » ; Œuvres complètes, p. 1167).
65- Œuvres complètes, p. 1124.
67- Le Peintre de la vie moderne, « V- L’Art mnémonique » ; Œuvres complètes, p. 1167.
Pour lire la suite, cliquer ICI
|
|