LA PEINTURE HOLLANDAISE AU SIECLE D'OR
5- REMBRANDT
La Renaissance italienne au XVe siècle, et déjà la proto-renaissance à l’orée du XIVe siècle avec Giotto, inventent la scène qui définit en occident, au moins jusqu’à Cézanne, le lieu, sinon le théâtre, où se joue l’art de la peinture. Cette scène est un espace de pure visualité, qui réfléchit dans l’image les conditions de la vision, selon la géométrie perspective centrée sur le point de vue. Toute la peinture italienne de la renaissance est une théorie de la vision, chez certains peintres systématique et presque abstraite, comme c’est le cas par exemple chez un Paolo Uccello. Rembrandt inverse cette évidence qui se trouvait au fondement de son art et invente une autre peinture, qui prend sa source, non plus dans la célébration du visible – la jouissance de l’œil embrassant d’un regard le spectacle du monde – mais au rebours dans une appréhension du monde qui s’apparente à celle de la cécité. A l’optique géométrique des Italiens, il oppose les tâtonnements de l’aveugle qui progresse à petits pas dans les ténèbres. Rembrandt invente l’art paradoxal d’une peinture d’aveugle. Cette clé est moins paradoxale qu’il n’y paraît au premier abord : pour une exposition qui eut lieu au Louvre en 1991, Jacques Derrida, avec la complicité du Département des Arts graphiques, rédigea un essai sur l’art du dessin intitulé : Mémoires d’aveugle. L’autoportrait et autres ruines. Il le fit à sa façon, proposant une sorte de méditation-rêverie nécessairement inachevée, réactivant le réseau des signes dans le champ illimité des signifiants. Dans ce texte, Derrida pense le dessin et prend d’abord appui sur le constat d’un fait : quand le crayon dessine sur le papier, le dessinateur suit du regard le crayon et ne voit plus le modèle qu’il est pourtant censé représenter. Tout dessin est nécessairement un dessin d’aveugle, et la main esquisse un contour – ce trait abstrait qui est une invention de l’entendement et n’a pas d’existence dans la réalité – qui restitue, par approximations successives, une présence que l’artiste n’a pas sous les yeux. L’art du dessin serait un art de la mémoire plus que de la vue (Mémoires d’aveugle), et moins l’enregistrement d’une présence que la trace d’une absence. Cette intuition, qui est à la source du très riche essai de Derrida, on la trouvait déjà chez Valéry, que Derrida ne cite pourtant pas, en un passage qui se réclame des méthodes enseignées par Léonard de Vinci pour stimuler l’invention (ingenio) de l’artiste. Valéry propose que le dessinateur prenne pour modèle un objet informe – ce qui signifie non qu’il n’a pas de forme, mais que sa forme n’est pas clairement reconnaissable par notre entendement – par exemple un mouchoir froissé : le dessinateur doit alors « faire voir » le morceau d’étoffe, c'est-à-dire « rendre intelligible une certaine structure d’un objet qui n’en a point de déterminée ». Et Valéry ajoute : « C’est ici que l’artiste peut exercer son intelligence, et que l’œil doit trouver, par ses mouvements sur ce qu’il voit, les chemins du crayon sur le papier, comme un aveugle doit, en la palpant, accumuler les éléments de contact d’une forme, et acquérir point par point la connaissance et l’unité d’un solide très régulier » (Degas Danse Dessin, Pléiade, Œuvres II, p. 1194-95).
N’est-ce pas ainsi que peint Rembrandt ? En palpant, du bout du pinceau, comme un aveugle du bout de son bâton, une zone d’ombre, de ténèbres, pour faire apparaître les présences latentes qui hantent ce milieu, des formes approximatives devinées en tâtonnant, par touches de couleur successives et non par le trait dessiné qui est une invention des voyants et n’a pas d’équivalent dans la réalité. Curieusement, Derrida, dans son essai – qui concerne il est vrai le dessin, et non la peinture – ne se réfère guère à Rembrandt, à l’exception d’un dessin qui lui est attribué (dont l’authenticité est douteuse), et qui se rapporte à l’histoire biblique de Tobit, dessin sur lequel nous aurons l’occasion de revenir. Il est pourtant peu d’artistes qui, autant que Rembrandt, aient pris le parti paradoxal d’une peinture aveugle, d’une image qui prendrait pour modèle la vision de l’aveugle plutôt que la claire perspective de la vue optique. Il se pourrait que la lumière éblouisse et leurre plus qu’elle ne révèle, et que la vue que nous avons du monde se laisse fasciner par une fallacieuse apparence. On sait en revanche que les aveugles sont des voyants, et que, s’ils ont les yeux fermés sur ce monde, ils voient en revanche dans l’autre monde. Rembrandt, qui cherche toujours à peindre l’âme plutôt que la figure, le secret du cœur plutôt que la mimique aimable, doit fermer les yeux sur le monde visible pour les ouvrir sur le monde invisible. L’aveugle se connaît lui-même non comme un objet dont le miroir définit exactement le contour, mais comme une existence qui irradie autour de son foyer. C’est ainsi que Rembrandt se représente lui-même dans la longue série de ses autoportraits (on en compte plus d’une cinquantaine !), non son image extérieure mais la flamme intérieure qui le consume et, lentement, avec le temps, transforme la chair en lumière. Si Rembrandt revient si souvent sur l’image de lui-même, ce n’est pas par complaisance pour son aspect, mais parce qu’il cherche à sonder le secret de la vie qui le brûle au plus intime de lui-même. Et, comme le disait Descartes, pour apercevoir cette lumière qui est en nous, et non dans le monde, il vaut mieux fermer les yeux que les ouvrir : « Je fermerai maintenant les yeux, je boucherai mes oreilles, je détournerai tous mes sens, j’effacerai même de ma pensée toutes les images des choses corporelles, ou du moins, parce qu’à peine cela se peut-il faire, je les réputerai comme vaines et comme fausses ; et ainsi m’entretenant seulement moi-même, et considérant mon intérieur, je tâcherai de me rendre peu à peu plus connu et plus familier à moi- même » (Troisième Méditation).

1- Portrait de l’artiste par lui-même en saint Paul,
Rijksmuseum, 91 x 77, 1661
Pour une série d’apôtres, Rembrandt fait son autoportrait en saint Paul, s’identifiant ainsi au théologien de la conversion auquel se réfère si souvent Calvin (fig. 1). Il est vrai que Rembrandt n’hésite pas à jouer tous les rôles sur son théâtre de peinture, celui des saints comme celui des pécheurs, puisqu’on le retrouve aussi bien sur l’érection de croix de Munich, parmi les ouvriers qui aident hisser la croix (1634). Deux sources de lumière : le visage, émanation de la pensée, et le Livre, émanation de la parole. On déchiffre difficilement « Moïse » sur la page ouverte, donc le Livre de la Loi supprimée et dépassée par la Nouvelle Alliance, précisément l’un des thèmes les plus fondamentaux des épîtres de Paul. Paul-Rembrandt semble nous prendre à témoin de ce qu’il faut renoncer à la loi du Dieu d’Israël pour se convertir à la loi de l’Evangile, renoncer à la lettre pour se convertir à l’esprit, annoncé à toutes les nations de la terre. Comme si Rembrandt cherchait à peindre non un homme, mais une pensée, une interprétation qui renouvelle radicalement le sens de l’Ancien Testament.

2- Portrait de l’artiste par lui-même, Cologne,
Walraf-Richartz Museum, 82,5 x 65, c. 1669
(Rembrandt meurt le 4 octobre de cette année-là).
Plusieurs lectures ont été proposées de ce tableau (fig. 2). La plus convaincante identifie le buste qu’on voit de profil, en haut et à gauche, à celui d’Héraclite, buste qui figure dans l’Inventaire dressé après la mort de Rembrandt ; Rembrandt lui-même, qui esquisse ici un rictus plutôt qu’un rire, serait alors Démocrite, qui se rit des misères humaines, laissant à Héraclite le soin d’en pleurer. Quelques mois plus tôt, son fils Titus venait d’être emporté par la peste, et c’est sans doute un rire de désespoir qu’il faut entendre dans ce dernier autoportrait, et l’un des tout derniers tableaux de Rembrandt. Le visage n’est plus qu’un brandon, une braise en train de se désagréger. Portrait d’une âme douloureuse plus que d’une chair visible. Rembrandt, sur le point de s’ensevelir dans les ténèbres, et jetant ses derniers feux, semble prendre congé de nous pour disparaître à tout jamais. Aucune complaisance dans les autoportraits de Rembrandt : à l’inverse de Dürer, qui semble fasciné par son aspect, par le double solennel qui lui fait face dans le miroir (fig. 3), Rembrandt scrute l’apparence pour accéder, par delà le masque, à la vérité du cœur.

3- Albrecht Dürer, Autoportrait, 1500, 66,3 x 49, Munich
Sur le tableau de Cologne (fig. 2), Rembrandt réfléchit pour la dernière fois l’énigme de sa propre existence, dont il observe l’extinction des derniers feux. Déjà presque fantôme, il s’apprête à s’abîmer dans les ténèbres, à disparaître sous nos yeux. Si la vue perspective nous permet d’ordonner l’espace et de le dominer, en revanche nous sommes aveugles dans le temps, « nous entrons dans l’avenir à reculons » (1) et ne voyons pas la mort qui s’approche. La vision de l’aveugle, incertaine et chancelante dans l’espace, est plus sensible que nous à l’épaisseur du temps – ce n’est pas un hasard si les devins, qui prédisent l’avenir, sont le plus souvent des aveugles – et l’espace dans lequel l’aveugle s’aventure à tâtons est un espace-temps, rythmé par le pas de la marche, et non l’espace géométrique qui ne connaît que trois dimensions. Tout se passe comme si Rembrandt voyait les diverses scènes du théâtre du monde comme autant de flammes qui se consument et se désagrègent, lentement attaquées dans la solution corrosive de la temporalité. Dans ces ténèbres, il faut pénétrer avec prudence, comme Hendrikje Stoffels qui avance, sur le tableau de Londres, dans les eaux noires du Styx, à petits pas, comme un aveugle à tâtons (fig. 4), et cette eau qui fait miroir et dissimule sa profondeur est comme le temps où, lentement, nous sombrons et nous nous noyons :

4- Hendrickje au bain, 1655, 61,8 x 47, Londres, National Gallery
Le tableau est osé, Hendrickje, chemise retroussée et large décolleté, souriant à son propre reflet dans le miroir de l’eau sombre, hommage certainement secret du peintre à sa compagne. On a pu comparer la pose à celle, antique, de la Vénus impudique, ou bien encore à La petite fourrure de Rubens, jeu érotique qui met en valeur le corps opulent et nacré d’Hélène Fourment (1638, Vienne). Pourtant, la progression prudente dans l’eau noire dramatise le corps lumineux d’Hendrickje, et ce qui est sensualité heureuse chez Rubens, plongé dans l’ombre où rayonne l’or d’une robe de reine, devient chez Rembrandt une image de notre ensevelissement lent et silencieux dans le Temps.
Est-ce la raison pour laquelle les grands aveugles, qui sont aussi de grands voyants, hantent si souvent l’œuvre de Rembrandt ?

5- Homère dictant à un scribe , 1663, 108 x 82,4, Mauritshuis
A l’âge classique, qui se réfère plus volontiers à l’histoire romaine qu’à l’antiquité grecque, il est assez rare de rencontrer une image du poète de l’Iliade. Celle-ci a (fig. 5) été commandée à Rembrandt par un noble Sicilien de Messine, Antonio Ruffo qui souhaitait se constituer une galerie de savants et de philosophes antiques, sur le modèle des humanistes de la renaissance. Homère est le grand aveugle dont le regard, tout tourné vers l’intérieur, est doué de la voyance des devins et des poètes, possédés par le dieu, inspirés par la Muse, qui ont reçu le don d’invoquer à la fois les héros disparus depuis la nuit des temps et ceux qui sont encore en attente, dans les coulisses de l’avenir. Le tableau du Mauritshuis, à la suite d’un incendie, a été amputé sur les quatre côtés.

6- Homère instruisant ses élèves, 1661-1663,
Stockholm, National Museum
Un dessin à l’encre brune conserve la composition initiale (fig. 6) : Homère, les yeux éteints, privés de l’éclat de la prunelle qui marque la vie de l’esprit sur la chair du regard, Homère converti en lui-même, à l’écoute de la voix qui parle au plus profond de lui-même, scandant de la main droite le rythme des vers, dicte à un jeune scribe, son élève, le chant du poème. La vérité de toute poésie est dans la parole vivante, et non dans la trace écrite qui n’est que parole morte. On peut donc se passer du scribe, et l’incendie a préservé l’essentiel. Il n’est pourtant pas indifférent de savoir qu'Homère ici est enseignant, et que le maître n’enseigne qu’en se mettant à l’écoute d’un maître intérieur. Peinture de l’invisible : ce que Rembrandt donne ici à voir, c’est le mystère de la parole poétique dans le moment où elle est en train de naître, et le corps du poète se dématérialise, devenu comme incandescent dans la flamme d’une illumination spirituelle. Pour le même Antonio Ruffo, Rembrandt avait peint un tableau dont l’interprétation est problématique, mais dans lequel on s’accorde à reconnaître, sur la foi de l’inventaire de Ruffo lui-même (2), un Aristote contemplant le buste d’Homère (fig. 7).

7- Aristote contemplant le buste d’Homère, 1653,
143,5 x 136,5, Metropolitan
Comme Rembrandt a également peint pour le Sicilien un Alexandre le Grand, on a pensé qu’il y avait un lien cohérent entre les trois tableaux : Homère qu’admirait Aristote, et Aristote qui fut le précepteur d’Alexandre. Le philosophe, auteur d’une Poétique, médite le poète qui se trouve à la source, dans la culture européenne, de toute poésie. Sur la chaîne d’or qui semble indiquer un dignitaire, on devine un médaillon à l’effigie d’Alexandre. Le buste d’Homère est sans doute celui qui figure dans l’inventaire dressé après la mort de Rembrandt. Le philosophe pose mélancoliquement la main sur la tête du poète comme pour communier avec le grand ancêtre. Celui qui a des yeux pour ne pas voir semble demander à l’Aveugle, exilé dans le monde des morts, le secret de son génie. Ici encore, ce que le tableau représente, ce n’est pas une scène extérieure, mais le soliloque intérieur de deux âmes pensantes, le dialogue dans le monde des morts du philosophe et du poète. Ruffo envoya de cette composition une esquisse au Guerchin, en lui demandant un tableau qui puisse faire pendant à celui-ci. Le peintre italien répondit qu’il y voyait l’image d’un « Physionomiste » qui étudie sur une statue la signification des traits humains. Il est vrai qu’Aristote ne regarde guère Homère – ses yeux sont plutôt perdus dans le vide – la communication des âmes opérant par le contact de la main plutôt que par l’échange des regards. Aristote considère Homère comme un aveugle palpe et reconnaît le visage d’un ami proche. Un dessin, attribué précisément à l’école du Guerchin, se rapproche de la composition de Rembrandt (fig. 8) :

8- Atelier du Guerchin, « Della scoltura si / Della pittura no »,
plume et encre brune, lavis brun, XVIIe siècle, 26,6 x 22,3, Louvre
L’image se réfère à la comparaison des arts de la sculpture et de la peinture, le Paragone, qui était un exercice obligé, depuis le XVIe siècle, des conférences académiques : un aveugle, tenant d’une même main son bâton et la sébile du mendiant, incapable d’apprécier le tableau, est cependant en mesure de juger de la beauté de ce buste de femme, qui semble curieusement se lever vers la main qui la caresse. Dans son Cours de peinture par principes, publié au début du XVIIIe siècle (3) (1708), Roger de Piles rapporte le cas curieux d’un aveugle toscan capable d’effectuer, par palpation de la main, des portraits d’une parfaite ressemblance : « Je tâte, dit-il, mon original, j’en examine les dimensions, les éminences et les cavités : je tâche de les retenir dans ma mémoire, puis je porte ma main sur ma cire, et par la comparaison que je fais de l’un et de l’autre, je termine le mieux que je puis mon ouvrage ». Un peintre, continue Roger de Piles, faisant le portrait de ce sculpteur aveugle, « lui avait mis un œil à chaque bout de doigt pour faire voir que ceux qu’il avait ailleurs étaient tout à fait inutiles » (4). Diderot, dans sa Lettre sur les aveugles (1749) s’en souvient, et ajoute, à propos de Nicholas Saunderson, célèbre mathématicien anglais devenu aveugle à l’âge d’un an, fameux au XVIIIe siècle pour les conférences qu’il faisait sur la lumière, les couleurs et l’arc-en-ciel, que l’aveugle a le pouvoir de « voir par la peau » (5). Ne peut-on dire que Rembrandt a des yeux au bout de ses pinceaux et qu’il reconnaît son modèle progressivement, en le palpant par touches successives, comme l’aveugle par le toucher de la main ?
Mais Homère n’est pas le seul grand aveugle qu’on rencontre dans l’univers de Rembrandt. D’autres l’accompagnent, venus cette fois de la Bible et non de l’antiquité païenne.

9- Jacob bénissant les fils de Joseph, 1656, 177,5 x 210,
Cassel, Staatliche Kunstsammlungen
Jacob, venu en Egypte rejoindre son fils Joseph devenu un dignitaire en ce pays, sent la mort venir (fig. 9). Le vieux patriarche demande à voir les fils de Joseph, Manassé l’aîné et Ephraïm le cadet, pour leur donner sa bénédiction. La tradition veut que l’aîné seul soit béni, pourtant Jacob-Israël, malgré les incitations de Joseph, croise les mains et choisit de bénir Ephraïm, destiné selon l’aveugle-voyant à une plus grande descendance : « “Pas comme cela, Père, dit Joseph à son père, car c’est celui-ci l’aîné : mets la main droite sur sa têteˮ. Mais son père refusa et dit : “Je sais, mon fils, je sais : lui aussi deviendra un peuple, lui aussi sera grand. Pourtant, son cadet sera plus grand que lui, sa descendance deviendra une multitude de peuplesˮ » (6). Un apocryphe du début de l’ère chrétienne, qui venait d’être traduit en hollandais, soutenait que d’Ephraïm naîtrait l’Eglise du Christ, tandis que de Manassé naîtrait la nation juive. Rien n’indique que Rembrandt partage cette lecture sectaire, mais il sait faire résonner en cette scène une sorte d’écho temporel qui lui confère la solennité d’un rituel. La lumière, mystérieusement rayonnante, donne à la bénédiction une sorte d’aura d’éternité. Rembrandt aime ces tableaux familiaux et intimes, et les nimbe toujours d’une lumière chaude et veloutée. Rembrandt choisit de figurer la seconde épouse de Jacob, Asénath, fille d’un grand prêtre égyptien, qui n’est pourtant pas mentionnée dans les Ecritures. Il obtient ainsi une correspondance entre la bénédiction des fils de Joseph et la bénédiction des fils d’Isaac, Esaü l’aîné et Jacob le cadet : c’est la ruse de Rébecca qui, profitant de la faible vue du fils d’Abraham, le trompe par une peau de chevreau sur les bras de Jacob, qui le fait passer dans l’esprit de son père pour son aîné Esaü, et lui permet ainsi de détourner trompeusement la bénédiction paternelle, promesse de prospérité future, sur la tête du cadet. Mais sur la bénédiction de Jacob, tout se fait sans ruse ni tromperie, et Asénath, en mère aimante, assiste pieusement à la cérémonie du passage d’une génération à une autre. Comme le remarque Derrida, ces histoires d’aveugle mettent bien souvent en jeu le père et le fils, ou mieux encore : le grand-père et le petit-fils. C’est que les hommes, en s’approchant de la mort, voient leur vue baisser et deviennent aveugles, comme les morts, aveugles eux-mêmes ; tandis que les enfants, à qui l’on vient de donner le jour, jouissent de la lumière et sont tout entier en ce monde. La bénédiction de Jacob célèbre donc aussi le passage de ce monde à l’autre monde, de celui qui s’enfonce dans l’ombre et de celui qui s’avance au soleil. En 1656, Rembrandt, accablé de querelles et partiellement ruiné, fuit les créanciers qui le contraindront l’année suivante, fin 1657-début 1658, à vendre la magnifique maison qu’il avait habitée avec Saskia. Il pense à son fils Titus, qui deviendra peintre, mais mourra avant son père.

10- Samson aveuglé par les Philistins, 1636,
205 x 272, Francfort, Städelsches Kunstinstitut
La bénédiction de Jacob réfléchit le don de voyance qui fait de l’aveugle un devin. L’aveuglement de Samson, trahi par Dalila, est au contraire une scène d’une extrême violence, semblable à un égorgement ou à un viol (fig. 10). Cette véhémence est emblématique de la violence de la conversion qui tombe sur l’âme comme la foudre, et l’on peut dire que Samson est terrassé comme Paul est précipité à terre sur le chemin de Damas. La férocité avec laquelle le spadassin plonge son poignard dans l’orbite du « nadir » (il devait sa force à l’élection divine et sa longue chevelure était le signe de sa consécration) évoque le chant de l’Odyssée dans lequel Homère rapporte comment Ulysse enfonce dans l’œil du cyclope un pieu incandescent qu’il tourne alors comme on fait avec une tarière. Dans cette caverne obscure, seuls Samson et Dalila s’enfuyant, les ciseaux à la main, en emportant la chevelure du colosse, sont dans la lumière, pendant que les meurtriers s’agitent dans les ténèbres. Le foyer de la lumière est toujours, chez Rembrandt, environné d’une couronne d’ombre dense et hantée, comme si la zone précaire de la vision était assiégée par la menace de l’aveuglement. En aveuglant Samson, amateur de femme et de bonne chère, ses bourreaux le détachent du monde et le convertissent en Dieu, dont il sera désormais le défenseur implacable, lui qui fera s’effondrer les colonnes du temple où s’était rassemblé le peuple idolâtre. Le tableau de Rembrandt est animé d’une fureur singulière, avec ce soldat un peu fantoche qui tient la pique au premier plan, comme sur la scène d’un mélodrame populaire qui inspire terreur et pitié.

11- Samson et Dalila, 1628, 61,4 x 40, Berlin
Rembrandt, qui aime dans la Bible les histoires qui ont l’accent des contes populaires, s’est depuis le début attaché au chapitre des Juges qui rapporte la geste de Samson : alors qu’il était encore à Leyde (c’est en 1631 qu’il « monte » à Amsterdam), il a peint ce Samson et Dalila comme la scène d’une pièce à sensation surjouée par des acteurs de province (fig. 11) : enivré de vin et de plaisir, Samson dort sur les genoux de Dalila qui se retourne vers le tueur qui s’approche sur la pointe des pieds, le poignard à la main, pour énucléer l’Elu de Dieu. Sous le lourd rideau, la troupe des meurtriers se prépare à entrer en scène, et l’un d’entre eux tourne déjà vers les spectateurs sa tête casquée.

12- Balaam et l’ânesse, 1626, 63 x 46, Cognacq-Jay
Si les aveugles sont des voyants et des devins, il arrive parfois que les devins et les prophètes soient aveugles. L’histoire du prophète Balaam se lit dans les Nombres (22, 22-35) : Balaam est appelé par Balaq, roi de Moab, pour maudire le peuple juif qui sort d’Israël sous la conduite de Moïse et menace son royaume. Balaam se met en route juché sur son ânesse, mais Yahvé lui envoie un ange pour proscrire toute malédiction lancée contre le peuple élu. L’ânesse, voyante, aperçoit l’ange à l’épée flamboyante, et fait une certains nombre de détours pour l’éviter. Mais le devin, lui, ne voit rien. Il roue de coups le pauvre animal pour le contraindre à reprendre sa route. C’est alors que l’ânesse se tourne vers son maître et, comme les chevaux d’Achille, s’adresse directement à lui : « Que t’ai-je fait pour que tu m’aies battue ainsi par trois fois ? […] Ne suis-je pas ton ânesse, qui te sert de monture depuis ton jeune âge ? En cela, ai-je manqué à te servir ? » Quand l’ange enfin apparaîtra aux yeux de Balaam, le devin se prosternera à terre et reconnaîtra que la science de l’ânesse est supérieure à la sienne, et que la bête voit l’invisible là où le devin reste aveugle. Dans une composition confuse et resserrée, Rembrandt a peint la scène – c’est l’un de ses tout premiers tableaux : en 1626, il n’a que vingt ans – en donnant à l’ânesse la physionomie de la parole (fig. 12). Cette iconographie est extrêmement rare, et l’on peut imaginer que Rembrandt a été séduit par le charme populaire du conte, qui fait de l’âne – dont la douceur et la patience traversent l’ancien comme le nouveau testament, un voyant dont la sagesse est supérieure à celle de ceux qui passent pour savants aux yeux du monde. Rembrandt, sur ce tableau encore encombré et maladroit, s’inspire d’une composition de Pieter Lastman (fig. 13), un peintre italianisant qui travaillait à Amsterdam et dans l’atelier duquel le jeune Rembrandt, accompagné de son ami Jan Lievens, était venu en 1626 apprendre son métier.

13- Pieter Lastman, Baalam et l’ânesse, 40,3 x 60,6, Jérusalem
La composition de Lastman plus aérée, donne le premier rôle à l’ange ; celle de Rembrandt met en avant l’ânesse douée de parole et la gesticulation frénétique de l’aveugle prophète. Ce que lit Rembrandt dans la Bible, ce sont toujours des histoires très humaines, auxquelles il saura donner plus tard la solennité d’un rituel immémorial et plus qu’humain. Il ne s’agit ici encore que d’une saynète de comédie, mais il est frappant que l’un de ses premiers tableaux soit consacré à cette fable de la voyance et de l’aveuglement, pourtant négligée des peintres. Le peintre lui-même, est-il voyant comme l’ânesse ou aveugle comme le voyant ?
C’est surtout à une autre histoire d’aveugle, également empruntée à la Bible, que Rembrandt, tout au long de son œuvre, est demeuré fidèle, puisqu’il lui consacre l’un de ses premiers tableaux en 1626, Anna accusée par Tobit du vol d’un chevreau (fig. 14), et qu’on le retrouve trente-trois ans plus tard, dans une œuvre magnifique, aujourd’hui à Rotterdam (fig. 16). Il s’agit du Livre de Tobie, un récit emprunté à la tradition populaire, plein de saveur et de poésie, que les théologiens protestants jugeaient pour cette raison, et dans leur volonté d’épurer les Ecritures, apocryphe, mais que les catholiques, bien qu’avec réticence, reconnaissaient. Cette histoire d’aveugle est en vérité une histoire juive : Rembrandt aime à retrouver, dans l’ancien testament, des légendes simples et pathétiques qu’il déchiffre comme autant d’allégories de l’humaine condition. Il était une fois un homme juste, qui s’appelait Tobit. Il distribuait l’aumône, donnait du pain à ceux qui ont faim, des habits à ceux qui sont nus, et ensevelissait les morts selon le rite. Mais cet homme de Dieu, qui a commerce avec les morts et voit sans doute dans l’autre monde, devient aveugle après que des fientes d’oiseaux soient tombées sur ses paupières pendant son sommeil. Plongé dans les ténèbres, le voici semblable aux morts pour lesquels il accomplissait les derniers devoirs. Tobit aveugle est devenu voyant. Sur l’une de ses toutes premières œuvres, comme sur un petit tableau de la maturité, Rembrandt le représente dans une scène familière : Tobit reproche à sa femme Anna d’avoir volé un chevreau, qu’on lui a donné en vérité contre ses travaux de couture (fig. 14 et 15) :

14- Anna accusée par Tobit du vol d’un chevreau, 1626,
39,5 x 30, Rijksmuseum

15- Tobit, Anna et le chevreau, 1645,
20,8 x 28, Berlin, Gemäldegalerie
Scène de ménage, familière et familiale, aux mimiques théâtrales, dans la proximité du feu de cheminée, avec le chien qui nous regarde et qu’on retrouvera tout au long du récit. Comme dans les histoires d’Isaac, comme dans les histoires de Jacob, c’est le vieux père aveugle qui sait le chemin de vie que son jeune fils Tobie doit choisir, lui qui a deux yeux pour ne pas voir : il doit aller dans un pays lointain, chez un lointain cousin, pour prendre femme et revenir ensuite dans la maison paternelle. Tobie est un fils obéissant : il prend aussitôt la route, toujours accompagné de son chien, et se faisant un compagnon d’un voyageur de passage qui est en vérité l’ange Raphaël. Le récit se poursuit sur un ton de légende qui mêle le quotidien au fabuleux. En chemin, et sur les conseils de l’ange, Tobie pèche un gros poisson et en prélève le fiel, le cœur et le foie, pour confectionner un onguent qui a la vertu, selon Raphaël, de guérir les aveugles. Arrivé chez son parent Ragouël, il trouve femme selon son cœur et épouse Sarra après l’avoir délivrée d’un maléfice. Chargé de richesses en remerciement des bienfaits dont il a comblé la maison de son cousin, Tobie et Sarra, toujours accompagnés de Raphaël, prennent le chemin du retour. C’est surtout sur ce dernier épisode que s’est portée l’attention de Rembrandt. Alors que les peintres italiens (7) ont plutôt été sensibles à la majesté de l’ange et à la féérie du conte, Rembrandt s’attache aux scènes plus simplement humaines, et s’intéresse davantage à la détresse de l’aveugle qu’aux succès que le jeune homme doit à l’intercession de l’ange. Pendant cette longue absence, le père et la mère attendent le retour du fils, Anna se lamente de l’avoir perdu, et le père s’efforce, en vain de consoler la mère douloureuse (fig. 16) :

16- L’attente de Tobit et d’Anna, 1659, 40,3 x 54,
Musée Boijmans Van Beuningen, Rotterdam
Mais c’est surtout l’arrivée du fils tant attendu – c’est Anna, assise au dehors pour surveiller la route, qui l’aperçoit la première – et l’application de l’onguent qui rend la vue au vieux père, qui inspirent Rembrandt. Tobit se précipite vers la porte pour embrasser son fils, mais, aveugle, il renverse le rouet et, malgré le chien qui s’efforce de le remettre dans le bon chemin, manque la porte et se dirige droit dans le mur (fig. 17):

17- Tobit allant ouvrir à Tobie, 1651,
eau-forte, New York, Pierpont Morgan Library
Des dessins, des gravures, s’attardent sur le miracle de la guérison de l’aveugle, que Rembrandt curieusement représente comme une moderne opération de la cataracte, et non, comme le veut le texte, par le geste étalant la pommade sur les paupières (fig. 18 à 21). On a montré que, pour ces images, Rembrandt s’était inspiré de traités ophtalmologiques de l’époque, et l’on a même envisagé qu’il se soit renseigné auprès d’un spécialiste de l’œil, fameux chirurgien qui exerçait à Amsterdam et pratiquait alors cette opération délicate (8). Le stylet que semble manier Tobie ne ressemble-t-il pas à la pointe utilisée par l’artiste pour l’eau-forte ? Le crayon, la pointe sèche et le pinceau sont les baguettes magiques qui rendent la vue aux aveugles.

18- Tobie guérissant la cécité de son père Tobit, 1636,
Stuttgart, Staatsgalerie

19- Tobie guérissant la cécité de son père Tobit, Louvre
.jpg)
20- Tobie guérissant la cécité de son père Tobit
.jpg)
21- Tobie guérissant la cécité de son père Tobit
L’histoire de l’aveugle mêlait ce monde et l’autre monde, celui que voient ceux qui ont les deux yeux ouverts et l’autre monde que voient les aveugles. Quand tout est fini, cet hybride dangereux doit être purifié : Tobie retourne chez son père Tobit, le père aveugle recouvre la vue et revient en ce monde, et l’archange Raphaël, après s’être révélé aux yeux des mortels, remonte en paradis où siège Dieu le Père (fig. 22) :

22- L’ange Raphaël quittant Tobie, 1637, 66 x 52, Louvre
Au dernier grand aveugle de cette longue histoire, Rembrandt consacre un extraordinaire tableau, peut-être le dernier avant sa mort, dans lequel toute matière se dissout en lumière, où la chair entre dans un état gazeux qui n’est plus que vibration chromatique : c’est l’histoire du vieillard Syméon qui se tient au seuil du Temple où l’on porte l’enfant pour la cérémonie de la circoncision (fig. 23). Cet homme juste et pieux, qui attendait depuis de longues années le Messie, le reconnaît aussitôt et, prenant l’enfant des bras de Marie, entonne un hymne (« Nunc dimittis ») pour rendre grâce à Dieu d’avoir exaucé son vœu. Rembrandt semble nous dire, dans la proximité de la mort et sur le point de passer dans l’autre monde, que lui aussi chante avec Syméon : « Maintenant, ô maître, tu peux, selon ta parole, laisser ton serviteur s’en aller en paix » (Luc, 2, 29). Le vieil homme, aveugle, est prophète. Seuls les aveugles sont voyants.

23- Syméon et l’enfant Jésus dans le temple, 1669,
98 x 79, Stockholm, Nationalmuseum
Mais il est encore un autre moyen, pour les yeux ouverts, de s’aveugler sans baisser les paupières. Notre regard n’est lucide qu’à la condition de dominer la situation, de la tenir tout entière sous l’axe de notre perspective. Mais il se peut que le cours des choses se retourne contre nous, et que le malheur nous submerge, désormais esclaves et non plus maîtres des événements. Alors nos yeux sont comme destitués de la royauté qu’ils exercent sur les phénomènes et les larmes viennent brouiller puis effacer le champ de notre vision.

24- David jouant de la harpe devant Saül, 1657,
130,5 x 164, Mauritshuis
Sur le tableau de La Haye (fig. 24), longtemps discuté mais récemment rendu à Rembrandt, le roi Saül pleure et ses larmes, que le jeune David fait jaillir par la seule force de sa musique, l’aveuglent à moitié : par ce rideau dont le roi s’empare pour essuyer ses pleurs, il se fait cyclope, un œil passé derrière le rideau et l’autre de ce côté-ci, mais qui semble regarder dans le vide. « Le roi Œdipe avait un œil en trop, peut-être » écrivait Hölderlin (9). Un œil pour voir dans l’au-delà et deux yeux bien ouverts pour regarder de ce côté-ci. On ne saurait voir des deux côtés à la fois, pas plus qu’on ne peut servir deux maîtres à la fois. Entre ce monde et l’autre monde, entre l’extérieur et l’intérieur, entre les vivants et les morts, entre la raison et la démence, il faut choisir. Saül, comme Œdipe, est à la limite des mondes.
Le jeune David a été appelé au palais du roi pour jouer de la cithare (qui devient une harpe chez Rembrandt), seul remède aux crises de mélancolie qui assaillent le souverain. Le roi s’attache au musicien, mais devient jaloux de l’amour que lui voue le peuple après sa victoire sur Goliath, puis ses nombreux succès militaires. Saül est partagé : son cœur est reconnaissant à David de savoir mettre un baume sur ses souffrances, mais son âme est envieuse de cet écuyer qui a l’insolence de la jeunesse et à qui tout réussit. Dans des crises de fureur démentielle, le roi s’emparera de la lance qu’il tient sous sa main droite, et menacera David de le clouer au mur. En vain : l’Elu de Dieu saura esquiver le coup. Un œil dans les ténèbres, un œil dans la lumière. Le magnifique tableau de La Haye – comme a-t-on pu douter de son authenticité ? – habille le roi d’une robe d’apparat qui semble elle-même pleurer l’or et la pourpre, comme si Rembrandt lui-même, quand il avait peint cette vision, avait le regard brouillé par les larmes, comme s’il peignait avec ses larmes.

25- David jouant de la harpe devant Saül, vers 1629,
61,8 x 50,2, Francfort, Städelsches Kunstintitut
Que le roi Saül soit devenu cyclope, frappé de folie par l’ambivalence de son cœur, est sensible encore sur ce tableau de près de trente ans antérieur, qui remonte aux premières années, mais déjà saisissant, et qui témoigne pour la forte impression que cette scène faisait sur l’esprit de Rembrandt (fig. 25) : il semble cette fois que Saül soit effectivement borgne, d’âme comme de corps, son œil gauche étant occulté et comme recouvert de peau tandis que l’œil droit se tourne férocement vers le jeune harpiste. Le roi, pris d’une insurmontable colère, serre de sa main crispée la lance avec laquelle il s’apprête à assassiner son serviteur. Mieux vaut la cécité complète plutôt que la torture de la double vue, comme le montre ce qui est peut-être un dessin préparatoire, ou du moins une esquisse autour de ce thème insistant (fig. 26) :

26- David jouant de la harpe devant Saül (atelier de Rembrandt),
Louvre, Arts graphiques
Nous l’avons dit : ce n’est pas seulement Saül qui pleure, bouleversé par la harpe de son serviteur David, c’est la robe royale qui pleure avec lui, en un flux de lumière qui mélange l’or avec le carmin et l’émeraude avec le safran (fig. 24) ; et c’est Rembrandt qui pleure avec le roi, en inventant cette vision qui semble tout entière traversée par l’écoulement des larmes. De la même façon, ce n’est pas Saül qui est borgne, c’est peut-être Rembrandt lui-même qui se représente dans le roi accablé par la mélancolie. Le peintre ne s’est-il pas représenté lui-même, dans nombre de ses autoportraits, comme une sorte de roi borgne (fig. 27) ?

27- Autoportrait, 1658, 131 x 102,
New York, Frick Collection
Le voici, souverain, comme assis sur un trône, vêtu d’une étrange robe d’or qui fait songer à celle de Saül, couvert d’une lourde cape qui ressemble à celle qui pèse sur les épaules de Saül, et tenant à la main cette longue canne – serait-ce l’appuie-main ? – qui ressemble à la lance du roi d’Israël. Certes, il tourne vers nous ses deux yeux, mais le chapeau noir les voile d’une ombre, comme un mauvais présage annonciateur de la cécité. Le portrait, se plaît-on à répéter, est un art qui concentre l’expression dans le visage et les mains. Il est tout à fait remarquable que les autoportraits de Rembrandt cherchent systématiquement à voiler, et même à dissimuler les yeux, comme si le peintre cherchait à occulter ce regard qui lui revient comme d’un autre par la médiation du miroir. Sur de nombreux autoportraits, le jeu de l’éclairage, plongeant un œil dans les ténèbres et jetant sur l’autre le faisceau de la lumière, fait un portrait du peintre en cyclope. Sur ce portrait qui le fait étrangement ressembler au Saül de Francfort (les deux tableaux sont contemporains), par la plume sur le chapeau comme l’aigrette sur le turban royal, Rembrandt est à son tour devenu borgne (fig. 28) :

28- Autoportrait avec une plume au béret, 1629,
89,7 x 73,5, Boston, Isabella Stewart Gardner Museum
Sur tous les autres autoportraits – ou presque – le regard est ou bien dissimulé dans l’ombre, ou bien déséquilibré par le clair-obscur, un œil en pleine lumière et l’autre dans les ténèbres (fig. 29 à 34) :

29- Autoportrait, entre 1628 et 1629,
huile sur chêne, 2,6 x 18,7, Rijksmuseum

30- Autoportrait, 1628, Cassel

31- Autoportrait, 1629, 15,5 x 12,7, Munich

32- Autoportrait au béret de velours, 1634, 58,3 x 47,5, Berlin

33- Autoportrait, 1629, 37,5 x 29, Mauritshuis
(attribution aujourd’hui discutée)

34- Autoportrait au gorgerin, vers 1629, 38 x 30,9, Nuremberg
Le peintre lui-même serait-il aveugle ? Qui est aveugle ? Tobit, qui devine l’avenir et sait les chemins que doit prendre son fils, ou son fils Tobie, qui a pourtant l’usage de ses yeux, mais qui ne saurait s’orienter sans son guide Raphaël ? Sur le David jouant de la harpe devant Saül du Mauritshuis (fig. 24), la théologie de l’aveuglement se redouble d’une méditation sur la musique. Ce qui sauve le roi de la malédiction qui le frappe, ce n’est pas la vue qui réjouit ses yeux – ce jeune homme dont on vantait la beauté et dont il a fait son écuyer lui inspire plutôt une fureur envieuse – mais c’est bien la musique qui vient frapper ses oreilles, unique remède qui sait dissiper les noires vapeurs de la mélancolie. Entre l’œil et l’oreille, entre l’image et le chant, Rembrandt, avec Calvin, choisit l’invisible contre le visible, et ne peut sauver la peinture de ce péché originel qui corrompt la vision de la créature déchue qu’en faisant du tableau le miroir, non de ce monde visible, mais de l’autre, invisible, où l’on voit rayonner les âmes depuis le foyer secret des cœurs. La peinture italienne, fascinée par le spectacle du monde, par le théâtre du monde, manque l’autre scène, tout intérieure, où la pensée s’aperçoit elle-même, dans le secret de son intimité, dans la lueur d’une flamme toute spirituelle. La peinture italienne, fascinée par le décor, se laisse leurrer et tombe dans le miroir aux alouettes ; la peinture hollandaise, prémunie contre les pièges du visible, ferme les yeux du corps pour apercevoir avec les yeux de l’âme. C’est à l’adoration que nos yeux vouent au monde visible que nous devons le péché de l’idolâtrie qui, selon Calvin, nous détourne du dieu vivant et nous fait nous prosterner devant des choses mortes, privées d’âme et seulement matérielles. Toute la réforme est fondée sur cette profession de foi iconoclaste, contre l’idolâtrie qui pervertit l’authenticité d’une foi tout intérieure et la divertit sur le théâtre extérieur du cérémonial somptueux et théâtral de la catholicité. Les yeux de chair, éblouis par la beauté sensible, sont aveugles à la vérité de l’esprit. Après tout, que voyons-nous du monde ? Nous disons que nous voyons cette femme, ce fruit, ce paysage, comme l’artiste abusé peut croire qu’il voit, en ce miroir, une image de lui-même. En vérité, nous ne voyons jamais les choses mais seulement la lumière diversement réfléchie ou absorbée par les éléments de la matière. Je n’ai jamais vu cette rose, je ne vois que la lumière que renvoie vers mes yeux cette chose inconnue que je nomme une rose. Le visible est un immense jeu de lumière qui éblouit l’esprit et le détourne de se considérer lui-même dans la clarté intérieure de la conscience de soi. La religion de Rembrandt n’est certainement pas très orthodoxe, elle ressemble fort à un humanisme qui se résume en une leçon de charité et de pitié pour les hommes qui meurent. Mais il est certain que la terrible diatribe que Calvin a lancée contre le culte des images ne laisse pas les peintres du Nord, et Rembrandt tout particulièrement, indifférents. Rembrandt invente une peinture radicalement nouvelle, qui entreprend de n’être pas idolâtre, une peinture qui se fait volontairement aveugle pour devenir voyante. Dans les Confessions, Augustin, au chapitre 33 du livre X, reconnaît que le chant liturgique peut contribuer à l’élévation de l’âme vers Dieu, bien qu’il exerce sur les esprits un charme délectable qui tend à le faire aimer pour lui-même et, ainsi, oublier Dieu. Mais dans le chapitre suivant, le chapitre 34, consacré à la concupiscence des yeux, l’évêque d’Hippone instruit contre la volupté du visible un procès sans appel : la vraie lumière n’est pas celle qui illumine nos yeux de chair, mais celle qu’on voit avec « des yeux invisibles » (erigo ad te invisibiles oculos), dans la lumière intérieure des âmes en lesquelles seules est présent le Dieu vivant. Et Augustin, en un passage célèbre – comment Rembrandt aurait-il pu le méconnaître ? – fait l’éloge passionné de tous les grands voyants, qui sont aussi des aveugles aux yeux de ces autres aveugles qui ne vivent qu’en ce monde : « O lumière que voyait Tobie quand, avec ses yeux d’aveugle, il montrait à son fils la route de la vie (via vitae) et l’y précédait du pied de la charité sans jamais s’égarer ! Lumière que voyait Isaac quand, ses yeux charnels, appesantis et voilés par la vieillesse, il mérita, non de bénir ses enfants en les reconnaissant, mais de les reconnaître en les bénissant ! Lumière que voyait Jacob, quand, devenu lui aussi aveugle à cause de son grand âge, il éclaira des rayons de son cœur illuminé les générations du peuple futur, préfigurés par ses fils, et qu’à ses petits enfants, les fils de Joseph, il imposa ses mains mystiquement croisées, non comme voulait les disposer leur père, qui voyait avec les yeux du dehors, mais de son propre discernement intérieur (sicut ipse intus discernebat) ! Voilà la vraie lumière, elle est une et ne fait qu’un avec ceux qui la voient et qui l’aiment. » (10) C’est une formule que, depuis Isaïe, on retrouve souvent dans les Ecritures : la créature corrompue par le péché a des yeux pour ne pas voir, elle est d’autant plus aveugle à Dieu qu’elle est avide de spectacles dans la lumière de ce monde, et qu’elle se tourne avec les « aveugles amants de ce siècle » (saeculi caecis amatoribus) vers leurs « délicieuses lassitudes » (in deliciosas lassitudines) (11) : « Ils n'ont ni intelligence, ni entendement, Car on leur a fermé les yeux pour qu'ils ne voient point, Et le cœur pour qu'ils ne comprennent point. » (Isaïe, 44, 18).
Pour les yeux qui se laissent flatter par la lumière du soleil, c’est quand le jour se lève que le spectacle du monde se découvre en majesté. Mais pour les yeux de l’âme qui plongent, avec le troisième œil, dans le secret des cœurs, c’est la nuit qui est le temps véritable de la révélation. Rembrandt est l’inventeur de ce qu’on pourrait appeler le « nocturne spirituel », qui s’apparente à ce chant qui connaîtra précisément son apogée au XVIIe siècle : les leçons de ténèbres. Aux yeux de Rembrandt, la nuit est voyante et le jour est aveugle. Les ténèbres sont habitées, on y devine des présences encore latentes qui rôdent dans les marges.

35- Le repos pendant la fuite en Egypte, 1647,
34 x 48, Dublin, National Gallery of Ireland
Sur ce repos pendant la fuite en Egypte (fig. 35), Rembrandt s’inspire d’une toile célèbre d’Adam Elsheimer (1609), qui avait beaucoup impressionné Pieter Lastman – dont Rembrandt fut pendant six mois l’élève à Amsterdam – et qui renouvelait déjà ce thème iconographique (fig. 36) :

36- Adam Elsheimer, La fuite en Egypte, 1609,
31 x 41, Munich, Alte Pinakothek
Elsheimer imaginait un nocturne qui tenait compte des dernières découvertes de la science d’observation, il découvrait aux yeux du spectateur l’univers infini qui apparaît quand disparaît le monde clos de l’antiquité, du moyen âge et de la renaissance. On devine sur le tableau d’Elsheimer la voie lactée, les taches sur la lune conformes aux premières cartes dressées à l’aide de la lunette astronomique, les étoiles essaimées dans le ciel, et l’on prétend même que l’artiste aurait corrigé notre satellite après avoir lu le Messager des étoiles (Sidereus nuncius) publié par Galilée en 1610. Le nocturne luministe d’Elsheimer est d’une exactitude optique rigoureuse, et la lune – cet astre mort qui évoque l’œil lumineux du cyclope, celui qui voit dans les ténèbres, soit le troisième œil d’Œdipe – se reflète dans l’étang conformément aux lois de l’optique géométrique. Chez Rembrandt, tout vibre au contraire dans le velouté magique d’un clair obscur à la fois impalpable et palpitant. Ces ténèbres sont habitées de multiples présences : le berger et l’enfant, penchés sur le feu et suivis du troupeau qui les accompagne dans la nuit ; un peu plus loin sur le chemin, on devine un autre paysan qui vient avec ses bœufs une lanterne à la main ; plus loin, il est possible de discerner encore une autre silhouette, quasi invisible. Au loin, dans l’imposant château qui domine la plaine, quelques fenêtres sont allumées. La nuit est habitée. Les arbres frémissent dans le vent, l’eau se ride sous le souffle nocturne, le ciel est assombri par de lourdes nuées. On ne voit ni les étoiles ni la lune, toute la scène est bien ancrée sur la paix de la terre et le repos de la halte. La nuit de Rembrandt n’est ni naturelle ni physique, moins encore astronomique, elle est surnaturelle et magique. Autour de la flamme qui réchauffe et rassemble, dans le halo nocturne qui assiège le cercle de lumière, des présences confuses remuent vaguement. Il y a toujours, dans le nocturne rembranesque, des anges qui passent furtivement, comme dans la nuit nuptiale, auguste et solennelle du poème de Hugo, où des anges volent obscurément, « Car on voyait passer dans la nuit par moment / Quelque chose de bleu qui paraissait une aile ».

37- Jérémie pleurant sur la destruction de Jérusalem,
1630, 58 x 46, Rijksmuseum
C’est ainsi encore qu’autour de Jérémie qui pleure sur Jérusalem saccagée (fig. 37), on devine, si l’on regarde très attentivement, un ange dans le ciel au-dessus du dôme du Temple incendié, et brandissant de la main droite une torche allumée, un homme sur une échelle qui monte vers le sanctuaire, à moins qu’il ne descende, tout un peuple armé qui se rassemble sous une voûte, et un homme qui fuit, les deux mains sur ses yeux, encore un aveugle ! puisqu’il s’agit de Zekedia, le dernier roi de Jérusalem, capturé par l’armée de Nabuchonodosor et dont les yeux ont été brûlés. La manière de Rembrandt, floue et indistincte en apparence, est en vérité d’une incroyable précision.

38- Le reniement de Pierre, 1660, 154 x 169, Rijksmuseum
Sur l’extraordinaire Reniement de Pierre du Rijksmuseum (fig. 38), qui semble couver une sorte de feu intérieur, vu dans la nuit sous une lumière qui n’est pas de ce monde, comme une image de mémoire qui persiste dans le temps, imprimée dans l’âme par le nocturne de la culpabilité, on devine aussi quantité de présences qui hantent la nuit, et parmi elles on imagine le Christ assistant à sa propre trahison. Pierre tente de fuir le regard scrutateur du soudard et les questions insistantes de la petite maline qui vient d’identifier l’apôtre (elle me fait penser personnellement à L’entremetteuse de Gerrit van Honhorst, 1625), avec ce merveilleux jeu de mains / jeu de vilains en clair obscur, et toute cette compagnie pullulant dans la nuit, dont le gardien du Royaume, épouvanté, cherche vainement à s’affranchir. Si le jour est ébloui, la nuit est pour Rembrandt merveilleusement vivante, peuplée de créatures incertaines. Le nocturne rembranesque est plus temporel que spatial : c’est dans l’espace de la mémoire que s’effectue cette plongée dans l’ombre, dans la nuit des temps où flottent de très anciens souvenirs. Et ces palais approximativement orientaux, creusés de galeries, de voûtes et de cavernes, c’est le réseau labyrinthique d’une réminiscence occupée à sonder la profondeur de son passé. Pour celui qui ouvre les yeux dans la lumière du jour, l’espace est rigoureusement balisé, et l’on sait que la géométrie est née de l’arpentage. Mais pour l’aveugle, l’espace qu’il ne saurait embrasser d’un seul coup d’œil est une expérience vécue dans le temps plutôt qu’une estimation, faite d’un seul coup d’œil, de l’étendue qui se prolonge jusqu’à l’horizon. Pour l’aveugle, le mur contre lequel va bientôt se fracasser Tobit n’est pas à quelques mètres, il est à quelques secondes. L’espace en lequel baignent les personnages bibliques de Rembrandt, créatures venues à nous d’un très lointain passé, n’est pas l’espace, mais le temps, ce milieu dense où nous progressons périlleusement et sombrons lentement. Il faut encore ici écouter Claudel : « Tous ces portraits autour de nous [il s’agit de Rembrandt] […] ils ont fait connaissance avec la nuit, ils reviennent vers nous moins repoussés qu’arrêtés par un milieu plus dense, tout baignés d’une lumière empruntée à la mémoire, ils ont pris conscience d’eux-mêmes […] Dans leur route vers le néant, ils ont fait demi-tour. Ils ont réussi dans le définitif ce que notre mémoire infirme, à tâtons, essayait de réaliser […] De là vient cette atmosphère toute spéciale qui s’exhale des tableaux et de la gravure de Rembrandt, celle du songe, quelque chose d’assoupi, de confiné et de taciturne, une espèce de corruption de la nuit, une espèce d’acidité mentale aux prises avec les ténèbres, et qui sous nos yeux continue indéfiniment sa rongeante activité. » (12) Il y a, écrit encore Claudel « …sous l’esprit, et comme dans les soubassements du temple de Jérusalem, des réserves, des magasins sans fond, où les standards et les symboles, produits et élaborés par le passé, continuent à macérer dans le temps, et, revêtus d’un sens nouveau, à entretenir avec tous les moments du roman de la durée tel qu’il continue son cours sous le soleil des vivants, des rapports occultes… » (13) Et quelques lignes plus loin encore : « Nulle part devant un tableau de Rembrandt, on n’a la sensation du permanent et du définitif : c’est une réalisation précaire, un phénomène, une reprise miraculeuse sur le périmé : le rideau un instant soulevé est prêt à retomber, le reflet s’efface, le rayon en biaisant d’une ligne anéantit le prestige, le visiteur qui était là tout à l’heure a disparu, c’est à peine si nous avons eu le temps de le reconnaître dans l’instant de la fraction du pain, ou, s’il est encore là, à cette insistance solennelle, à cette émersion magique, on pourrait dire plutôt qu’il survit. » (14)
On pourrait comparer enfin le nocturne chez Rembrandt, cette palpitation de l’Or et de l’Ombre, à un combat presque amoureux du jour avec la nuit, de la lumière avec les ténèbres, du souvenir avec l’oubli, de la présence avec l’absence. Rembrandt en a donné une extraordinaire image dans ce combat de Jacob luttant avec l’ange (fig. 39), ce combat au terme duquel Jacob reçut son vrai nom – Israël – et, blessé par l’ange, comme tous ceux qui ont traversé les rites de l’initiation, boite désormais (le boiteux, le borgne et le gaucher ont partie liée avec l’autre monde).

39- Jacob luttant avec l’ange, 1659, 137 x 116, Berlin, Gemäldegalerie
Ce n’est pas une lutte, plutôt une étreinte, un autre combat de Tancrède et Clorinde, dans la palpitation brasillante de l’or, de la pourpre et du brun, l’enlacement puissant et tendre de la lumière adoucie par la couleur et de l’ombre illuminée par le feu qui couve sous les braises. Chacun découvre l’autre comme deux aveugles qui se reconnaissent à tâtons, dans une sorte d’illumination intime qui les unit bien au-delà du visible. De cet accouplement, La fiancée juive du Rijksmuseum offre une version sans doute plus apaisée, mais non moins recueillie, de la même caresse :

40- La fiancée juive (Isaac et Rébecca), 1667,
121,5 x 166,5, Rijksmuseum
C’est ainsi que, sur les tableaux de Rembrandt, l’ombre travaille la lumière, lutte et s’unit avec elle en un jeu sans fin. Ce corps à corps n’est pas antagonisme mais plutôt fusion, un exercice somnambulique et patient accompli depuis la nuit des temps, et qui s’achève sur une bénédiction. « Lâche-moi », implore l’ange tandis que se lève l’aurore ; « Je ne te lâcherai pas que ne m’aies béni » répond Jacob. Et l’ange disparaît dans le jour, sans avoir révélé son nom, mais après donné sa bénédiction à celui qui a été révélé à lui-même et connaît désormais son véritable nom.
NOTES
1- Valéry, La Poétique de l’esprit, dans Variété, Pléiade, Œuvres, I, p. 1040
2- Dans le catalogue de la collection Ruffo, le tableau est ainsi décrit : « Aristote la main posée sur une statue, demi-figure grandeur nature ».
3- Roger de Piles, Cours de peinture par principes, préface de Jacques Thuillier, « Tel », Gallimard, 1989, p. 161.
5- « Saunderson voyait donc par la peau ; cette enveloppe était donc en lui d’une sensibilité si exquise, qu’on peut assurer qu’avec un peu d’habitude, il serait parvenu à reconnaître l’un de ses amis dont un dessinateur lui aurait tracé le portrait sur la main, et qu’il aurait prononcé, sur la succession des sensations excitées par le crayon : C’est monsieur un tel. Il y a donc aussi une peinture pour les aveugles, celle à qui leur propre peau servirait de toile » (Œuvres philosophiques, Garnier, 1964, p. 117).
7- Par exemple Botticelli, Pollaiuolo, Gerolamo Savoldo…
8- « On a même envisagé la possibilité que Rembrandt se soit informé auprès de Job van Meekeren, spécialiste en chirurgie de l’œil vivant à Amsterdam, car cette opération n’était pas pratiquée par les chirurgiens ordinaires qui se contentaient d’extraire les calculs biliaires ou de réduire les fractures » (S. Schama, Les yeux de Rembrandt, 2003, p. 482). « Tobias et sa mère s’affairent étrangement auprès du vieil aveugle ; dans son dos, la scène des mains, manœuvre ou manipulation, évoque une opération proprement chirurgicale, je n’ose pas, pas encore, dire graphique. Tobias semble tenir un instrument styliforme, quelque point à gravure ou scalpel. D’ailleurs l’envoi du dessin de Versailles au Louvre en 1803 porte la mention : « Chirurgien pensant un blessé lavé au bistre sur papier blanc ? Rembrandt » (Derrida, Mémoires d’aveugles. L’autoportrait et autres ruines, REM, 1990, p. 33). Les curieux pourront se reporter à un ouvrage de Job van Meekeren, traduit du flamand au latin par un certain Abraham Blasius : Jobi à Meek'ren, Chirurgi Amstellodamensis, Observationes Medico-Chirurgicae, Ex Belgico in Latinum translatae ab Abrahamo Blasio, Amsterdam, 1682 ; on trouvera dans l'Appendice « Observationum Medico-Chirurgicarum Posthumarum » (p. 345-392), un chapitre en partie consacré à l'intervention de la cataracte : Capitulum XII, « De processu Oculi ciliari », p. 381-383.
9- En bleu adorable (In lieblicher Bläue…), Pléiade 939-941
10- A l’inverse de la lumière des yeux qui se tournent vers l’extérieur, et ainsi écartèle l’âme en l’arrachant à sa propre intériorité. L’âme dans le monde est en exil, elle ne revient dans sa vraie patrie que quand elle revient en elle-même.
11- Trabucco (Garnier, Les Confessions, éd. bilingue, 1950) traduit : « d’énervantes délices » ; et la Pléiade (sous la direction de Jerphagnon) : « délicieuses lassitudes ».
12- Claudel, La peinture hollandaise, dans la bibliothèque de la Pléiade, Œuvres en prose, 1965, p. 195.
14- Id. p. 197.
Pour lire le chapitre suivant, consacré à « Vermeer », cliquer ICI
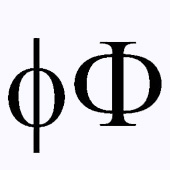



















.jpg)
.jpg)


















