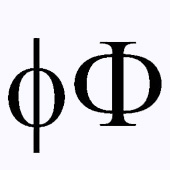|
PETIT ECHANGE AVEC CHATGPT
APHORISMES
ETRE ET EXISTER
ENSEIGNER LA PHILOSOPHIE
ESTHETIQUE DE L'ABSTRACTION
PRINCIPES DE PHILOSOPHIE ESTHETIQUE
LA PEINTURE HOLLANDAISE AU SIECLE D'OR
LES FANTOMES DE L'OPERA
ON DEVRAIT DIRE...
QU'EST-CE QUE LE NEOREALISME ?
LA STAR, LA VIVANTE ET LE SANS POURQUOI
ESTHETIQUE DU PARADIS TERRESTRE (1)
LE REALISME SELON CEZANNE
NOTE SUR WITTGENSTEIN
ENTRETIEN
CEZANNE ET LA FORCE DES CHOSES
MANTEGNA : ANCIENS ET MODERNES
LE TABLEAU ET LE MIROIR
LE JARDIN A LA FRANCAISE
REMBRANDT, BETHSABEE
PHILOSOPHIE ET RHETORIQUE (bibliographie)
PHILOSOPHIE ET RHETORIQUE (1)
PHILOSOPHIE ET RHETORIQUE (2)
LES RELIGIONS DU LIVRE
DU CARACTERE A LA CARICATURE
QUELLE VANITE QUE LA PEINTURE...
LES GROTESQUES
LE ROSSIGNOL ET LA DIVA
LA STATUE AMOUREUSE
L'INTERPRETATION DE L'OEUVRE D'ART
DE L'IDEE DU BEAU A L'ESTHETIQUE
CARAVAGE ET L'OPERA
|
PHILOSOPHIE ET RHETORIQUE (2)
Premier semestre, année 2003-2004, Paris 4
(mis en ligne le 2-1-2008)
I- La naissance de la rhétorique : Protagoras et Platon
II- La tradition rhétorique
III- Rhétorique et liberté politique
IV- Rhétorique et pédagogie
V- La rhétorique de la conversation
VI- Rhétorique et modernité
On lira dans ce document la suite et la fin de la leçon intitulée « Philosophie et Rhétorique », correspondant aux chapitres III à VI.
L’histoire de la rhétorique, qui finit par se figer en un dogmatisme qui se condamne lui-même à la répétition, est alors celle d’un renversement du pour au contre : née de l’exercice de la liberté politique dans la cité athénienne, elle devient un code des convenances et des bienséances et, sous la forme de la rhétorique panégyrique ou épidictique (rhétorique d’apparat), un exercice de virtuosité gratuite ou de basse flagornerie exécuté pour l’unique bon plaisir du prince. C’est là sans doute la conséquence du conformisme latent, dénoncé par Platon, qui conduit le sophiste à aliéner la vérité au vraisemblable et la science à l’opinion. Mais c’est encore un effet de l’histoire des institutions : l’art oratoire paraît dans toute sa majesté dans l’Athènes démocratique du Ve siècle, et renaît avec Démosthène au IVe siècle pour la défense ultime et désespérée des cités grecques tombées sous le joug macédonien. L’éloquence délibérative était encore grande aux temps de la république romaine, et les tribuns du peuple, à commencer par les Gracques, étaient d’abord de superbes orateurs. En revanche, cette même éloquence pâlit sous l’empire, quand la pax romana mit un terme à la violence des conflits et des harangues. Tacite, alors jeune orateur (il a alors 27 ans) compose en 75 un Dialogue des orateurs, dans lequel il médite sur l’histoire des lettres et le destin de la rhétorique. La première partie oppose l’idéal de l’orateur du temps, non plus tribun politique mais avocat riche et fameux par sa défense de causes célèbres (Aper), engagé dans les affaires et la vie politique, et l’idéal du poète (Maternus) qui se détourne de la vie publique et du chemin des honneurs pour se perdre dans « les bocages et dans les bois », « dans des lieux purs et innocents où l’âme se retire et goûte la jouissance d’un séjour sacré » (XII) ; la seconde et dernière partie porte sur la supériorité des Modernes sur les Anciens (Aper) ou des Anciens sur les Modernes (Messalla), en ce qui concerne l’art rhétorique. Malgré le désir de Tacite de tempérer les divers arguments, on sent que son cœur va aux accusateurs du temps présent, qu’il est tenté de se réfugier avec le poète hors de la vie publique et que, surtout, il partage l’idée d’un déclin de la rhétorique lié au déclin de la liberté politique. L’austérité des mœurs et la violence des passions politiques nourrissaient autrefois l’ampleur et le courage du discours prononcé devant le peuple. La parole, non la naissance, conduisait alors au pouvoir : aussi l’art oratoire était-il l’objet de tous les soins : « On était forcé de se présenter devant le peuple, au Sénat il ne suffisait pas d’expliquer brièvement son vote, si l’on était pas capable de défendre son avis avec talent et éloquence, ou bien, impliqué dans une calomnie ou une accusation, il fallait répondre sans emprunter la parole d’un autre, quand on voulait témoigner en faveur d’un ami dans un procès même politique, on était forcé de le faire non pas de loin et par écrit, mais de vive voix et devant le tribunal » (XXXVI). Aussi les anciens orateurs, pour donner de la consistance à leurs discours, ne se contentaient-ils pas d’une vague culture générale, mais s’appuyaient sur de solides connaissances : « Tous les discours de Cicéron le laissent voir : géométrie, musique, grammaire, aucun des arts libéraux (ingenuæ artis scientiam) ne lui était étranger […] Les anciens orateurs possédaient le droit civil, et avaient une teinture de grammaire, de musique, de géométrie […] Un orateur digne de ce nom arrivait alors au forum armé de toutes ses connaissances, comme le soldat à la bataille pourvu de toutes ses armes » (XXX, XXXI et XXXII). Car la rhétorique est comme le courage militaire : il lui faut la guerre pour s’exercer. Enfant, le futur orateur, cet « élève du forum » (fori auditor) « assistait aux plaidoiries même par courtes répliques, était présent aux discussions violentes et apprenait pour ainsi dire à combattre au milieu même de la mêlée » (XXXIV). Il faut le théâtre de la république et ses débats véhéments et cruels (la mort étant souvent le prix de la défaite) pour que l’art oratoire s’élève jusqu’au sublime : « La grande éloquence (magna eloquentia), comme la flamme, a besoin de matière pour s’alimenter, de mouvement pour se ranimer, et c’est en consumant qu’elle brille […] Si les orateurs de notre temps ont acquis toute l’influence compatible avec un gouvernement régulier, paisible et heureux, les désordres et la licence (perturbatione ac licentia) n’en offraient pas moins autrefois une plus vaste carrière. Alors en effet, dans la confusion générale et dans l’absence d’un chef unique, on était un orateur habile en proportion de l’ascendant qu’on pouvait exercer sur un peuple sans guide. De là de continuelles propositions de lois et un nom populaire ; de là ces harangues de magistrats qui passaient à la tribune presque la nuit tout entière ; de là les accusations dirigées contre les hommes les plus influents et ces inimitiés qui s’attachaient même à des familles ; de là la politique factieuse de la noblesse et la lutte continue du Sénat et de la plèbe. Tout cela n’était pas sans déchirer l’Etat, mais exerçait l’éloquence de ces époques lointaines et semblait lui promettre à l’envi de grandes récompenses » (XXXVI). Sous l’empire, l’orateur politique devenu avocat d’affaires consacre tout son art à des causes anecdotiques et futiles ; autrefois le salut de l’Etat était en jeu : « Quelle différence, s’exclame Messalla, d’avoir à parler sur un vol, une formule ou une ordonnance extraordinaire du préteur, ou bien sur la brigue dans les comices, sur des alliés dépouillés ou des citoyens massacrés ! […] La puissance du talent grandit avec l’ampleur du sujet, et l’on ne saurait prononcer un discours brillant et lumineux sans avoir trouvé une cause digne de l’inspirer » (XXXVII). Certes, le gouvernement du « divin Auguste a apporté une longue période de calme, des loisirs continus pour le peuple, la tranquillité au Sénat » XXXVIII), mais l’éloquence se meurt dans cette paix qui étouffe toute revendication : « Personne n’ignore qu’il est plus utile et meilleur d’éprouver les bienfaits de la paix plutôt que les souffrances de la guerre ; cependant, les guerres produisent plus de héros (bonos proeliatores) que la paix » (XXXVII). Pour Tacite, ce n’est pas l’éloquence qui, par son conformisme et son idolâtrie de l’opinion, se fige en un code incapable de se réformer, c’est l’ordre instauré par l’empire qui bâillonne la liberté de parole et fait taire la grande voix du rhéteur.
On trouve des accents fort semblables dans un texte sans doute contemporain du dialogue de Tacite, le Traité du sublime (Peri hupsous, « Du style élevé ») rédigé en grec par un maître de rhétorique qui nous est inconnu, autrefois identifié avec le rhéteur Longin. L’idée, chère à Tacite, que la parole enflammée se nourrit, telle le feu, de ce qu’elle consume, est reprise magnifiquement par l’Anonyme : « Démosthène, grâce à la force, grâce aussi à la rapidité, à l’élan, à la violence irrésistible qui le mettent en état de tout brûler, de tout mettre en pièces en même temps, pourrait être comparé à une trombe ou à la foudre. Cicéron, à mon sens, tel un incendie qui se propage, dévore tout autour de lui, se déroule de toutes parts avec un feu abondant et durable, sans cesse en combustion, qui se porte à la fois d’un côté et d’un autre et qui se nourrit par sa continuation et sa succession mêmes » (XII, 4). Et s’interrogeant, comme Tacite, sur le déclin de la rhétorique dans la Rome du 1er siècle de notre ère, l’Anonyme l’attribue à la fin de la démocratie et à l’ordre étouffant établi par l’Empire depuis Auguste : « Doit-on accepter la fameuse opinion courante selon laquelle la démocratie est une excellente nourrice des grands génies, que c’est peut-être avec elle seule que les grands orateurs ont brillé et se sont éteints ? La liberté est apte à nourrir les sentiments des génies sublimes, à inspirer leurs espérances, et en même temps à répandre le penchant pour une rivalité réciproque et pour l’émulation en vue du premier rang […] Mais nous, actuellement, nous paraissons avoir été élevés à l’école d’une servitude légale (douleias dikaias) ; dès les tendres années de notre conscience, nous avons été emmaillotés, pour ainsi dire, dans les mêmes coutumes et dans les mêmes habitudes ; nous n’avons pas goûté à cette source si belle et si féconde en discours, j’entends la liberté. Aussi ne sommes-nous, en fin de compte, que de sublimes flatteurs » (XLIV, 2-3). La culture rhétorique suppose donc l’épanouissement d’un homme libre, que le carcan des lois n’opprime pas, et qui peut donner toute sa mesure par la puissance du verbe. La voix de l’orateur a besoin de grands espaces pour s’épancher librement (ne parle-t-on pas du « volume » d’une voix ?), et son art s’étiole quand le despote exige qu’on baisse le ton. Tacite le disait à sa façon : « De même que la valeur du cheval s’établit sur un vaste espace, de même, pour les orateurs, il y a comme une carrière : s’ils ne peuvent s’y lancer libres et sans entraves, l’éloquence se paralyse et s’évanouit » (XXXIX). De cette vie étriquée en laquelle se meurt la véhémence de la parole, Tacite-Messalla voit alors une image dans le costume des modernes, plus serré au corps, plus ajusté que les amples toges des Anciens : « Quel abaissement ne croyons-nous pas que l’éloquence a subi du fait de ces vêtements étroits, où nous sommes serrés et comme emprisonnés pour causer avec les juges ? » (ibid.). De même l’Anonyme, citant Homère (fragment perdu), compare les Modernes à des créatures estropiées par l’étroite prison où ils sont contraints de survivre : « Homère l’a dit : "Le jour de la servitude enlève au mortel la moitié de sa valeur." Donc, ajoutait-il, si ce que j’entends dire mérite créance, de même que les boîtes où l’on élève les Pygmées, qu’on appelle des nains, non seulement arrêtent la croissance de ceux qui y sont enfermés, mais encore estropient leurs membres à cause des liens qui les enserrent, eh bien, de même, toute servitude, fût-elle la plus juste, pourrait être déclarée la cage et la prison publique de l’âme » (XLIV, 5). La légende selon laquelle le nanisme des Pygmées serait un effet de la culture, et non de la nature, provient du Problème X (12) d’Aristote. L’éloquence publique est un art qui n’appartient qu’aux géants anciens ; les nains modernes n’osent plus prendre la parole. Cette rhétorique virile et enflammée, art de la harangue ou rhétorique du tribun, nous la retrouverons pendant la révolution française : les orateurs qui se succèdent à la tribune connaissent par cœur les Vies parallèles de Plutarque, et leurs imaginations comme leurs discours sont envahis de références à l’héroïsme déclamatoire et à l’idéal de la cité antique. C’est chez Rousseau que, dès 1750 (Discours sur les sciences et les arts) et plus encore en 1755, avec le Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes, renaît le style enflammé de Démosthène vitupérant contre les ambitions despotiques de Philippe de Macédoine, tel Rousseau lui-même condamnant la corruption des mœurs et l’inégalité qui règnent sous la monarchie.
Il est pourtant permis de se demander, si la rhétorique est ainsi liée, depuis Protagoras, au destin de la démocratie athénienne ou de la république romaine, ce que devient cet art quand il tombe sous le joug de l’ordre public, quand vient le temps de la royauté macédonienne, de l’empire romain, ou bien encore des monarchies de l’âge classique. L’éloquence délibérative est la première à mourir, puisque l’ordre impérial met fin aux délibérations publiques ; lui succède l’éloquence judiciaire, elle-même bientôt réduite à des causes futiles, nul ne se risquant à prendre la défense de ceux que le pouvoir politique condamne : Cicéron, allié de Pompée et adversaire de César, sera le dernier des grands avocats politiques. Ne demeure après lui que l’éloquence d’apparat, que l’on dit épidictique ou panégyrique, démonstration gratuite du virtuose de la parole ou éloge flagorneur du pouvoir en place. L’inventio y prend peu de part, et se limite désormais au répertoire revu par la censure des lieux communs autorisés, tandis que l’elocutio, le style, l’ornementation du discours, devient le domaine de prédilection où l’orateur peut encore exercer son génie. Selon les anciens rhéteurs, la décadence de l’art oratoire se fait donc par l’excès du style et de l’ornement, l’emphase inutile, assez semblable à ce qu’on nommera au XVIe siècle « la manière », ou à ce que nous nommons le « maniérisme ». Ce sont, selon Cicéron, non les rhéteurs Romains ni Grecs qui sont à l’origine de cette corruption du discours, mais les orateurs de l’Asie Mineure et sous l’influence du goût oriental, qui aime un parler « exubérant et plantureux » (Orator, 25). A « l’asianisme », Cicéron oppose alors « l’atticisme », qui incarne un idéal plus occidental, celui d’une parole claire, construite et concise qui ne s’égare pas dans les fioritures, et dont les plaidoiries de Lysias le logographe (440-380) fixent le canon. Le long passé de despotisme qui pèse sur les pays d’Asie a fini par déformer la parole humaine, à la rendre à la fois ampoulée, profuse et obséquieuse. L’asianisme des Modernes montre alors combien le despotisme asiatique s’étend, par l’Empire, jusqu’à la Grèce et à Rome, c’est-à-dire jusqu’aux berceaux de la démocratie et de la république. Quintilien, près de deux siècles après Cicéron, définit l’asianisme par l’abus des métaphores et la répugnance pour le terme propre : « Lorsque l’usage de la langue grecque se répandit peu à peu dans les cités voisines, des habitants qui, sans posséder suffisamment cette langue, voulaient passer pour beaux parleurs, se mirent à employer des périphrases à la place du mot propre, et persévérèrent dans cette habitude » (XII, 10, 16). Et le maître de rhétorique fait l’éloge de la perfection d’une langue attique pure et simple, et le procès de l’asianisme et de sa beauté ampoulée, qui fait songer au luxe tapageur du parvenu : « Dans un discours où l’on admire les mots, c’est que la pensée est insuffisante […] Pour moi, la première qualité, c’est la clarté et la propriété des termes […] Il faut croire que parler attiquement, c’est parler parfaitement » (cité par Todorov, Théories du symbole, 72) (1). Dans le Brutus (325), Cicéron distingue dans le style asianiste le « style épigrammatique », origine du mot d’esprit ou de la « pointe », formule brève qui frappe d’étonnement et déconcerte l’esprit ; et le style pathétique ampoulé qui quémande verbeusement et longuement l’indulgence, faute d’oser revendiquer avec hauteur la liberté contre le tyran (voir Curtius 129). Quant au panégyrique, il se fait lui aussi démesuré, puisqu’il procède à l’apothéose – qui élève un mortel à la dignité des dieux immortels – de l’empereur. Contre cette perversion de son art, l’orateur ne peut que se réfugier – dangereusement – dans la parodie, l’enflure même de l’asianisme induisant cette chute du sublime dans le ridicule. C’est ainsi que Sénèque rédige en 54, peu de temps après la mort de l’empereur Claude, non pas une apothéose, mais une « apoloquinthose », de apolocynthosis, qui désigne la métamorphose en citrouille, de l’empereur défunt : dans ce texte haineux, l’écrivain se venge contre l’empereur qui l’opprime en en faisant non un dieu, mais un légume.
L’asianisme porte, pour les maîtres classiques, non seulement la marque d’une corruption de la langue mais encore, selon un parallèle souvent souligné, d’une corruption des mœurs. Cette emphase amphigourique et pesante est l’expression d’une âme servile, qui cherche à plaire et à flatter par l’étalage de ses fausses richesses. Le rhéteur n’est plus alors qu’un sophiste, et l’orateur un séducteur ou un manipulateur. La rhétorique virile des Anciens, celle dont Tacite est nostalgique, laisse alors la place à une rhétorique que l’on dit volontiers efféminée, qui recourt à toutes les ruses de la séduction, et qui se farde outrageusement pour dissimuler sa réelle médiocrité. Déjà, Platon reprochait au sophiste de maquiller la vérité sous les artifices du langage. Dans le Gorgias, Socrate dénonce la cosmétique, « art malhonnête, trompeur, vulgaire, servile et qui fait illusion en se servant de talons et de postiches, de fards, d’épilations et de vêtements » (465 b), ajoutant que cet art, qui crée par artifice l’apparence d’un corps sain, est l’imitation fallacieuse de la gymnastique, qui entretient la beauté du corps sans recourir aux simulacres du maquillage. La cosmétique, peut alors énoncer Socrate, est à la gymnastique ce que la sophistique est à la législation : ce que l’image en trompe-l’œil est à l’authentique, ce que l’imitation est au modèle. La perversion sophistique du logos métamorphose l’orateur en une créature racoleuse, toute clinquante de bijoux sans valeur, semblable au mime fardé qui se contorsionne sur la scène ou à la prostituée qui aguiche les passants. Privé de la liberté politique qui faisait la grandeur de son art, l’homme de parole n’est plus qu’une coquette qui veut toujours régner, mais qui n’a plus rien à donner. En le castrant de son droit de parole, le tyran fait de l’homme une femme. La poésie elle-même, qui embellit son peu de pensée par la magie de l’incantation, est semblable à une vieille fardée qui donne l’illusion de la jeunesse et de la beauté : « Si l’on dépouille les ouvrages des poètes des couleurs de la poésie et qu’on les récite réduits à eux-mêmes, tu sais, je pense, quelle figure ils font ; tu l’as sans doute remarqué. — Oui, dit-il. — On peut les comparer à ces visages qui, n’ayant d’autre beauté que leur fraîcheur, cessent d’attirer les yeux quand la fleur de la jeunesse les a quittés » (République, X, 601 b). Quelques lignes plus loin, Platon écrit du poète qu’il est « créateur d’idole, o tou eidôlou poiêtês » (601 b). Cette image du fard et de la courtisane accompagne l’art rhétorique en son histoire, comme le risque d’une perversion homosexuelle, une féminité latente qui insinue une ambivalence dans la figure, mâle et conquérante, austère et solennelle, de l’antique orateur, gardien de la constitution (2). L’asianisme apparaît alors comme l’aveu manifeste de cette seconde nature que l’atticisme refoulait. Selon Cicéron, qui reprend ici l’image platonicienne du maquillage, l’orateur, sous peine de passer pour une courtisane, doit éviter autant qu’il est possible la surcharge des ornements et lui préférer le naturel de l’expression : « Comme on dit de certaines femmes qu’elles sont sans apprêt, et à qui cela va bien, ainsi ce style précis [l’atticisme, par opposition à l’asianisme] plaît même sans ornements […] On écartera toute parure voyante, comme seraient les perles ; on évitera même le fer à friser. Quant aux fards du blanc et du rouge artificiels, on les bannira complètement : il ne restera que la distinction et la netteté » (L’Orateur, XXIII, 78-79). Cicéron recommandait encore à l’orateur d’observer, pour l’actio, le jeu de scène des comédiens au théâtre. Pourtant, à trop jouer la comédie, l’orateur ne risque-t-il pas de déchoir au niveau de l’histrion qui s’exhibe pour le plaisir de s’exhiber ? Tacite se défie à son tour de la vulgarité racoleuse qui fait déchoir l’art de l’orateur politique : « Il vaut mieux, pour le style, revêtir une toge même grossière que se faire remarquer par des vêtements voyants et de courtisane. En effet, elle n’est pas digne d’un orateur, à plus forte raison d’un homme, cette parure dont la plupart des avocats de notre temps font un tel usage que, par l’affèterie du langage (lascivia verborum), la futilité des pensées et le rythme trop libre des phrases, ils font penser à la musique de scène des pantomimes […] De là cette exclamation scandaleuse et impertinente, que nos orateurs parlent langoureusement, et que nos mimes dansent éloquemment » (Dialogue des orateurs, XXVI). On retrouvera encore chez Quintilien l’éloge d’une rhétorique virile et classique et la condamnation véhémente de la perversion, ou plutôt de l’inversion qui fait du rhéteur à la voix puissante un travesti qui veut aguicher, mixte troublant de l’homosexualité et de la cupidité : « Il en est qui se laissent séduire à l’apparence, et qui, à des visages épilés, émaillés, dont la chevelure frisée est retenue par des épingles, et dont l’éclat est emprunté, se donnent plus de charme que ne leur en a donné la simple nature, si bien que la beauté des corps semble en accord avec la corruption des mœurs » (II, 5, 12). Et encore : « Qu’on s’avise d’efféminer les corps en les épilant, en les fardant, on les enlaidira singulièrement par ces efforts en vue de les embellir […] Il en est ainsi pour cette élocution transparente et bigarrée de certains orateurs : elle effémine les pensées mêmes que revêtent les mots ainsi choisis » (VIII, 10-20). Et enfin : « Que cette beauté, je le répète, soit mâle, forte et chaste ; qu’elle ne recherche ni une afféterie efféminée, ni un teint fardé ; que ce soit la sang et la force qui la fassent briller » (VIII, 3, 6) (3). L’origine de ce thème se trouve sans doute chez Aristote, qui condamne dans la Poétique la gesticulation exagérée des acteurs de pantomimes : « ...les personnages multiplient leurs mouvements sur la scène, pareils aux mauvais flûtistes qui se contorsionnent [...] La tragédie aurait alors le défaut que les anciens acteurs reprochaient à leurs successeurs : à cause de son jeu exagéré, Mynniscos traitait Callipidès de singe, et la même réputation s’attache à Pindare » (61 b 30 sq). Et plus loin : « Ce n’est pas toute sorte de gesticulation qu’il faut condamner, s’il est vrai qu’il ne faut pas condamner la danse, mais la gesticulation des mauvais acteurs » (62 a 8). Quintilien jugeait de la même façon le jeu trop expressif de ses contemporains : « Je crois pouvoir déclarer plus ouvertement que je ne recommande pas notre moderne musique de théâtre, efféminée et brisée par des modes lascifs, et qui a détruit dans une large mesure tout ce qui restait en nous de mâle et de vigoureux » (Institution oratoire, Liv. I chap. 2 ; Liv. I, 10, 31). L’orateur en effet, en s’adressant au peuple, se donne en spectacle ; une gestuelle accompagne nécessairement son discours. Son art risque alors de verser dans celui de l’acteur, qui est comme son double négatif, et se trouve par là même soupçonné d’exhibition, et même de prostitution. Le corps androgyne ou efféminé du mime (dans l’antiquité, les mimes étaient souvent des castrats) qui se contorsionne sur la scène devient alors le double grotesque et obscène de l’orateur viril qui s’adresse solennellement au peuple ; il en est en quelque sorte le reflet dégénéré, comme le singe l’est de l’homme, comme Callipidès le Singe l’est de Mynniscos (4).
Ainsi domestiqué par un pouvoir tout-puissant, l’art oratoire ne peut plus lancer un appel au peuple, et le rhéteur, réduit à l’état méprisable de la courtisane ou du flatteur, est exilé du lieu qui inspirait et magnifiait à la fois son art : l’assemblée des citoyens. Dès lors, la rhétorique, si elle veut éviter de disparaître, doit changer de nature. Dès sa fondation par Protagoras, l’art rhétorique comprenait deux orientations complémentaires mais pourtant différentes : l’orateur est d’une part le gardien de la constitution et l’arbitre du débat démocratique ; mais il est encore le maître qui prétend enseigner la vertu. Il est à la fois le démocrate et le pédagogue. Il est donc possible de discerner une double finalité de l’art rhétorique : politique, il enflamme la liberté mais risque aussi de la duper ; pédagogique, il civilise les mœurs, polit l’amour-propre et apprend à l’enfant à se plier aux règles de la bienséance sociale. Il risque encore, selon le procès que lui fait le philosophe, étouffer son génie propre, son « démon », en l’asservissant au conformisme de l’opinion commune. L’ironie philosophique est un art de la critique et de l’insolence ; le ton magistral du rhéteur vise au contraire à intégrer l’enfant dans la communauté civile, en faire un animal social capable de générosité et de sacrifice. Cette double vocation de la rhétorique est affirmée dès l’Athènes antique : Isocrate, contemporain de Platon, critiquait les sophistes (parmi lesquels il comptait les philosophes) qui embrouillent les discours par leur prétention dogmatique de parvenir à la vérité. La véritable vocation de la rhétorique, qui est un art et non une science, est d’apporter une discipline morale (apprendre à écouter et à céder la parole) et un fondement pour l’éducation et la vie civique (la pratique du dialogue engendre cette amitié sans laquelle il n’est pas de cité véritable). Selon Isocrate, l’homme « bien élevé » (pepaideumenos) n’est pas le spécialiste ni l’expert d’un art ou d’une science. Bien au contraire, il ne se pique de rien mais garde en toutes choses un jugement droit, une parfaite maîtrise de lui-même, une âme juste et forte. La rhétorique est le véritable apprentissage de cette culture générale, de cette maîtrise du discours et de la pensée qui forment l’homme accompli, ce que le cycle d’études des « humanités » nommera plus tard « l’honnête homme ». Au modèle isocratique, il faudrait alors opposer le modèle démosthénien, comme la pédagogie à la politique. Démosthène, exact contemporain d’Aristote (tous deux sont nés en 384 et sont morts en 322), recourt à l’art oratoire pour se faire l’apologiste de la démocratie menacée par l’expansion macédonienne. Il se suicidera après l’échec de la révolte contre les Macédoniens. La philippique (trois discours contre Philippe de Macédoine prononcés entre 351 et 341) restera le modèle de la harangue politique qui appelle un peuple à se mettre debout et à résister contre l’envahisseur, de l’exhortation à la liberté. L’Anonyme, au premier siècle de notre ère, voit dans le style enflammé et violent de Démosthène l’une des plus hautes formes du style sublime, l’autre forme étant le ton enthousiaste de Socrate-Diotime dans le Banquet, ou de Socrate-Stésichore dans le Phèdre. La rhétorique politique est passionnément attachée à la démocratie et cherche à exalter l’énergie nationale ; la rhétorique pédagogique est beaucoup plus paisible : conservatrice de nature, elle vise à intégrer l’enfant dans le jeu social, et nullement à le contester. Son idéal est un idéal de bienveillance, de sociabilité, de reconnaissance dans l’échange et le dialogue, ce qui implique un certain scepticisme à l’égard des prétentions dogmatiques de la science (la rhétorique politique, à l’inverse, ne doute pas : aussi adopte-t-elle volontiers le ton exalté du prophète ou du fanatique). La rhétorique politique veut défendre la démocratie ; la rhétorique pédagogique, ou policée plutôt que politique, veut fonder une civilisation. La première est militante et citoyenne ; la seconde est riche de son urbanité et de sa civilité, plutôt que de son civisme. La première appelle à l’insurrection ; la seconde enseigne les convenances et les bienséances, le bon usage et l’art de la politesse plutôt que l’art politique. C’est ainsi qu’au patriotisme athénien de Démosthène s’oppose le panhellénisme culturel d’Isocrate, comme la déclaration de guerre s’oppose à l’appel pour la paix.
Les victoires de Philippe, puis d’Alexandre, tarissent pour longtemps la source de la rhétorique politique, qui ne renaîtra qu’avec la révolution française, modèle de l’éloquence politique pendant toute l’histoire contemporaine. En revanche, la vocation pédagogique du rhéteur pourra se développer sans obstacle alors même que le discours séditieux de l’appel au peuple et de la déclaration d’indépendance sera depuis longtemps bâillonné par le pouvoir impérial. Au premier siècle de notre ère, Quintilien précepteur des enfants de l’empereur Domitien, développera, par le portrait qu’il fait de l’orateur idéal dans son Institution oratoire, le modèle que doit poursuivre l’éducation rhétorique. Depuis Isocrate, la rhétorique, bien davantage que la philosophie, est devenue l’âme de la culture hellénistique, la forme supérieure de la « paideia » qui distingue le civilisé du barbare : c’est parce qu’ils communient tous dans une même culture que, plus que par la naissance, ils se reconnaissent mutuellement comme des Grecs. Rhétorique ostentatoire, privée de réelle force politique, qui fascine un public friand de ce genre de performance par l’aisance oratoire, le grand nombre des citations, l’ampleur des connaissances. Rhétorique de professeurs, aux codes très élaborés et aux recettes compliquées, qui va marquer profondément la culture occidentale pour des siècles. Dès l’époque hellénistique, le rhéteur est un notable influent dans la cité, la performance de la conférence épidictique un événement de première importance dans la vie culturelle des communautés politiques, et c’est à ce personnage considéré que l’on confie les missions d’ambassade ou de tractations avec le pouvoir central. Il est peut-être la première figure de ce que notre XIXe siècle nommera « l’intellectuel » (tous deux ne sont-ils pas les spécialistes des généralités ?), bien que l’intellectuel moderne, qui ne prend vraiment conscience de son autorité morale qu’avec l’affaire Dreyfus (c’est là, du moins, une opinion répandue), polémique avec le pouvoir en place, tandis que le rhéteur antique est au contraire un homme de compromis, allié des grands et toujours, à l’instar d’Isocrate, partisan de la paix, donc aussi du maintien de l’ordre. Les notions de moment opportun (kairos) et de convenances (decorum) sont essentielles dans l’art rhétorique, depuis son origine. Un témoignage tardif, celui de Jamblique, attribue aux Pythagoriciens l’invention de la notion de kairos, mais c’est Gorgias qui est réputé l’avoir introduit le premier dans l’art de la rhétorique. Dans l’Eloge de Palamède, Gorgias évoque les « héros qui, à la rigueur de la loi, préféraient la rectitude du discours. Car ils croyaient cette loi la plus divine et la plus universelle qui consiste à dire, à taire, à faire (ou à ne pas faire) ce qu’il faut quand il le faut. » (Pléiade 1029). Pour le sophiste, qui refuse d’attribuer à la vérité la valeur absolue que lui attribue le philosophe, qui se défie du dogmatisme et s’avoue volontiers sceptique sur les questions qui ne sont pas purement humaines (selon le témoignage d’Eusèbe, le traité de Protagoras Sur les dieux commençait ainsi : « Touchant les dieux, je ne suis pas en mesure de savoir ni s’ils existent, ni s’ils n’existent pas, pas plus que ce qu’ils sont quant à leur aspect. Trop de choses nous empêchent de savoir : leur invisibilité et la brièveté de la vie humaine », Pléiade 1000), un discours ne vaut pas par lui-même mais par l’impact qui peut être le sien dans telle ou telle circonstance. Il ne suffit donc pas de bien parler, il faut aussi savoir quand parler. Il n’y a sans doute pas loin de ce sens de l’opportunité à l’opportunisme et même au conformisme que raille Platon. Et ce trait nous permet de mieux mesurer encore combien l’art rhétorique préfère se plier aux circonstances plutôt qu’entrer en conflit avec les autorités en place.
Cependant, cette rhétorique pédagogique qui vise à instituer l’humanité, plutôt que la citoyenneté, en l’homme, forme le socle des humanités qui, pendant des siècles et jusqu’à tout récemment (ce n’est qu’en 1968 que l’enseignement du latin, jusque là présent au collège dès la sixième, a été remisé comme une option bientôt devenue rare, au lycée), seront l’âme de la culture occidentale et l’esprit de sa pédagogie. Cette formation accorde un privilège à l’étude des lettres sur l’étude des sciences, elle reconnaît dans la maîtrise oratoire une discipline de l’esprit qui le rend apte à remplir toute tâche. La culture rhétorique hellénistique pose les fondements de l’humanisme de la Renaissance, qui se trouve lui-même au fondement de la civilisation européenne. Au XVIIe siècle, quand l’on disait d’un jeune homme qu’il « faisait ses humanités » (le latin de la Renaissance disait « studia humanitas »), on signifiait par là qu’il étudiait la langue et la littérature grecques et latines. Malgré le tour pédant qu’affecte volontiers la démonstration épidictique dans l’Antiquité, cette éducation vise à former non des érudits mais des esprits bien faits que nourrit une « culture générale », dont le contenu reste imprécis : il s’agit surtout de savoir ce qu’il faut savoir pour ne pas passer pour un sot auprès des esprits distingués. Eduquer l’enfant, pour les rhéteurs antiques, c’est le civiliser, c’est-à-dire le rendre apte à remplir les fonctions politiques par lesquelles un homme consacre son existence à pacifier la vie sociale et à participer, autant qu’il le peut, à la prospérité de sa patrie.
C’est cet idéal de la civilisation, ou de la sociabilité, qui a peut-être enfanté la dernière forme vivante de la rhétorique dans l’Europe classique, ce qu’on a nommé, de façon il est vrai un peu pesante, la « rhétorique de la conversation ». L’art de parler et de charmer en parlant, de tenir l’échange dans le respect et l’écoute d’autrui, de pratiquer le jeu du dialogue de telle façon que chacun puisse y trouver l’occasion d’épanouir ses talents, connaîtra en France, au XVIIe comme au XVIIIe siècle, un remarquable développement. Il se pratique non à la cour, où les méfiances réciproques des courtisans, ainsi que le poids des pensées qu’on n’ose pas exprimer, entravent le libre jeu du langage, mais dans les salons, sous la haute autorité d’une femme d’esprit qui joue là le rôle de maîtresse de maison. Rhétorique délicieuse et privée, qui a tout oublié de son origine politique mais qui cultive avec un extrême raffinement – si extrême que certains en viennent à trouver ridicules ces « précieuses » – l’art de paraître intelligent et d’improviser avec grâce. Cette rhétorique de la conversation, qui est l’école de l’esprit moderne et se réclame volontiers de l’esprit du cartésianisme (5), hait toute forme de pédantisme et travaille surtout à se rendre invisible, à masquer le travail et l’éducation qui l’ont rendue possible. Le comble de l’art, c’est ici de savoir parler avec « naturel » : « art de parler entre pairs, dans le loisir, où la rhétorique doit rester invisible et devenir improvisation, trouvaille, charme » (6). Le sens rhétorique du kairos devient alors délicatesse et politesse, l’art de ne pas heurter la sensibilité de son interlocuteur, et l’éducation rhétorique devient synonyme de civilité et de sociabilité. Cet art de la conversation s’est d’abord formé dans les cours italiennes de la Renaissance, et Le Courtisan, de Baldassare Castiglione (1528) en fixe l’étiquette : la sprezzatura (une élégante nonchalance, une aimable désinvolture qui ne paraît jamais affectée) en est la suprême vertu. Mais l’éloge courtisan du prince pèse encore sur ces jeux de conversation qui sont la véritable école du goût. Aux magnifiques palais italiens, qui mettent somptueusement en scène le théâtre de la cour, s’opposent les salons parisiens où se réunissent les beaux esprits. Celui de madame de Rambouillet (baptisée par Malherbe Arthénice par anagramme de Catherine) apparaît dans les années 1615-1617, et le cercle des élus qui fréquentent la « Chambre bleue » est plus restreint encore qu’à la cour celui des familiers du roi. Sous l’arbitrage de la féminité ici souveraine, on dissèque les sentiments et l’on en distingue les moindres nuances. De cette carte du Tendre, sont issus tous les traités des passions qui fleurissent dans la seconde moitié du siècle. Et c’est aussi parce que le bon sens est la chose du monde la mieux partagée, et qu’il est plus pur chez la femme, qui a su rester naïve et naturelle, que chez l’homme, qui l’a gâté par pédantisme ou par l’arrogance de ses préjugés, que Descartes choisit de rédiger son Discours en français : « un livre, où j’ai voulu que les femmes mêmes pussent entendre quelque chose, et cependant que les plus subtils trouvassent aussi assez de matière pour occuper leur attention » (lettre au P. Vatier du 22-2-1638, Pléiade p. 991). Et Pascal, en transportant sur la place publique, la querelle que les théologiens de la Sorbonne instruisaient contre l’Augustinus de Jansénius, recourt au même jugement du bon sens contre l’esprit corrompu des doctes : « Vos deux lettres n’ont pas été pour moi seul. Tout le monde les voit, tout le monde les entend, tout le monde les croit. Elles ne sont pas seulement estimées par les théologiens ; elles sont encore agréables aux gens du monde, et intelligibles aux femmes mêmes » (Réponse du Provincial aux deux premières lettres de son ami, Pléiade p. 684).
Cet art de la conversation cultive une éloquence de l’intimité qui s’oppose à l’éloquence publique de l’orateur politique. Toute la rhétorique de l’âge classique naît de cette conversion dans l’intériorité, qu’avait préparée la pratique de la lecture silencieuse qui s’insinue dans le secret des âmes, échange amical entre auteur et lecteur dont Les Essais de Montaigne, bréviaire des « honnestes gens », est alors le modèle (7). A la rhétorique incendiaire du style sublime, qui s’adresse au peuple rassemblé et excite les passions, on préfère une rhétorique de l’intériorité, celle de la chaire qui s’adresse à la communauté recueillie des fidèles et les invite à une austère et grave méditation. Charles Perrault, qui conduit le parti des Modernes, peut ainsi affirmer, contre les Anciens, que dans le domaine même de la rhétorique, où l’on prétend volontiers que le modèle antique est inégalé, les Modernes ont su inventer une rhétorique chrétienne bien supérieure par la profondeur de sa spiritualité à l’emportement oratoire des païens : « Au lieu des séditions qu’il fallait émouvoir ou apaiser du temps des républiques anciennes, nos prédicateurs n’ont-ils pas lieu d’employer les mêmes figures de rhétorique, ou à exciter les pécheurs à secouer le joug de leurs passions tyranniques, ou à clamer les troubles que ces mêmes passions élèvent continuellement dans le fond de leurs âmes ? Jamais les matières n’ont été plus heureuses pour l’éloquence, puisqu’elles ne sont pas de moindre importance que le salut et la vie éternelle » (8). Ou bien encore : « Croyez-vous que ce que font tous les jours nos excellents prédicateurs ne soit pas préférable à ce qu’on nous raconte des anciens ? Ce n’est point une populace inquiète et tumultueuse qui les écoute. C’est une assemblée grave et sage, où il y a un nombre infini d’honnêtes gens dont une grande partie n’ont pas moins de lumière et d’habileté que le prédicateur même » (257) (9). A la spiritualité de l’éloquence d’Eglise correspond alors, dans le domaine profane, l’esprit enjoué de l’éloquence de salon : certes, le ton n’est pas le même, mais l’une et l’autre ont en commun de s’adresser au secret du cœur, de cultiver la correspondance des âmes. Le mondain sait converser sans blesser, il sait jouer de l’échange sans heurter l’amour-propre de son partenaire. Il faut apprendre à manier l’allusion, la pointe, le mot d’esprit, ne jamais peser, effleurer sans être superficiel. On peut comparer cet art à un jeu d’escrime verbal à fleurets mouchetés, toujours maîtrisé mais pourtant soutenu par le souci de sa gloire. Montaigne : « Si je confère avec une âme forte et roide jouteur, il me presse les flancs, me pique à gauche et à dextre ; ses imaginations élancent les miennes. La jalousie, la gloire, la contention me poussent et rehaussent au-dessus de moi-même. Et l’unisson est qualité du tout ennuyeuse en la conférence » (III, 8, « De l’art de conférer »). Ou bien encore au jeu de paume, où il s’agit de savoir renvoyer la balle avec adresse : « Un entretien aimable, écrit Germaine de Staël, alors même qu’il porte sur des riens, et que la grâce seule de l’expression en fait le charme, cause encore beaucoup de plaisir ; on peut l’affirmer sans impertinence, les Français sont presque seuls capables de ce genre d’entretien. C’est un exercice dangereux mais piquant, dans lequel il faut jouer de tous les sujets, comme d’une balle lancée qui doit revenir à temps dans la main des joueurs » (De l’Allemagne, Ière partie, chap. IX, GF, p. 93-94). Selon Pascal, l’art de persuader consiste surtout dans l’adresse avec laquelle on place les arguments, assez semblable à l’adresse du bon joueur de paume qui sait bien placer la balle : « Qu’on ne dise pas que je n’ai rien dit de nouveau, la disposition des matières est nouvelle. Quand on joue à la paume, c’est une même balle dont joue l’un et l’autre, mais l’un la place mieux » (Le Guern n° 590, II, p. 138). Dans ce jeu élégant où chacun « sert » la balle à l’autre plus qu’il ne la renvoie, sans pourtant céder le point, le goût s’exerce, découvre son autonomie et s’émancipe de la tutelle des Académies. Le salon devient l’arbitrage du bon goût comme du bon usage de la langue (l’Académie n’est plus alors qu’une chambre d’enregistrement), et il connaît au XVIIIe siècle un extraordinaire développement sous le haut patronage de madame de Lambert, puis de madame de Tencin, madame Geoffrin, madame du Deffand, Mademoiselle de Lespinasse, madame d’Epinay, etc. Victime de son succès, le « naturel » qu’on y cultive finit par paraître bien artificiel et maniéré (ce qu’on nomme au XVIIIe siècle le « marivaudage »), et le « bon goût » devient le goût d’une élite qui prend soin surtout à se distinguer du peuple. Au XXe siècle le salon des Verdurin n’est plus qu’une coterie animé surtout par la rage de dominer qui dévore le cœur de la « patronne ». Dès la révolution française, le salon cesse d’être l’école où se forment l’intelligence et le goût. L’éloquence révolutionnaire, inspirée des deux Discours de Rousseau (1750 et 1755), réveillera un instant la grande éloquence délibérative des Anciens : au cercle des intimes, elle substituera l’appel au peuple rassemblé, à l’analyse des passions la sauvegarde de la patrie en danger. Au pépiement de la conversation féminine qui analyse sans fin les sentiments dans la volière du salon, elle substituera la voix mâle du conducteur de peuples qui en appelle au Champ de Mars au relèvement de l’énergie nationale. Elle sombrera bien vite dans l’emphase déclamatoire, et cela dès la seconde République et les discours inspirés et mélodieux de Lamartine, jusqu’à l’inauguration des chrysanthèmes par les présidents de la Troisième République et les discours devant les monuments aux morts de l’après-guerre. La voix de l’orateur, pour s’adresser aux millions d’hommes qui envahissent ce théâtre, se munira d’instruments de diffusion sophistiqués et, par la magie de la radio puis de la télévision, s’insinuera dans l’intimité des familles et pénétrera dans les intérieurs. S’adressant désormais à un interlocuteur nécessairement réduit au silence, transplantée du débat démocratique qui est pourtant son lieu de naissance dans le sein de la famille hypnotisée par le petit écran, la rhétorique cesse d’être un art de persuader pour devenir un art de manipuler, et l’éloquence n’est plus qu’une propagande. On s’adresse désormais à l’opinion, puis on la sonde pour mesurer le degré de pénétration du « message ». On consent à la consulter, pour un choix préétabli, tous les quatre ou cinq ans. Mais cela fait longtemps qu’elle ne prend plus la parole. Quant à la véritable rhétorique, on la trouve peut-être dès la seconde moitié du XVIIIe siècle dans les cafés où se réunissaient les Encyclopédistes (le Procope et le Café de la Régence), où se retrouvent les artistes et les hommes de lettres sous le Second Empire, et après (Baudelaire au Café des Variétés, Proust au café Weber, rue Royale, Manet, puis Degas, Renoir et Monet au café Guerbois). L’art de pratiquer l’échange avec grâce n’a plus de lieu privé de nos jours (l’âge de la conversation a laissé la place à celui de la communication), sinon dans des cercles d’amis qui se rassemblent et jouissent dans le coin d’une brasserie du bonheur d’être ensemble. Le bon usage de la rhétorique définissait le style de l’élite, censée incarner « l’esprit » de la langue française. Cette unité se désintègre aujourd’hui tandis que prolifèrent les argots, ou les jargons qui sont autant de codes pour des micro-sociétés, ou de corporations qui cultivent le secret. Le mot « argot » est reconnu dès le XVIIe siècle (Olivier Chérau, Le Jargon, ou langage de l’argot réformé, 1628), mais ne devient courant qu’au XIXe siècle : la quatrième partie de Splendeurs et misères des courtisanes, que Balzac rédige en 1847, recourt constamment à l’argot des prisons. Ainsi la disparition de la rhétorique est significativement contemporaine de l’intérêt porté aux langues secrètes, ou parcellaires : en renonçant à sa défense comme à son illustration, la langue, privée de l’unité stylistique que lui conférait le bon usage, se dissout dans la cacophonie des parlers idiomatiques. Paradoxalement, l’idéal contemporain de la « communication » passe par la multiplication des dialectes : verlan, langue des affaires, de la communication elle-même, de la publicité, sans évoquer la multiplication des langages techniques dans lesquels Heidegger reconnaît l’un des multiples symptômes de la domination planétaire d’une pensée oublieuse du sens de l’Etre.
L’Europe est sans doute un marché ; elle éprouve encore quelques difficultés à devenir une civilisation et, du point de vue de la langue, progresse plutôt vers le malentendu de Babel que vers une fédération des esprits. Ce n’est pas un paradoxe que de rappeler que l’Europe médiévale était linguistiquement plus unifiée que l’Europe moderne : le latin, langue de l’Eglise romaine, était parlé dans toutes les universités, et il n’était pas impossible, au XIIIe siècle, de commencer ses études à Oxford, de les poursuivre à Varsovie et de les achever à Paris. Sans doute est-il nécessaire, pour parler la même langue, de partager une croyance commune. Il ne semble pas que ce soit le cas de nos contemporains. Aujourd’hui la recherche d’une langue pure et de qualité a déserté les lieux où se pratique l’échange social : c’est dans le bureau solitaire de l’écrivain, dans le travail silencieux de l’écriture, que l’art du style se pratique de nos jours.
La rhétorique, discréditée dès le début du XIXe siècle, va progressivement disparaître de l’enseignement, mais c’est seulement en 1902 que la classe traditionnellement dite de « Rhétorique » devient la classe de « Première ». Toutefois, pendant tout le XIXe siècle, l’exercice par excellence n’est pas la dissertation littéraire, mais la composition française : il s’agit de composer un discours dans l’esprit d’un exercice de style ou d’un essai rhétorique dont le thème est un pur prétexte pour donner à l’élève l’occasion de montrer sa virtuosité. Il ne s’agit pas alors de traiter un problème d’histoire littéraire (dissertation), mais de rédiger avec élégance et grâce un développement qui prenne modèle sur les grands auteurs classiques (narration). Aussi les textes littéraires sont-ils proposés davantage comme des modèles qu’il faut imiter que comme les documents d’une histoire de la littérature qui, pour être bien comprise, appelle une explication scientifique, ce qu’on nomme aujourd’hui un « commentaire raisonné ». La rhétorique – dont les principes se sont maintenus avec une étonnante constance à travers le temps – est indifférente à la vérité de l’histoire. Elle ne considère dans le passé qu’un répertoire de grands modèles, dont la valeur est éternelle, morceaux de style plutôt que témoins de leur temps : l’homme cultivé sait s’inspirer avec brio de ces chefs-d’œuvre, et c’est faire preuve d’assez de connaissance que se contenter de vagues ou spirituelles allusions, sans jamais tomber dans le pédantisme de l’érudition. L’indifférence rhétorique à la situation historique de la production littéraire est manifeste dans le type même des sujets proposés aux élèves : bien souvent, on imagine le dialogue aux enfers entre deux grands écrivains ayant vécu à des époques radicalement différentes. C’est ainsi qu’un certain Maurice Joly imagine sous le Second Empire, dans un pamphlet politique qui attira l’attention de Baudelaire, un Dialogue aux enfers entre Machiavel et Montesquieu, c’est-à-dire entre un partisan de la tyrannie et un défenseur de la république (c’est du moins ce que croit l’auteur). Dans A l’ombre des jeunes filles en fleurs (1918), dans un passage sur lequel Antoine Compagnon a attiré l’attention, nous apprenons que Gisèle, une amie de la « petite bande », a dû choisir entre deux sujets de composition littéraire pour son certificat d’études : « L’un était : "Sophocle écrit des Enfers à Racine pour le consoler de l’insuccès d’Athalie" ; l’autre : "Vous supposerez qu’après la première représentation d’Esther, Mme de Sévigné écrit à Mme de La Fayette pour lui dire combien elle a regretté son absence" » (I, 911). Le premier correspond au modèle anhistorique « dialogue aux Enfers de X avec Y », l’Enfer n’étant ici qu’un lieu de discussion idéal, hors du temps comme de l’espace, où ne valent que des idées elles-mêmes éternelles, développées en outre pour leur forme plutôt que pour leur contenu. Mais les deux sujets, et surtout le second qui fait référence au génie du genre, la marquise de Sévigné, sont des exercices épistolaires : Sophocle écrit à Racine, Mme de Sévigné écrit à Mme de La Fayette. Proust tire certains effets comiques de l’attention exclusive portée au style et d’un jeu mondain dont la littérature fait bien superficiellement les frais. C’est ainsi que Gisèle (qui a choisi Sophocle et Racine) commence sa lettre par : « Mon cher ami, excusez-moi de vous écrire sans avoir l’honneur d’être personnellement connu de vous, mais votre nouvelle tragédie d’Athalie ne montre-t-elle pas que vous avez parfaitement étudié mes modestes ouvrages ? » (I, 912) ; et elle s’achève ainsi : « J’ai tenu à vous envoyer toutes mes congratulations auxquelles je joins, mon cher confrère, l’expression de mes sentiments les plus distingués » (ibid.). Andrée, l’intellectuelle de la petite bande, critique la copie de Gisèle (qui a pourtant, apprend-on, obtenu la note de quatorze et a été félicitée par le jury) sur le même plan rhétorique qui demeure le fondement indiscutée de ce traitement de la littérature : « Ecrivant à un homme du XVIIe siècle, dit Andrée, Sophocle ne devait pas écrire : mon cher ami […] Gisèle aurait dû mettre "Monsieur". De même, pour finir, elle aurait dû trouver quelque chose comme : "Souffrez, Monsieur (tout au plus, cher Monsieur), que je vous dise ici les sentiments d’estime avec lesquels j’ai l’honneur d’être votre serviteur » (I, 913). Remarquons toutefois que si la rhétorique de Gisèle est conforme aux conventions épistolaires de son temps, en revanche celle d’Andrée est plus soucieuse de retrouver le ton et le style d’une époque révolue. Toutefois, l’une et l’autre sont d’accord dans le traitement du sujet, la rhétorique consistant en l’éducation des bonnes manières, bienséances et convenances.
Comme Antoine Compagnon l’a bien montré, c’est la Troisième République qui mettra définitivement fin à ce type d’enseignement. La rhétorique apparaît alors pour ce qu’elle est devenue en effet, un enseignement « de classe » comme l’on disait il n’y a pas si longtemps encore, l’apprentissage d’une langue bien faite qui vaut surtout comme un code de reconnaissance sociale, et nullement comme l’expression d’une pensée authentique. Pour reprendre les catégories héritées de la tradition, l’inventio compte peu, la dispositio est une pure question d’élégance, l’occasion de persuader avec esprit. L’essentiel est donc dans l’elocutio, les ornements du style et le maniement des figures. A l’inverse, la République veut développer un enseignement ouvert à toutes les classes sociales, qui entraîne une véritable modernisation de la société française, élevant la France rurale à la culture républicaine. Dès lors, la Rhétorique, qui occupait la première place, cède la place à l’Histoire, l’Histoire républicaine de la formation de l’identité nationale par les luttes successives qui ont fédéré les provinces dans l’Etat jacobin. Tel est le thème de l’Histoire alors régnante, celle d’Ernest Lavisse, dans une France nationaliste obsédée par la revanche, attendant avec impatience le sursaut qui fera revenir dans le sein de la mère Patrie les deux enfants perdus que sont l’Alsace et la Lorraine. La Rhétorique, trop amoureuse du beau langage, est suspecte de collaboration avec l’Ancien Régime. Le latin, dont l’étude dominait les anciennes « humanités », est alors délaissé au profit du grec, qui est la langue de la première démocratie du monde, et ce sont des hellénistes (père et fils : Alfred et Maurice Croiset), non des latinistes, qui critiquent le plus vigoureusement l’enseignement de la Rhétorique et militent pour sa disparition. C’est alors aussi que l’exercice rhétorique de la composition française cède la place à l’art plus rigoureux de la dissertation littéraire : il ne s’agit plus de disposer des arguments qui valent surtout pour leur disposition et leur élégance, mais de faire une analyse de textes dont le modèle est scientifique. Ce modèle, Gustave Lanson (1857-1934) le définira, réalisant dans le domaine de la littérature l’équivalent de l’affirmation de l’identité nationale et républicaine qui faisait l’esprit de l’Histoire selon Lavisse. D’inspiration positiviste, l’histoire littéraire selon Lanson fait peu de cas des élégances du beau style, se méfie de l’impressionnisme littéraire, met l’accent sur la précision et l’érudition, donne une grande importance à la recherche des sources. Son Histoire de la littérature française (1894) restera pendant plus d’un demi siècle le modèle indiscuté de l’enseignement secondaire et universitaire. Le plan du discours rhétorique est une mise en scène des arguments persuasifs, la construction équilibrée d’un discours séduisant : exorde, corps du discours (narration, argumentation, réfutation) et enfin péroraison. Cette division en parties n’est pas organique, elle ne vise qu’à rendre plus clair l’objet du débat, elle ne prétend pas démontrer mais exposer une opinion de la façon la plus persuasive. La dissertation littéraire, quant à elle, ne se compose pas de parties, mais de moments (terme emprunté à Hegel, qui l’avait lui-même emprunté à la théorie physique du levier) qui sont rigoureusement articulés entre eux, et ont pour fonction de démontrer une thèse d’histoire littéraire. Le fait qu’il ne s’agit plus de disposer les arguments pour faciliter l’écoute, mais de construire un développement qui a valeur de thèse, se reconnaît à ceci que les parties du discours rhétorique sont nommées, selon une répartition raisonnée de l’argumentation, tandis que les moments de la dissertation ne sont que numérotés : première, seconde, troisième (on s’arrête là, selon le schéma du mouvement dialectique) parties. C’est une seule et même pensée qui se développe alors, de l’introduction à la conclusion. L’ensemble de la dissertation forme ainsi un système autonome qui n’obéit qu’à sa rationalité interne ; bien au contraire, le discours rhétorique ne vaut qu’en tant qu’il s’adresse à un auditeur imaginaire. C’est ainsi que « péroraison » et « exorde » supposent que l’orateur se tourne vers la galerie, pour la captatio benevolentiæ en premier lieu, pour l’inciter en second lieu à demeurer dans les mêmes sentiments que ceux que la harangue a fait naître en lui. « Introduction « et « conclusion » ne valent en revanche que par rapport à l’ensemble du développement, et ne supposent pas davantage un interlocuteur imaginaire qu’une démonstration de géométrie. « On voit comme nous sommes loin ici des topoi transportables et interchangeables à merci de l’ancienne rhétorique […] Dans une "bonne" dissertation, rien n’est amovible, rien n’est substituable, rien n’est isolable » (Genette, « Rhétorique et enseignement », in Figures II, p. 39). Quant au style de la dissertation, il doit surtout être clair, précis et approprié, évitant les clichés et les lourdeurs, mais en aucun cas chargé d’ornements rhétoriques, jargonnant ni se perdant dans le dédale des tropes, métaphores ou anacoluthes. Comme le remarque encore Genette, le style de la bonne dissertation, c’est le degré zéro du style : « L’idéal du style dissertatif est vraiment le degré zéro de l’écriture ; la seule valeur proprement esthétique que l’on puisse encore y rencontrer, c’est le brillant, c’est-à-dire l’art de la "formule" » (ibid. p. 40). On observera à ce propos que la « formule » est une expression empruntée à la mathématique : il ne s’agit pas, comme c’est le cas pour la « pointe », de faire preuve d’esprit avec concision, mais de ramasser un long développement dans une sentence frappante qui en résume l’acquis. Et l’on remarquera encore, toujours avec Genette, que c’est exactement au moment où la théorie littéraire se démocratise et se rationalise, que les écrivains cultivent volontiers un ésotérisme symbolique et revendiquent aristocratiquement le privilège du style : « Au moment même où la situation rhétorique s’occultait dans notre enseignement, on la voyait réapparaître, sous une nouvelle forme, dans la littérature elle-même, en tant que celle-ci, avec Mallarmé, Proust, Valéry, Blanchot, s’efforçait de prendre en charge la réflexion sur elle-même, retrouvant par une voie inattendue la coïncidence des fonctions critique et poétique : en un sens, notre littérature actuelle [janvier 1966], en ce qu’elle a de plus profond, et malgré son anti-rhétorisme de principe (son terrorisme, dirait Paulhan), est tout entière une rhétorique, puisqu’elle est à la fois littérature et discours sur la littérature » (ibid. p. 41).
On se demandera enfin si la disparition de la rhétorique des programmes d’enseignement est une disparition, ou plutôt une dissimulation. La rhétorique n’est-elle pas toujours présente, alors même qu’on prétend l’avoir bannie ? Il n’y a en effet pas davantage de langage sans style qu’il n’existe de discours épuré de toute figure rhétorique. Bien souvent, l’expression dite « propre » est encore une expression figurée (« réfléchir », « concevoir », ou bien encore « penser » qui vient de pendere, peser). Qui plus est, la dissimulation même de l’art rhétorique est encore une figure de rhétorique. C’est un fait que la persuasion rhétorique est d’autant plus efficace qu’elle s’étudie à ne pas paraître pour ce qu’elle est, un artifice savant plutôt qu’une naïve expression. C’est ainsi que, selon l’image évocatrice du Pseudo-Longin, la maîtrise des procédés rhétoriques dans le style sublime est semblable à l’utilisation des ombres dans le clair-obscur du peintre, l’ombre ayant pour fonction, non de paraître pour elle-même, mais au contraire de disparaître pour mieux mettre en valeur la lumière et la couleur (XVII, 3) : « Il en presque comme de ces lumières indécises qui disparaissent baignées par le soleil : les artifices de la rhétorique rentrent dans l’ombre quand la grandeur les environne de tous côtés. Il y a peut-être dans la peinture quelque analogie : dans un tableau l’ombre et la lumière sont distribuées parallèlement sur le même plan ; et cependant, ce qui se présente d’abord à la vue c’est la lumière, et non seulement elle acquiert du relief, mais elle se montre beaucoup plus près de nous. De même, dans le discours, le pathétique et le sublime, plus rapprochés de nous, grâce à une affinité naturelle et à leur éclat, se présentent toujours à nous avant les figures dont ils relèguent l’art dans une ombre qui semble le tenir caché. » La grande rhétorique est donc celle qui dissimule le procédé laborieux par le souffle et l’enthousiasme qui animent le verbe. Elle n’en est pas moins présente, et l’Anonyme en dénombre soigneusement les figures. Mais il se peut aussi que le mépris affiché de tout artifice rhétorique soit la forme extrême de l’artifice rhétorique lui-même. Le Socrate de Platon, au début de son Apologie, dit son mépris pour les procédés psychagogiques des sophistes : « En les écoutant, j’ai presque oublié qui je suis, tant leurs discours étaient persuasifs. Et cependant, je puis l’assurer, ils n’ont pas dit un seul mot de vrai […] Moi, au contraire, je ne vous dirai que l’exacte vérité. Seulement, par Zeus, Athéniens, ce ne sont pas des discours parés de locutions et de termes savamment choisis que vous allez entendre, mais des discours sans art, faits avec les premiers mots venus » (17 a et c). En vérité le discours de Socrate, même s’il choque les préjugés des juges et cherche davantage la provocation que la conciliation, n’est pas dénué de séduction pour un esprit philosophe. Sa grandeur sublime masque la rhétorique de l’antirhétorique qui le sous-tend, comme la lumière fait oublier les ombres. Il faut donc croire que se moquer de la rhétorique, c’est encore faire de la rhétorique. Il se peut, comme le prétend Pascal, que la véritable rhétorique se moque des règles, n’écoute que la voix du cœur et n’exprime que la sincérité du sentiment : « La vraie éloquence se moque de l’éloquence, la vraie morale se moque de la morale ; c’est-à-dire que la morale du jugement se moque de la morale de l’esprit qui est sans règles. Car le jugement est celui à qui appartient l’esprit de finesse, comme les sciences appartiennent à l’esprit. La finesse est la part du jugement, la géométrie celle de l’esprit » (Le Guern n° 467). L’esprit de géométrie démontre, mais l’esprit de finesse, qui seul connaît l’art de persuader, touche les cœurs par un jugement d’intuition qui en perçoit les délicats équilibres. La rhétorique, cet art de la séduction qui suppose la science de l’intimité et des secrets de l’âme, n’est pas, selon Pascal, une science à laquelle peut s’élever un esprit seulement humain : seul Dieu, par le miracle de la conversion, peut sonder l’abîme du cœur humain et, par l’acte incompréhensible de la grâce, l’incliner à la foi. Les rhéteurs qui font les doctes, et prétendent connaître les règles de la persuasion, se flattent et n’enseigne qu’une vaine science. Pourtant, ce naturel, qui fait la justesse de l’esprit de finesse, s’éduque et se travaille, et il n’est guère de style plus subtil et plus fulgurant que celui de Pascal lui-même. La rhétorique qui se moque de la rhétorique est donc encore rhétorique elle-même, bien qu’elle ne soit pas en mesure de formuler clairement les règles de son art. Pascal l’avoue et le répète en plusieurs occasions.
Au cours des siècles où il s’est affiné et transmis, l’art rhétorique s’est montré capable de penser sa propre dissimulation. Non pour renoncer à l’analyse rhétorique, mais pour en méditer au contraire la subtilité et la richesse. A l’inverse, la disparition, à l’époque contemporaine, de l’enseignement de la rhétorique ne s’est guère accompagnée, sinon dans le domaine littéraire de l’étude stylistique, d’une réflexion sur la rhétorique de cette dissimulation même. Pourtant l’art de persuader, qui recourt il est vrai à l’image plus qu’au discours, n’a jamais été plus tyrannique ni omniprésent : il n’est plus aujourd’hui beaucoup de lieux où, dans la ville moderne, le décor publicitaire ne cherche à séduire le consommateur. Il est sans doute regrettable que nous n’enseignions ni ne connaissions les règles de cette stratégie commerciale : sans doute serions-nous moins victimes des apparences si, comme les anciens, nous savions manier, dès l’école, les divers artifices de la « communication », qui, de ce fait, n’est le plus souvent de nos jours qu’une simple manipulation.
NOTES
1- L’asianisme est un contre modèle pour la rhétorique « classique », mais il n’est pas certain qu’il soit une réalité historique. Les critiques se concentrent surtout sur Hégésias de Magnésie (milieu du IIIe siècle ), dont on ne sait pas grand chose, sinon qu’il avait écrit une Histoire d’Alexandre le Grand. On ne saurait citer beaucoup d’autres noms pour étoffer cette prétendue « école asianiste ». « En réalité, on n’est pas très certain qu’il y ait eu un style asianique, pas plus qu’il n’y avait d’"école" asianique. C’est un ensemble de critiques, peut-être disparates et peut-être contradictoires, qui ont eu plus tard pour lieu commun l’idée que l’on se faisait des défauts des asiatiques, c’est-à-dire d’auteurs qui, aux yeux des puristes, étaient des étrangers, des Grecs d’emprunt, pour qui la langue des Hellènes n’était pas naturelle » (Jean Sirinelli, Les Enfants d’Alexandre, Fayard, 1993, p. 107). Il se pourrait bien que l’asianisme soit une invention tardive imaginée par Cicéron et Quintilien.
2- « On rapporte que Démosthène était, dans ses vêtements et dans tout son extérieur, d’une propreté et d’une élégance qui annonçaient beaucoup trop de recherche. De là ces railleries de ses rivaux et de ses adversaires sur son manteau élégant et sur sa molle tunique. De là encore ces reproches honteux, flétrissants, de n’être homme qu’à moitié, et de souiller sa bouche d’infâmes turpitudes. Hortensius, le plus illustre des orateurs de son temps, si nous en exceptons Cicéron, essuya les mêmes railleries, les mêmes imputations. Une mise toujours soignée, des habits arrangés avec art, des gestes fréquents, une action étudiée et théâtrale, le firent souvent traiter d’histrion, en plein barreau. L. Torquatus, homme grossier et sans égards, parlant contre lui dans la cause de Sylla devant le plus auguste et le plus sévère des tribunaux, fit plus que l’appeler histrion ; il le traita de danseuse, lui donnant le nom de Dionysia, célèbre danseuse de cette époque » Aulu-Gelle, Nuits attiques, I, 5.
3- Cette image d’une rhétorique pervertie par le désir affiché de séduire parcourt toute l’histoire de cet art. On la retrouvera chez Pascal : « On ne sait pas en quoi consiste l'agrément qui est l'objet de la poésie. On ne sait ce que c'est que ce modèle naturel qu'il faut imiter ; et à faute de cette connaissance, on a inventé de certains termes bizarres, siècle d'or, merveille de nos jours, fatal laurier, bel astre, etc. et on appelle ce jargon, beauté poétique. Mais qui s'imaginera une femme vêtue sur ce modèle, verra une jolie demoiselle toute couverte de miroirs et de chaînes de laiton ; et au lieu de la trouver agréable, il ne pourra s'empêcher d'en rire ; parce qu'on sait mieux en quoi consiste l'agrément d'une femme que l'agrément des vers. Mais ceux qui ne s'y connaissent pas l'admireraient peut-être en cet équipage ; et il y a bien des villages où l'on la prendrait pour la Reine : et c'est pourquoi il y en a qui appellent des sonnets faits sur ce modèle, des Reines de village » Déjà Montaigne : « Un rhétoricien du temps passé disait que son métier était, des choses petites les faire paraître et trouver grandes […] Ceux qui masquent et fardent les femmes font moins de mal : car c’est chose de peu de perte de ne les voir pas en leur naturel : là où ceux-ci font état de tromper non pas nos yeux, mais notre jugement, et d’abâtardir et corrompre l’essence des choses » (I, 51, éd. Jean Céard p. 495).
4- Les premiers chrétiens ont stigmatisé avec violence cette féminisation de l’acteur par le seul fait de son exhibition sur une scène publique, et cet argument revient souvent dans leur condamnation des spectacles païens : « L’auteur du Traité contre les spectacles, que nous avons dans les œuvres de saint Cyprien, définit le pantomime un monstre qui n’est ni homme ni femme, dont toutes les manières sont plus lascives que celles d’aucune courtisane, et dont l’art consiste à prononcer avec son geste. Cependant, ajoute-t-il, toute la ville se met en mouvement pour lui voir représenter en gesticulant les infamies de l’antiquité fabuleuse. Il fallait que les Romains se fussent mis en tête que l’opération que l’on ferait à leurs pantomimes pour les rendre eunuques leur conserverait dans tout le corps une souplesse que des hommes ne peuvent avoir. Cette idée ou, si l’on veut, le caprice faisait exercer sur les enfants qu’on destinait à ce métier la même cruauté qu’on exerce encore dans quelques pays, sur les enfants dont on ne veut point que la voix mue. Saint Cyprien, dans la lettre qu’il écrivit à Donat pour lui rendre compte des motifs de sa conversion à la religion chrétienne, dit que ces spectacles qui font une partie du culte des païens sont pleins d’infamie et de barbarie. Après avoir cité les horreurs de l’amphithéâtre, il ajoute, en parlant des pantomimes, qu’on dégrade les mâles de leur sexe pour les rendre plus propres à faire un métier si déshonnête, et que le maître qui a su faire ressembler davantage un homme à une femme est celui qui passe pour avoir fait le meilleur disciple. Les mâles sont privés de leur virilité, la honte d’un corps efféminé amollit toute la gloire et l’énergie de leur sexe et plus on a brisé un homme pour en faire une femme plus on plaît là-bas » Du Bos, Réflexions critiques sur la poésie et la peinture, ENSBA, 1993, p. 444-445.
5-« Le cartésianisme, le jansénisme, et même l’épicurisme de Gassendi, dès la Fronde, soumettent au tribunal de la conversation mondaine des ouvrages philosophiques, scientifiques, théologiques, en français. Le privilège de la conversation savante, qui se réserva longtemps la décision sur les livres d’érudition et de science, commence dès lors à s’ébrécher, et les mondains, qui ne se piquent de rien, se mettent à vouloir trancher de tout. Descartes, dans Le Discours de la méthode (1637) les y invitait, et comme ils détiennent le secret oral de la bonne langue, leur avis, formulé avec esprit, fait autorité sur tout » (Fumaroli, « La conversation », dans Trois institutions littéraires, « Folio », 1994, p. 145).
6- Marc Fumaroli, ibid., p. 126.
7- « Le modèle français et moderne de la conversation, ce sont les Essais de Montaigne : vaste improvisation dictée ou écrite, les Essais préservent le primesaut, le ton amical, les méandres imprévus d’un entretien familier et socratique non seulement avec le lecteur, qui est déjà pour Montaigne "mon semblable, mon frère", mais aussi avec cette société excellente des Anciens, philosophes, poètes, héros, qui grâce à Montaigne cessent d’être des livres et deviennent des interlocuteurs d’une causerie générale et passionnante » (Fumaroli, ibid., p. 133).
8- Charles Perrault, Parallèle des Anciens et des Modernes, tome second, 1690, p. 254-255, fac-similé de l’éd. R. Jauss, Munich, 1964 ; cité par J. Starobinski, « La chaire, la tribune, le barreau », p. 2029.
9- Charles Perrault, Parallèle des Anciens et des Modernes, tome second, 1690, p. 257, fac-similé de l’éd. R. Jauss, Munich, 1964.
|
|