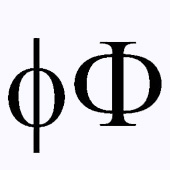|
PETIT ECHANGE AVEC CHATGPT
APHORISMES
ETRE ET EXISTER
ENSEIGNER LA PHILOSOPHIE
ESTHETIQUE DE L'ABSTRACTION
PRINCIPES DE PHILOSOPHIE ESTHETIQUE
I- Orientation
II- Théorie de la connaissance esthétique
III- Théorie de la rencontre
IV- Théorie de la signification
V- Théorie des échanges et Conclusion
LA PEINTURE HOLLANDAISE AU SIECLE D'OR
LES FANTOMES DE L'OPERA
ON DEVRAIT DIRE...
QU'EST-CE QUE LE NEOREALISME ?
LA STAR, LA VIVANTE ET LE SANS POURQUOI
ESTHETIQUE DU PARADIS TERRESTRE (1)
LE REALISME SELON CEZANNE
NOTE SUR WITTGENSTEIN
ENTRETIEN
CEZANNE ET LA FORCE DES CHOSES
MANTEGNA : ANCIENS ET MODERNES
LE TABLEAU ET LE MIROIR
LE JARDIN A LA FRANCAISE
REMBRANDT, BETHSABEE
PHILOSOPHIE ET RHETORIQUE
LES RELIGIONS DU LIVRE
DU CARACTERE A LA CARICATURE
QUELLE VANITE QUE LA PEINTURE...
LES GROTESQUES
LE ROSSIGNOL ET LA DIVA
LA STATUE AMOUREUSE
L'INTERPRETATION DE L'OEUVRE D'ART
DE L'IDEE DU BEAU A L'ESTHETIQUE
CARAVAGE ET L'OPERA
|
PRINCIPES DE PHILOSOPHIE ESTHETIQUE
I- ORIENTATION
Tout porte à croire que l’analyse esthétique en est aujourd’hui au stade où se trouvaient, pendant la Renaissance, les sciences de la vie. On ne dit pas, au seizième siècle, « sciences naturelles », mais « histoires naturelles ». Il faut comprendre que le vivant n’est pas encore un objet pour fonder une science, mais plutôt un prétexte pour raconter des histoires. Sur les quelques trois cents pages qu’Aldovrandi consacre au cheval dans sa colossale encyclopédie zoologique (1599-1616), on trouvera pêle-mêle des références mythologiques et des thèmes astrologiques, une tératologie fantastique, une symbolique, une glyptique, une héraldique, un inventaire des adages et des épitaphes consacrés au cheval, ses effigies peintes, sculptées, des remèdes, des prodiges, des allégories, des énigmes…(1) La liste est illimitée, et le reste fatalement tant qu’elle n’a pas su construire son objet. Ainsi le tableau. Pour le commenter et l’analyser, on se croit autorisé à parler de tout ce qui, de près ou de loin, le concerne en quelque manière : les tractations financières de la commande, le destin de l’œuvre, son histoire et la succession de ses propriétaires, la géométrie supposée de sa construction – son « nombre d’or » secret – les croyances, sectes et confessions auxquelles il se réfère explicitement, le contexte biographique, économique, les associations symboliques dans lesquelles il s’insère, les allusions religieuses, politiques, etc. Ces anecdotes ne sont pas dépourvues d’intérêt : nous les lisons avec la même curiosité que nous lisons Aldovrandi. Il se peut, après tout, que certaines d’entre elles fournissent des signes de piste pour de précieuses découvertes bien que, Bachelard l’a clairement montré, ces références sans fin font plutôt obstacle au progrès de l’esprit scientifique. Ce n’est pas la pauvreté ni l’indigence qui menacent l’analyse esthétique, mais la prolifération et l’encombrement. Ce n’est pas le manque, mais la multitude des méthodes et des écoles qui nous empêche d’entendre. Historiens et micro-historiens, économistes, sociologues, psychanalystes, iconographes et déchiffreurs de symboles, tous ont leur mot à dire et chacun affirme que le sien est le bon. Je souhaite désencombrer le tableau des discours qui le recouvrent, l’étouffent peut-être. Je voudrais donner la parole à la peinture.
Il ne s’agit pas de repousser étourdiment les trésors que diverses éruditions ont accumulés autour de l’œuvre. Certains commentateurs se découvrent, devant le tableau, de prodigieux détectives, de merveilleux fouineurs à qui rien n’échappe. Mais leur enquête sera fatalement incertaine, elle s’égarera dans son propre labyrinthe si elle ne travaille pas d’abord, et avant toute autre recherche, à construire son objet. Le construire : non pas le définir – c'est-à-dire clore la question – mais en formuler l’énigme – c'est-à-dire ouvrir la voie d’une recherche. Pour Aldovrandi, la vie ne faisait pas problème : elle était donnée. Il suffisait en conséquence de collecter à son propos toutes les histoires imaginables. C’est ainsi que trop souvent le discours sur l’art accepte l’œuvre comme un fait originaire, une donnée préétablie, et non comme une question qu’il faut entendre, un projet qu’il faut construire. Nous ne savons plus comprendre à quel point l’image est quelque chose d’incompréhensible. Nous avons pris l’habitude du tableau. Nous ne savons plus le penser, s’il est vrai que penser c’est perdre l’habitude. Nous en disposons comme un propriétaire de son bien, en « conservateur ». L’art de la peinture nous appartient, croyons-nous. Il fait partie de notre héritage culturel, il est un élément de notre patrimoine. Il nous est donné. Mais il n’est pas encore construit.
La construction de son objet est la question préalable qui se pose à la réflexion esthétique. Est dogmatique tout discours qui ne travaille pas à interroger l’essence de l’objet qu’il prétend analyser, tout discours qui ne s’interroge pas sur la nature et les possibilités de ses propres fondements. Jusqu’à présent, le discours sur l’art demeure dogmatique. Il constate que des œuvres sont données, et reprend à son compte les découpages que nous a légués la tradition – selon les nationalités, les époques et les styles. Il les enregistre comme autant de documents ou d’archives dont l’authenticité est assez bien établie quand on a su leur faire correspondre un nom, et une date. Il ne les traitre pas comme un texte – dont la structure, les articulations, le mode de production font problème – mais les exploite comme prétextes pour parler d’autre chose, pour développer des allusions, pour étoffer des références. Alors l’œuvre n’est plus que le moyen destiné à servir une fin qui lui est extérieure. L’esthétique dogmatique se condamne elle-même à manquer son objet, faute de s’être jamais donné la peine de le chercher. Au lieu de laisser le tableau se manifester selon le mouvement de sa présentation, elle le recouvre d’anecdotes. Il faut soumettre le dogmatisme qui conserve aux exigences de la critique. Critique : une esthétique ne peut prétendre à ce titre que si elle n’admet pour objet propre que celui qu’elle construit elle-même, que si elle ne reconnaît d’autres données que celles qu’elle se donne à elle-même. Le dogmatique se fait gloire de sa neutralité : il stocke l’information, il constate le fait, il enregistre le programme. Mais la critique prétend à l’objectivité : elle est activité théorique, travail de l’entendement qui élabore ses concepts, définit ses opérations et limite son domaine de légitimité. La critique sait que l’objet du débat – l’œuvre d’art pour l’esthéticien, ou la nature pour le physicien, la vie pour le biologiste – n’est pas un fait originaire mais le résultat d’un acte d’objectivation. Rien de plus subjectif que la prétendue neutralité du procès-verbal. Pour couper court à toute discussion, on voudrait s’en tenir – et exiger des autres qu’ils s’en tiennent – à la pure et simple description des œuvres (2). Cette rigueur, le plus souvent revendiquée avec agressivité, est en vérité d’une extravagante prétention. Vouloir nommer les choses telles qu’elles sont, c’est sans doute faire preuve d’une bonne intention, mais c’est aussi s’engager dans un entreprise toujours vouée à l’inachèvement. Décrire l’œuvre d’art, c’est tenter l’impossible : on l’a montré, et il est aisé de le faire, il n’y a pas de description naïve ni de compte-rendu innocent (3). On aura beau invoquer l’autorité des plus fines technologies – microscope et microsonde, spectrogramme et rayons X – on ne sera pas plus avancé pour autant. Cet appareillage est impressionnant ; mais il est bien incapable de répondre à la question que le tableau nous pose. L’œuvre d’art n’est pas un fait indiscutable, ni une évidence à laquelle il faut se rendre. Rien n’est plus problématique au contraire que sa seule existence, et le mouvement de sa mise au monde. Toute l’énigme du tableau interroge la modalité de son être, c'est-à-dire sa façon de se présenter, de faire acte de présence, de faire son apparition. Le tableau n’est pas un fait qu’il suffit de sanctionner, mais un droit dont il faut rédiger les articles. Il n’est pas la donnée d’un problème qu’on doit résoudre ; il est en lui-même un problème et attend sa formulation.
Construire le tableau – le produire – c’est restituer le mouvement de son apparition. Une esthétique critique est aussi une esthétique productive. Il n’y a qu’une voie qui puisse nous conduire à l’intelligence du tableau : il faut le produire et l’engendrer par un travail de regard, retrouver les stades de son développement, refaire, pour notre propre compte, le chemin que le peintre a dû emprunter pour parvenir à l’image. Le jugement esthétique – jugement réfléchissant – n’est pas simple réception ni contemplation. Il demande une participation active il exige du spectateur qu’il soit aussi acteur. Pour le dogmatisme esthétique, l’œuvre est donnée à notre délectation, elle est un décor qu’on nous propose, une beauté qu’on nous invite à admirer. Pour l’analyse critique, l’œuvre est la cristallisation d’un travail esthétique, elle est le résultat d’un processus. L’esthétique productive reprend à son compte le reproche que Nietzsche adressait à Schopenhauer : le regard qu’il tourne vers l’œuvre d’art est toujours celui d’un spectateur, jamais celui d’un artiste (4). Celui qui demeure assis dans la salle ne voit de l’œuvre que son apparence extérieure ; mais celui qui s’avance sur la scène, celui qui pénètre l’espace virtuel des images rencontre aussi leur réalité. L’art n’est pas théâtre qui distancie, mais fête qui rassemble. Le tableau implique le regard. C’est pourquoi la neutralité est un mensonge : elle feint de n’être pas concernée, elle garde ses distances et joue le jeu du désengagement. Elle veut se faire passer pour désintéressée. L’objectivité critique s’inter-esse au contraire à l’œuvre, elle se situe d’emblée dans la perspective que l’œuvre organise et structure. Elle établit un contact. Seule la pure contemplation qui demeure en recul et se tient en repos sait être désintéressée. L’artiste témoigne au contraire d’un prodigieux intérêt pour ce monde. La chair sensible de la présence et le sourire de la terre le captivent. Il cultive l’amour fou des apparences.
***
De même qu’il faut un torpillage pour provoquer la progression maïeutique, de même il faut une rencontre pour engendrer l’activité esthétique. Sans le bonheur de la trouvaille, sans la divine surprise de la rencontre, l’œuvre n’est qu’un rêve pour l’imagination qui sommeille et l’artiste un velléitaire incapable d’effectuer les puissances qui sont en lui, et de passer à l’acte. L’art est un enfant des jeux de l’amour et du hasard, il est le fruit que sait seule recueillir une sensibilité réceptive, qui se prépare à recevoir le trésor des sensations, qui se garde disponible pour la conception des apparences. Dans l’instant miraculeux de la découverte, le regard de celui qui produit l’œuvre coïncide avec le regard de celui qui la contemple. Au point-origine de la rencontre, la visée de l’artiste intersecte celle du spectateur, l’une et l’autre réunie dans l’unité d’un seul et même émerveillement. C’est pourquoi la rencontre est l’événement fondateur et le point d’appui de l’esthétique productive et critique. Elle témoigne qu’il est possible de surmonter l’apparente antinomie qui oppose l’engagement de la production esthétique au recul de l’admiration spectatrice. Elle fait communier l’artiste et l’amateur dans la joie de l’enfantement et la naissance de l’œuvre.
L’artiste ne conçoit pas son œuvre de propos délibéré, il la reçoit d’une suggestion rencontrée. C’est ainsi qu’Alberti, dans le De Statua, imagine que l’art de la sculpture fut suggérée par les formes évocatrices découvertes par hasard dans le contour d’une souche ou le relief d’une motte de terre (5). C’est ainsi que Léonard, dans les Carnets, enseigne, avec une insistance qu’on a souvent remarquée, l’art d’apercevoir des paysages – des collines et des vallées, des fleuves et des rochers – dans les taches d’humidité qui rongent les murs de l’atelier, comme on peut deviner dans le battement des cloches la rumeur d’une parole naissante (6). C’est ainsi encore que, selon le témoignage de Vasari, Piero di Cosimo – un original plutôt fantasque selon le chroniqueur florentin – « s’arrêtait parfois pour contempler un mur où s’étalaient des crachats de malades, et il s’en inspirait pour les batailles de cavaliers, les villes les plus fantastiques, les pays les lus immenses. C’était la même chose quand il regardait les nuages dans le ciel » (7). Sans la fécondation de la rencontre, l’œuvre ne viendrait jamais à naître. Ce thème est un invariant esthétique : on le retrouve – traité il est vrai de façon plus radicale et sauvage – chez les peintres modernes (8). Dans l’instant de l’accident merveilleux, artiste et spectateur se trouvent dans la même situation. Le second a sur le premier l’avantage de savoir où diriger son regard : il sait que l’œuvre qu’on lui propose, faite de main d’homme, est un taillis où le sens est embusqué, il est prévenu et se tient en attente, à l’affût de la saillie de l’image. L’artiste, plus confiant, se livre au hasard absolu de l’existence, à l’offrande de chaque seconde, aux présents du présent. L’amplitude de sa disponibilité diverge sur l’expérience totale tandis que la curiosité du spectateur est focalisée et orientée sur l’œuvre élaborée. Mais l’un comme l’autre est convié à la même fête du regard, tous deux sont également invités à participer à l’invention de l’apparence. Chez l’un ou l’autre, l’attention diffère en degré et non pas en nature. Il faut savoir regarder les tableaux de Léonard comme Léonard savait regarder les taches sur les murs ou les formes mouvantes dans les nuages. Le regard que le souci accapare manque la suggestion de la rencontre : il arrive à l’artiste de passer à côté d’une œuvre suggérée, de ne pas en honorer la promesse, comme il arrive à l’amateur de recevoir la grâce d’un chef-d’œuvre sans savoir le reconnaître. La rencontre esthétique naît de notre disponibilité à l’incidence, de notre ouverture sur l’extériorité. Les taches sur les murs sont en tous points opposés aux épreuves d’un test de Rorschach. Elles ne sont pas un centre de projection pour l’expression d’une subjectivité indiscrète et toujours envahissante, mais un foyer d’étonnement pour un sujet oublieux de lui-même, attentif au seul surgissement du monde, à l’écoute de l’inouï. C’est un regard pathologique et prisonnier de lui-même qui n’aperçoit sur la tache que le reflet de son phantasme. Mais c’est un regard artiste, délivré de lui-même et libre de toute contrainte qui, d’une rencontre au hasard, fait une œuvre concertée.
La réception d’un signe détermine l’événement de la rencontre, et nous appelons signe l’acte qui provoque chez le récepteur le désir d’émettre un signe en retour, qui le met en demeure de répondre. L’œuvre fait signe comme fait signe à l’artiste l’heureuse occurrence de la rencontre. Seul un travail poïétique – qui produit l’œuvre et ne se contente pas d’en enregistrer l’apparence extérieure – est en mesure d’organiser la réception de notre sensibilité. Toute rencontre est le fruit du hasard, et le hasard qualifie la perception qui se maintient dans l’ouverture de l’improbable. Dans l’instant de la rencontre, le regard se trouve brutalement assigné au rendez-vous de l’apparence, et l’attention du sujet est assaillie par le surgissement de l’objet. Dans un texte souvent cité, Erwin Panofsky met en parallèle la rencontre esthétique et le salut d’un collègue qui nous accoste sur le trottoir : « Supposons qu’une personne de ma connaissance, rencontrée dans la rue, me salue en soulevant son chapeau », commence-t-il (9). Mais la grandeur de l’œuvre consiste précisément en ce qu’elle ne fait pas partie de nos « connaissances », en ce qu’elle subvertit avec insolence les codes et les convenances qui apprivoisent la sauvage manifestation du phénomène et, par la convention d’un contrat, mettent formellement en société le sujet et le monde. Le salut du voisin rencontré dans la rue et la violence du regard qui soudain questionne depuis le tableau ne sont pas des événements du même ordre. Que le voisin me salue, c’est dans l’ordre des choses. Il serait impoli, il manquerait aux convenances s’il manquait de le faire. Sa révérence est prévisible, et il serait maladroit de lui accorder trop d’importance. Ce n’est pas au salut du voisin qu’il convient de prêter attention, mais au contraire à la froideur calculée, à l’affectation de celui qui fait mine de ne pas nous voir. C’est inversement par la violence de son surgissement, par le seul avènement de sa présence que l’œuvre nous lance le défi du sens et nous assujettit au déchiffrement de l’énigme. Comme on dit de la vérité qu’elle éclate, ainsi la rencontre esthétique est un attentat contre l’habitude, l’explosion de l’inouï dans le flux monotone de l’ordinaire. L’art ne fait pas bon ménage avec les convenances. Pour Panofsky, le tableau est une espèce de collègue aimable et cultivé qui ne manque jamais d’échanger, avec l’érudit, quelques saluts complices, quelques propos convenables ou convenus. L’un et l’autre se retrouvent par cette connivence qui réunit les gens du même monde. Mais pour le regard artiste – disponible pour recevoir le hasard de la rencontre – l’œuvre se dresse au seuil d’un autre monde.
La construction de l’objet esthétique n’obéit pas aux mêmes règles que celles qui commandent la construction de l’objet scientifique. L’expérimentation scientifique est un discours réalisé, une théorie matérialisée. L’élaboration d’un langage cohérent précède ici la mise au point d’un dispositif expérimental. La science arraisonne la nature, elle soumet le phénomène aux lois de la raison, elle réussit la mainmise de l’esprit sur le monde. L’expérience esthétique veille au contraire à rester disponible aux suggestions de la rencontre, elle s’oriente pour recevoir l’offrande de l’apparence, pour accueillir comme il convient le mouvement de la manifestation. Pour les sciences de la nature, l’expérimentation est destinée à vérifier les prédictions d’une langue bien faite. Pour l’artiste, l’apparence est une évidence qui mérite notre confiance, et qu’il serait ingrat de soupçonner de mensonge. L’objet – le modèle – qui suggère le travail de l’œuvre ne s’ajuste pas aux préventions d’un langage constitué mais tient au contraire tout langage en échec, et vient au monde par les lacunes du discours. La rencontre est d’autant plus fertile qu’il n’est pas de mot pour la dire. Si le physicien se défie des apparences et, par la mise au point d’une expérience cruciale, les travaille pour qu’elles passent aux aveux, l’artiste en reçoit le don gratuit sans arrière pensée ni calcul. Ce qui est obstacle pour le premier est hommage et faveur pour le second. Le peintre ne doute pas du visible : il s’en remet à son autorité souveraine. L’intuition scientifique est toujours pure et a priori : la spontanéité de l’entendement produit les concepts qui déterminent l’expérience. L’intuition esthétique est toujours empirique : elle réfléchit les sollicitations de la rencontre, elle reçoit le don du hasard, elle témoigne pour la pure contingence de l’événement, pour la gratuité du miracle. La connaissance scientifique énonce l’ordre des raisons et met la nature en demeure de se soumettre à ses lois. La connaissance esthétique a vocation de s’effacer pour qu’advienne la rencontre, pour que le phénomène se manifeste.
La retraite provisoire du concept et le découvrement réciproque de la disponibilité sensible ne se laissent pas réduire à la pure et simple passivité de la contemplation. L’œil du peintre ne se borne pas à enregistrer le visible tel que l’évidence le propose. Il explore les possibilités de l’expérience, il en multiplie les virtualités et en accroît l’extension. L’art établit le générique des apparences, il participe, par l’amitié d’une coïncidence, à l’élaboration des phénomènes. C’est pourquoi il ne construit pas son objet « par concept » – ainsi que l’exige l’activité dominatrice du jugement déterminant – mais donne à voir le mouvement de sa manifestation et sa venue dans la présence – ainsi que le veut l’écoute attentive du jugement réfléchissant, qui s’origine toujours dans le particulier. L’art imite, non la nature, mais l’avènement de la nature. La sensibilité reçoit le don du phénomène, mais l’imagination participe activement à l’organisation de cette réception, elle restitue le processus de l’élaboration de l’image, elle recommence les épisodes de la mise en image. Fécondé par le choc de la rencontre, le peintre construit l’œuvre que le hasard suggère, il compose un tableau. Il rend visible, non le visible lui-même, mais l’acte de la vision qui donne le jour à l’image. L’objet esthétique n’est ni donné ni construit, il se construit lui-même, il s’inscrit intégralement dans l’histoire de sa présentation. Le construire, c’est reconstruire le rythme de son apparition, c’est reconnaître pas à pas le chemin qui conduit du germe – l’instantané de la surprise – à son effectuation finale – l’œuvre accomplie. Les progrès récents de la muséologie enseignent combien la présentation fait valoir le tableau, combien, quand il s’agit de l’objet d’art, sa mise en valeur est aussi une mise en scène. Il faut au Rijksmuseum une salle entière pour ménager à La Ronde de nuit un accueil convenable ; le Prado donne à voir, non seulement Les Ménines, mais l’image réfléchie des Ménines dans un miroir mobile de mêmes dimensions que la toile, obéissant en cela à l’ancien conseil d’Alberti, repris par Léonard et Michel-Ange – pour bien voir le tableau, il faut le voir dans un miroir (10) – et obéissant plus encore aux suggestions du tableau de Vélasquez lui-même. Les peintres eux-mêmes reconnaissent, bien avant les musées, les vertus de la présentation. Dans une lettre à Chantelou, Poussin précise l’encadrement qu’il juge convenable : « Le tableau doit être orné d’or mat qui s’unit doucement aux couleurs sans les offenser […] Il doit être placé fort peu au-dessus de l’œil et plutôt en-dessous » (11). On sait que Rembrandt demandait à l’amateur de se tenir à quelque distance du tableau, qu’il voulait placé en pleine lumière (12). Caravage avait conçu sa célèbre Corbeille de fruits pour être située en hauteur, dans la continuité d’une étagère, et augmenter ainsi l’effet du trompe-l’œil (13). Enfin Les Ambassadeurs d’Holbein était sans doute destiné à orner une vaste salle du château de Polisy, propriété de Jean de Dinteville, une porte d’entrée correspondant à la perspective frontale, une porte de sortie à la visée latérale et oblique de l’anamorphose (14). C’est ainsi que la perspective dans le tableau n’ordonne pas seulement l’espace virtuel du tableau lui-même mais détermine également sa disposition dans l’espace réel, et assigne au regard un point de visée et un seul. Abstraire le tableau de la situation qu’il implique, c’est le vider de sa substance, c’est négliger l’effet de son apparition et manquer la rencontre qui pourtant le constitue. Ainsi la construction esthétique n’est pas, sur le modèle de l’activité de l’esprit scientifique, une construction par concept, mais la reconstruction imageante d’une rencontre imposée, l’accompagnement méthodique, restitué par le travail de l’œuvre, de la présentation du phénomène.
La philosophie esthétique pense la production de l’œuvre et le travail qui l’engendre. La critique d’art en règlemente la consommation. Elle est l’enfant du journalisme : la « critique » fleurit d’abord sur les gazettes quand les Salons, qui ouvraient au public les portes des collections royales ou princières, firent naître l’exigence d’une éducation esthétique, c'est-à-dire d’une formation du goût et d’un guide des valeurs. C’est par abus de langage que le critique se baptise tel. La critique d’art n’est en effet jamais véritablement critique puisqu’elle n’interroge ses propres fondements ni ne questionne ses conditions de possibilité. Nécessairement sujette aux caprices de la mode et aux engouements d’un temps, elle initie le profane, conduit sa visite en distribuant des prix, en établissant une échelle des valeurs. Le seul statut du journalisme, qui commente au jour le jour l’art qui se fait et qui sait plaire, lui impose ses limites. Le lecteur d’un magazine d’art partage au moins avec les rédacteurs la conviction qu’il y a des œuvres, anciennes ou modernes, dont la seule existence suffit à justifier la publication régulière d’un magazine d’art. Il n’attend pas de sa lecture mensuelle qu’elle formule le problème du statut ni de la légitimité de l’activité esthétique, mais plus simplement qu’elle fournisse des informations, qu’elle oriente ses choix, qu’elle attire son attention sur l’œuvre qu’on suppose digne d’être vue. C’est pourquoi la critique d’art reste un exercice dogmatique, puisqu’elle s’arroge à tout moment le droit de prononcer des jugements de valeur. Inversement, une esthétique qui sait être critique ne juge jamais. Elle ne distribue ni le blâme ni l’éloge et ne croit pas pouvoir disposer des œuvres comme autant d’objets dociles qui se résignent à l’arbitraire de nos estimations. En vérité, c’est moins nous qui jugeons l’œuvre que l’œuvre qui nous juge par la seule autorité de son apparition, c’est elle qui nous dicte le rôle que nous devons tenir dans le drame de son avènement. Le jugement esthétique doit se garder de toute appréciation intempestive, il doit suivre pas à pas le cheminement que l’artiste méthodiquement compose. Il n’appartient à la sensibilité qui la reçoit de juger de la qualité de la rencontre, mais seulement d’en reconnaître le point d’impact et de se rendre disponible aux effectuations qu’elle suggère. Libre à chacun ensuite d’en goûter les raisons ou d’en dénigrer les effets. Seules importent la reconstitution de la provenance et l’exactitude de la présentation. Si la philosophie est la pensée des fondements, alors l’esthétique ne peut se dire aussi philosophe qu’à la condition de questionner la possibilité même de son objet, de découvrir l’origine – toujours empirique et contingente – à partir de laquelle l’œuvre d’art se constitue. Le prince mécène – qui est à la fois le modèle inavoué et le maître du critique d’art – se croit libre d’arranger à sa guise les collections qu’il s’approprie. Mais la réflexion esthétique épouse le rythme que l’œuvre lui impose, elle se soumet à ses raisons et reconnaît son autorité.
Ce n’est plus là affaire de goût, mais de connaissance. Dans l’éblouissement de la rencontre, la vérité fait signe, se manifeste et prend corps et chair. Le regard du peintre est possédé par la lumière, enivré par le dévoilement de l’évidence. L’art ne se soucie guère de distribuer des prix aux pièces des collectionneurs, mais d’ouvrir plutôt une nouvelle voie d’accès qui s’avance à la rencontre du vrai. Pour le critique d’art, l’art est toujours un art d’agrément qui cultive nos gourmandises. Pour l’artiste, il est un gai savoir, l’extase matérielle d’une connaissance sensible, la fulgurance d’un signe. On reconnaît ordinairement aux sciences « exactes » le privilège du savoir. Mais il est encore un autre savoir, une connaissance esthétique qui irradie le corps sensible dans l’univers de la présence. Seule l’ivresse d’une vérité manifestée peut donner lieu à l’œuvre d’art. L’artiste, depuis des siècles, en expérimente l’éventualité. Mais le penseur, jusqu’à présent, n’accorde pas grand crédit à cette sagesse. La connaissance esthétique ne jouit pas d’une grande faveur auprès des doctes. Sa théorie reste à faire.
NOTES
1- Ulysse Aldovrandi, De quadrupedibus solipedibus volumen integrum, Bologne, 1616. A propos de ce naturaliste italien et de sa méthode de description, on lira Emile Guyénot, Les sciences de la vie au XVII et XVIIIe siècles, Paris, Albin-Michel, 1957, p. 52-55. Egalement Michel Foucault, Les mots et les choses, Paris, Gallimard, 1966, p. 54-55, et François Jacob, La logique du vivant, Paris, Gallimard, 1970, p. 30.
2- Un bon exemple de cette attitude se trouve dans le livre de Madeleine Hours, Les secrets des chefs-d’œuvre, 1982, dont le sous-titre à lui seul est une proclamation : « L’œuvre d’art est matière avant d’être message ».
3- Erwin Panofsky, « Contribution au problème de la description d’œuvres… etc. », dans La perspective comme forme symbolique, 1975, p. 235-255.
4- Nietzsche, Généalogie de la morale, « Troisième dissertation », § 6.
5-« Je crois que les arts qui cherchent à imiter les créations de la nature ont débuté ainsi : un jour, on découvrit par hasard, dans un tronc d’arbre, dans un monticule de terre ou dans quelque autre objet, des contours qu’il suffisait de modifier très légèrement pour obtenir une ressemblance parfaite avec certaines choses de la nature ». Dans le texte original : Artes eorum, qui ex corporibus a natura procreatis effigies et simulacra suum in opus promere aggrediunturn ortas hinc fuisse arbitror. Nam ex trunco glebave et huiusmodi mutis corporibus fortassis aliquando intuebantur lineamenta nonnulla, quibus paululum immutatis persimile quidpiam veris naturae vultibus redderetur (Leon Batista Alberti, On Painting and on Sculpture, ed. Cecil Grayson, Londres, Phaidon, 1972, p. 120). On trouvera un passionnant commentaire de ce célèbre passage dans Alessandro Parronchi, Studi sulla dolce prospettiva, Milan, Aldo Martello, 1964 : « Sul Della Statua Albertiano », p. 399 sq. Sur ce thème, voir également E. H. Gombrich, L’Art et l’illusion, 1971, p. 141-142 et note p. 498 ; ainsi que H.W. Janson, Sixteen Studies, 1970 : « The image made by chance in Renaissance thought », p. 53-74.
6- Léonard de Vinci, La peinture, 1964, p. 196-197. Cependant Botticelli, selon Léonard, disait « qu’il suffisait de jeter une éponge imbibée de diverses couleurs sur un mur pour qu’elle y laisse une tache où l’on pouvait voir un beau paysage » (ibid. p. 79). Sur ce thème, outre les références indiquées dans la note précédente, on pourra lire Hubert Damisch, Théorie du /nuage/, 1972, « Le nuage, la peinture », p. 51 sq.
7- Giorgio Vasari, Les vies des meilleurs peintres, sculpteurs et architectes, publié sous la direction d’André Chastel, Actes Sud, « Thesaurus », 2055, « Vie de Piero di Cosimo », vol. I, livre 5, p. 85. Voici le texte orignal : Fermavasi talvolta a considerare un muro, dove lungamente fosse stato sputato da personne malate, et ne cavava le battglie de’ cavagli e la più fantastiche città e più gran paesi che si vedesse mai ; simil faceva de’ nuvoli de l’aria.
8- Par exemple Max Ernst, « Au-delà de la peinture », Cahiers d’Art, 1936, p. 5 et 6. Le passage plus haut cité des Carnets de Léonard est en effet du goût des surréalistes. André Breton, dans Le point du jour (« Le message automatique », décembre 1933) prononce l’éloge du « beau mur interprète, craquant de lézards » (1970, Gallimard, « Idées », p. 167).
9- E. Panofsky, Essais d’iconologie, 1967 [1939], p. 13. Quelques années plus tôt, dans son article « Contribution au problème de la description d’œuvres… », Panofsky avait déjà développé la même image (voir La perspective comme forme symbolique, 1975, p. 251).
10- L. B. Alberti, Trattato della pittura, livre II (On painting, 1966, p. 83) ; De pictura, 1975, p. 82. Léonard de Vinci, La Peinture, 1964, p. 73. Quant à Michel-Ange, Vittoria Colonna, qui a reçu de sa main le dessin d’une crucifixion, en fait l’éloge car, dit-elle, quand on la regarde dans un miroir, elle ne porte aucune faute (voir L. de Vinci, La peinture, 1964, note 3 de la p. 72, note rédigée par André Chastel).
11- Lettre à Chantelou du 28 avril 1639, dans Nicolas Poussin, Lettres et Propos sur l’art, 1964, p. 35-36.
12- Rembrandt se montrait en effet très soucieux de la présentation de ses œuvres. Offrant l’une de ses toiles à Constantin Huygens (sans doute le Samson aveuglé par les Philistins du musée de Francfort), il précise, dans la lettre qu’il lui adresse le 27 janvier 1639 : « Monseigneur, accrochez ce tableau dans une forte lumière et de telle sorte qu’on puisse se tenir à distance : il se montrera alors sous son meilleur jour » (cité par Paolo Lecaldano, Tout l’œuvre peint de Rembrandt, 1971, p. 89).
13- On lira à ce propos Michel Butor, « La Corbeille de l’Ambrosienne », dans Répertoire III (1968), p. 43-58.
14- Jurgis Baltrusaitis, Anamorphoses…, 1969, chapitre 7, « Les Ambassadeurs d’Holbein », p. 91-116.
Pour lire la suite (II- Théorie de la connaissance esthétique), cliquer ICI
|
|