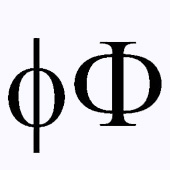|
PETIT ECHANGE AVEC CHATGPT
APHORISMES
ETRE ET EXISTER
ENSEIGNER LA PHILOSOPHIE
ESTHETIQUE DE L'ABSTRACTION
PRINCIPES DE PHILOSOPHIE ESTHETIQUE
I- Orientation
II- Théorie de la connaissance esthétique
III- Théorie de la rencontre
IV- Théorie de la signification
V- Théorie des échanges et Conclusion
LA PEINTURE HOLLANDAISE AU SIECLE D'OR
LES FANTOMES DE L'OPERA
ON DEVRAIT DIRE...
QU'EST-CE QUE LE NEOREALISME ?
LA STAR, LA VIVANTE ET LE SANS POURQUOI
ESTHETIQUE DU PARADIS TERRESTRE (1)
LE REALISME SELON CEZANNE
NOTE SUR WITTGENSTEIN
ENTRETIEN
CEZANNE ET LA FORCE DES CHOSES
MANTEGNA : ANCIENS ET MODERNES
LE TABLEAU ET LE MIROIR
LE JARDIN A LA FRANCAISE
REMBRANDT, BETHSABEE
PHILOSOPHIE ET RHETORIQUE
LES RELIGIONS DU LIVRE
DU CARACTERE A LA CARICATURE
QUELLE VANITE QUE LA PEINTURE...
LES GROTESQUES
LE ROSSIGNOL ET LA DIVA
LA STATUE AMOUREUSE
L'INTERPRETATION DE L'OEUVRE D'ART
DE L'IDEE DU BEAU A L'ESTHETIQUE
CARAVAGE ET L'OPERA
|
PRINCIPES DE PHILOSOPHIE ESTHETIQUE
V- THEORIE DES ECHANGES
La rencontre est émouvante. Elle entraîne l’esprit, et la main, sur la pente d’une déclinaison où s’épèlent et se dénombrent les correspondances, les accords, les unions fertiles qui peu à peu, pas à pas, dessinent une terre habitable pour la parole humaine. La brèche ouverte par Giotto dans le mur de l’antique édifice déploie le paysage encore inexploré de la peinture, elle donne à voir un domaine d’arpentage dont les peintres successivement sont appelés à prendre possession, à tracer les chemins, à établir le réseau des communications possibles. L’acte fondateur met l’histoire en perspective. Une marche commence, euphorique, qui résiste victorieusement à l’entropie de la chute et, de trouvaille en trouvaille, perpétue l’élan de l’origine. La percée sémantique fait le vide sans doute, non toutefois le vide indifférencié, le néant où s’abîme le vertige de l’ennui, mais l’énigme qui fait signe par la promesse du sens et suggère au désir un avenir où chasser. Un futur proche incline le présent. Le cœur battant du temps se fait entendre. Alors des voix se répondent et se mêlent, à la façon d’un chant polyphonique qui tresse les lignes mélodiques et les fait converger dans l’unisson du chœur. L’événement fondateur est la clé d’une voûte qui maintient la cohésion de l’ensemble, il rassemble une communauté amicale selon le partage des interprétations qui se reconnaissent pour vraies. Ainsi circule le signe tandis que l’invention prolifère, ainsi va et vient la navette sur la trame tandis qu’apparaît le motif de la tapisserie. Ainsi se noue le lien social.
« Avant d’examiner l’acte par lequel un peuple élit un roi, prévient Rousseau, il serait bon d’examiner l’acte par lequel un peuple élit un peuple » (1). Avant de disserter sur les clivages et les tensions qui déchirent nos sociétés, il serait bon de penser l’événement par lequel une société est une société. Le pacte social est l’expansion de l’impact originaire de la rencontre, et la communauté ne résiste à son morcèlement qu’à la condition de demeurer fidèle à l’acte de sa naissance, à la violence première qui, dans l’instant d’une rupture féconde, a tracé l’horizon d’une parole commune. Rousseau le fait comprendre : toute communauté est commémorative et ne se perpétue que pour célébrer le jour anniversaire qui l’a vue naître au monde. « Nation » définit littéralement l’acte de la naissance. Au commencement était la fête, la contraction des intérêts particuliers dans le soulèvement de la volonté générale, la rencontre de chacun avec tous dans l’unité d’une histoire qu’il faut réaliser, d’une culture qu’il faut accomplir. Seul cet unique sursaut qui rétablit la concorde peut sauver l’humanité d’elle-même, redresser la pente qui l’incline à dégénérer et mettre un terme à la contagion mortelle de la haine et de l’envie. Par coïncidences inoubliables, par rencontres aléatoires, le sauvage se trouve insensiblement, mais irréversiblement, arraché à l’indolence et à l’inertie de l’état de nature. Les chocs passionnels s’accumulent et s’agrègent autour des points de cristallisation – « cristal des fontaines » dans les pays du sud où la chaleur du climat répond à la chaleur des passions, feu de la veillée dans les pays du nord, quand l’anneau de la communauté amicale se scelle autour de la flamme chaleureuse (2). « La puissance surprenante des causes très légères », « le progrès presque insensible des commencements » éloignent lentement l’individu de la nullité de l’origine, et inquiète insidieusement l’inconsciente béatitude qui berce la rêverie dans le sein de la nature (3). Elle insinue dans la calme contemplation le venin de la réflexion. L’homme de la nature sympathise avec le paysage, il sourit aux constellations, pleure avec la pluie, se réjouit avec la neige et s’exalte quand le ciel tonne. Mais l’homme devient civil, son humanité précipite quand, par rencontres admirables, par fixations désirantes, il hallucine son image sur la figure étonnée de son semblable. C’est d’abord un « géant », un dieu méconnaissable, objet de l’amour et de l’effroi, qui fait jaillir de la poitrine « le cri de la nature », le premier ébranlement sonore qui contient en germe la mélodie de la phrase (4). Ainsi sur la page blanche vient s’inscrire l’empreinte du caractère, le trait vertigineux qui se lance à l’assaut du paragraphe, la parole donnée que le paraphe vient conclure. Les âmes sensibles sont impressionnables, infiniment. Les hommes se reconnaissent les uns les autres, ils connaissent leur identité, par incidences et réflexions, dans l’incidence des premières caresses. Ils quittent la barque-berceau qui emporte le rêveur solitaire au fil de l’eau, par flux et reflux, par rythme apaisé, sur le lac où le bonheur est à nouveau possible, le lac de Bienne qui circonscrit l’île dont le nom est Saint Pierre, qui est le portier du Royaume (5). Ils passent par-dessus bord en devenant sociables et, à l’image encore de leur saint patron, marchent sur les eaux et s’éloignent du lac, s’avancent dans le fleuve, emportés par le courant de leur histoire. Des liens se nouent, des attachements s’opèrent et l’homme s’humanise en abandonnant sa mère Nature. L’amour de soi, où sommeillait encore la redoutable puissance de la perfectibilité, laisse la place à l’amour propre, que l’imagination attise, qu’avive chaque fois davantage le face à face avec le rival d’un moment (6). L’enfant de la nature s’abandonnait au doux sentiment d’exister. Inconscient, innocent, il se laissait porter par le mouvement de la vague. Mais l’animal civilisé apprend à se connaître lui-même, il se déprave en se réfléchissant, il se fait homme, et homme seulement, en déclinant son identité – qui inégalise en divisant – en se déclinant au duel. Parce qu’ils se mesurent l’un à l’autre, les hommes conçoivent l’orgueilleux dessein de s’instituer eux-mêmes pour mesure de toutes choses. Toute raison est comparaison, et le jeu de la connaissance stimule les progrès de l’intelligence. Par écarts différentiels, par applications réitérées, l’idole adorable de la première rencontre prend le visage du prochain. Plus se réduit la distance, plus se resserrent les liens qui les attachent, et plus s’agacent les susceptibilités, plus s’irrite et s’enflamme le désir jaloux de la possession et de la maîtrise. « Celui qui voulut que l’homme fût sociable toucha du doigt l’axe du globe et l’inclina sur l’axe de l’univers. A ce léger mouvement, je vois changer la face de la terre et décider la vocation du genre humain » (7). Il a suffi que le doigt d’une fée maligne perturbe, à peine – l’inclinaison est infiniment légère – mais à jamais – l’équilibre est instable et ne retrouvera plus son assiette – l’ordre du monde pour que des turbulences sans nombre jettent les hommes les uns contre les autres et, par cascades et catastrophes, engendrent l’universel chaos. C’est une belle chose que l’innocence, mais elle se perd sans qu’on n’y prenne garde. Voici venu le temps des assassins, de la discorde et de la haine.
Comment, de la guerre, la paix peut-elle alors renaître ? La théorie du « contract » établit le seuil critique, le point de l’effervescence maximale qui voit surgir l’ordre du chaos, qui assigne sa limite au progrès de l’inégalité et rassemble en un faisceau unique la dispersion aléatoire des volontés hostiles et des intérêts contraires : « Je suppose les hommes parvenus à ce point où les obstacles qui nuisent à leur conservation dans l’état de nature l’emportent, par leur résistance, sur les forces que chaque individu peut employer pour se maintenir dans cet état. Alors cet état primitif ne peut plus subsister ; et le genre humain périrait s’il ne changeait sa manière d’être » (8). Pour que soit conjuré le péril du Déluge, pour que soit surmontée la menace de l’Apocalypse, pour que soit rétablie la symétrie brisée par la rencontre renversante, il faut bien supposer une double origine, une rupture positive qui fonde la communauté humaine et réponde, dans l’état civil, à la rupture négative qui, dans l’état de nature, avait arraché le sauvage à son sommeil bienheureux. La première coupure est coupure d’inégalité et de dégénérescence. La seconde au contraire est un point d’inflexion qui renverse la pente de l’entropie, transforme la rivalité en solidarité, l’aliénation en liberté et l’inégalité en égalité. Ce choc, qui est l’image inversée du traumatisme qui précipita l’homme dans l’état civil, est infiniment peu probable mais non pas impossible. L’histoire n’est pas un destin, la dépravation n’est pas fatale, et si chaque empreinte est ineffaçable, s’il est impossible de rétrograder, l’accumulation des collisions n’est cependant qu’un effet de la probabilité, une succession de hasards qui s’agrègent insensiblement – selon les lois des grands nombres – autour d’un pôle d’attraction. Il est de toute nécessité que la rencontre soit l’enfant du hasard, qu’elle survienne à l’improviste et saisisse par surprise. Les rencontres qu’on organise, comme les voyages qu’on prépare, n’offrent jamais que de maigres joies. L’histoire n’est pas un destin, et il aurait fort bien pu se faire que l’humanité végétât sans fin dans le sommeil hibernal qui fut le sien pendant des millénaires. L’archéologie des commencements ne peut donner lieu qu’à des conjectures – est-ce l’irruption d’un volcan ou une inondation soudaine qui força les hommes, contre leur gré, à se rassembler, et fut ainsi l’occasion fortuite des premiers attachements ? « Il ne faut pas prendre les recherches sur lesquelles on peut entrer sur ce sujet, précise Rousseau, pour des vérités historiques, mais seulement pour des raisonnements hypothétiques et conditionnels » (9). Dans les premiers temps, la rareté des événements aléatoires est de peu de conséquence. Mais, par rencontres répétées, il vient un point de fusion où le processus s’amorce et s’emballe terriblement. Le déclin qui conduit au chaos est une courbe exponentielle. Pour chacun des particuliers, pris un à un, la surprise de la rencontre est infinie ; mais l’infinité des rencontres ponctuelles finit par s’intégrer dans la sommation sociale. L’humanité s’effondre sur elle-même tandis que l’individu précise son identité, et les hommes se domestiquent les uns les autres selon le progrès de leur aliénation. Plus se prolonge la série, terme à terme, plus improbable est l’innocence de l’état sauvage et plus probable la dépravation de l’état civil. La loi du devenir historique est une loi statistique. Le sens de l’histoire n’est qu’une convergence de probabilité, nullement une nécessité. Sans doute, l’histoire du monde est-elle le tribunal du monde, mais ce que Hegel ne semble pas savoir, ce que Rousseau énonce rigoureusement, c’est que la raison souveraine qui rend ici la justice est raison aléatoire, que la sentence est tirée au sort et que l’acquittement se joue sur un coup de dés. L’histoire n’est pas un destin : en inverser le sens est infiniment improbable mais non pas impossible. L’avalanche de l’entropie peut rebrousser chemin, l’ordre merveilleux peut naître du chaos comme les corps organisés ont su prendre forme depuis le tohu-bohu de la genèse, comme Aphrodite magnifique surgit en riant de la vague fracassante.
Inverser le sens de l’histoire : il faudrait, pour réussir ce prodige provoquer une rencontre dont la violence serait égale et opposée à la somme des rencontres infimes et innombrables qui ont conduit insensiblement le genre humain jusqu’à l’état de sa dépravation présente. Le Contract Social est un semblable événement. A l’origine catastrophique – qui déclenche le progrès de l’inégalité – répond, à l’autre bout de l’histoire, l’origine miraculeuse qui fonde la république. L’une et l’autre sont brisure féconde, sursaut brutal, hiatus dans le devenir qui transforme un état maximal en son état maximal opposé. C’est au paroxysme de l’extase – la rêverie solitaire – que le coup de la rencontre – le surgissement du semblable – est le plus foudroyant. C’est, de la même façon, au point de la plus grande exaspération des passions et des rivalités que s’accomplit une véritable métamorphose de la condition de l’homme. « Celui qui ose entreprendre d’instituer un peuple doit se sentir en état de changer pour ainsi dire la nature humaine, de transformer chaque individu, qui par lui-même est un tout parfait et solitaire, en partie d’un plus grand tout dont cet individu reçoive en quelque sorte sa vie et son être » (10). Du cataclysme révolutionnaire doit naître un homme nouveau. Rousseau pointe exactement l’origine du séisme : quand la haine que les hommes ont les uns pour les autres, que perpétuellement attise la fièvre du défi, l’emporte sur le souci de leur conservation, le soin qu’ils consacrent pour assurer leur sécurité et se maintenir à l’écart. Alors l’enveloppe qui préserve l’intégrité des particuliers, qui garantit l’étanchéité de la sphère individuelle, vole en éclat. Une force nouvelle, qui sommeillait depuis l’éloignement de l’état de nature, que les progrès de l’aliénation avaient imperceptiblement recouverte et fait oublier, entre en jeu et bouleverse les équilibres établis : c’est la puissance de la pitié, qui est le pouvoir proprement humains de s’identifier et de fusionner avec l’univers (11). Le sauvage, rêveur solitaire, s’abîme dans le paysage du monde. Le citoyen se donne corps et âme à la République en train de se faire, il surmonte l’égoïté dont l’amour propre fait un point d’honneur et répond à l’appel d’une autre dignité, celle qui le fait membre d’un tout et l’égal des hommes libres. « L’âme expansive » du sauvage s’abandonne, contemplative, innocente et enfantine, à la somptueuse beauté de l’univers naturel (12). Elle se laisse aller à la douceur du farniente (13), elle s’établit dans l’oisiveté et l’inaction. Mais l’état social naît de l’expansion, de la « généralisation » de la volonté, dans un univers devenu humain. Il est un formidable amplificateur des énergies, et communique aux forces de chacun pris individuellement, la force totale de la communauté une et indivisible. Pour le combattant de la République, l’humanité est toute la « nature ». Le Contract Social réactive la puissance redoutable de la pitié, puissance illimitée qui diverge dans l’infini. Ce contrat-là ne se signe pas devant notaire, mais dans l’instant prodigieux qui seul sait faire échec à l’entropie de l’histoire, l’événement qui voit se soulever les peuples et naître les Nations. Ce qui n’était, il y a tout juste quelques instants, qu’une multitude turbulente devient soudainement un peuple uni, et qui se met debout : « A l’instant, au lieu de la personne particulière de chaque contractant cet acte d’association produit un corps moral et collectif, composé d’autant de membres que l’assemblée a de voix, lequel reçoit de ce même acte son unité, son moi commun, sa vie et sa volonté. » (14)
En un prodigieux raccourci, en quelques journées d’ivresse qui inaugurent une ère nouvelle, l’histoire tout entière, qui depuis des siècles suivait la pente monotone de la haine et du mépris, rebrousse chemin. Par rencontres aléatoires, par frappes distinctes, l’âme impressionnable du sauvage se trouble et s’inquiète, elle s’aiguise par le frottement toujours recommencé de l’orgueil et du dédain. C’est de la même façon, mais en suivant une voie inverse, que s’enclenche le processus révolutionnaire. Ce sont d’abord des foyers de violence qui se signalent çà et là, comme distribués au hasard sur un tissu qu’on devine si tendu qu'un rien doit suffire pour le déchirer de part en part. Une forteresse désaffectée tombe aux mains du peuple, un événement insignifiant – ainsi du moins jugent les aveugles – amorce le phénomène. Quand le système se trouve encore dans le voisinage de son point d’origine, la force qu’il dégage est de faible intensité, une légère résistance suffit pour l’étouffer, pour empêcher l’inéluctable. Mais bientôt se précipite une réaction en chaîne, le feu se propage par la série des collisions au hasard, il s’entretient lui-même en puisant des forces neuves dans l’énergie renouvelée de la pitié. L’événement, une fois encore, est stochastique, et c’est seulement quand il atteint un certain seuil critique qu’on peut le dire irréversible. Ainsi le complot de la veille provoque l’émeute du lendemain, ainsi ce qui n’était, hier encore, qu’une révolte mal assurée, une fluctuation improbable, entraîne tout dans son sillage et devient révolution. Comme la violence de la rivalité, au hasard des rencontres, dégénérait par mimétisme en guerre de tous contre tous, de même l’héroïsme révolutionnaire, au hasard des situations, communique son énergie au peuple tout entier qui se rassemble sous les armes. Chaque citoyen contracte avec la volonté générale dans le temps de sa constitution, la Nation contracte avec elle-même tandis qu’elle s’élève par degrés à la conscience de sa souveraineté. « Chaque membre de la communauté se donne à elle au moment où elle se forme » (15). Le tout précède la partie, l’impossible devient réalité. Origine, et non commencement : jeu surprenant de la pitié et du hasard, naissance d’un Nation que le poids du passé, incapable de concevoir autre chose que la continuation de son propre déclin, faisait croire infiniment improbable. Le pire n’est pas toujours sûr. L’histoire laisse ses chances au hasard. L’événement ne prévient pas, et les plus méticuleux calculateurs ne sauraient réduire tout à fait une certaine marge d’improbabilité qui porte en elle la promesse de l’avenir.
Il n’y a de société véritable que dans l’allégresse de cette fête. Le théâtre aristocratique plonge les spectateurs inactifs dans les ténèbres et les maintient, médusés par les feux de la rampe, dans l’isolement radical. Mais la fête révolutionnaire rassemble le peuple dans l’innocence du plein-air, elle célèbre les retrouvailles de chacun avec tous sous un soleil éclatant, dans la nature inondée de lumière, dans un espace d’absolue transparence, sans réserves ni secrets. Par le chant et par la danse, la fête répand dans la communauté tout entière le bonheur unique et le rare élan de l’origine. Si l’on veut bien suivre Rousseau, il faut reconnaître, en la fondation de la République, l’extension à la collectivité d’un acte originairement esthétique, l’élargissement, au corps vivant de la Nation, de l’émotion qui saisit l’âme sensible dans l’instant de la rencontre. Pour que la fête commence, il suffit, assure le citoyen de Genève, de peu de choses : « Plantez au milieu d’une place un piquet couronné de fleurs, rassemblez-y le peuple et vous aurez une fête » (16). Le rite très antique de l’arbre de mai célèbre à la fois la fécondité de l’espèce humaine et le renouveau de la nature, il rétablit l’harmonie en faisant s’accorder la liesse de la Nation naissante et l’ivresse du printemps (17). Pourtant, cette couronne de fleurs, il faudra trouver des doigts habiles qui sauront la tresser, comme il faudra, pour ordonner le bal printanier que Rousseau imagine « entre de jeunes personnes à marier », un maître de danse qui enseigne la grâce des gestes et compose l’évolution des chœurs (18). Bientôt, l’artiste sera promu maître du cérémonial révolutionnaire, et David œuvrera pour mettre en scène le culte de l’Etre Suprême. Sans doute Rousseau souhaitait-il se maintenir au plus près de la nature – la fête qu’il rêve est toute spontanéité, sans apprêt ni artifice – et éviter de corrompre la vérité de l’origine par le supplément dont l’homme de l’art fait profession de l’orner. Il reste que seuls le sentiment de la beauté et le transport partagé des âmes sublimes – qui sont également phénomènes esthétiques – donnent vie et puissance à la souveraineté populaire. C’est un unique et même ravissement qui scelle le baiser de Julie et Saint-Preux dans le bosquet de Clarens (19), qui saisit l’écrivain lui-même quand, rêvant de Julie, il voit soudain venir à lui, en habit de chasseresse, la comtesse d’Houdetot (20), une unique et même flamme qui interdit le cœur innocent du sauvage quand « le tonnerre, un volcan ou quelque heureux hasard lui fit connaître le feu » (21), un unique et même incendie qui se propage dans l’humanité tout entière quand la Nation, prise de révolution, contracte avec elle-même. Rousseau n’est pas une âme double, ni un homme à paradoxe : c’est la même plume qui inscrit les sentences définitives du Contract Social et qui invente le lyrisme musical de La Nouvelle Héloïse. Il existe une isomorphie remarquable entre, d’une part l’acte de la saisie esthétique – dont la théorie de la rencontre s’est efforcée de décliner les raisons – et, de l’autre, « l’acte par lequel un peuple est un peuple », l’origine catastrophique qui déclenche l’explosion de la pitié. La fête républicaine n’est que l’amplification, démesurément grossie, de cette fête exquise qui ébranle le libre jeu de l’imagination esthétique et conçoit l’accomplissement de l’œuvre d’art. La danse qui s’empare du peuple souverain est le prolongement innombrable du rythme qui prend appui sur l’incidence fertile de la rencontre. La concorde des citoyens accorde les cadences, l’interférence est constructive comme le rythme est entraînant, l’échange esthétique déploie, sans jamais l’épuiser, le choc sémantique qui l’a fait naître, alimente le dialogue et noue le lien civil.
Le sentiment esthétique est la condition nécessaire de toute communication entre les hommes : Kant formule, dans la troisième Critique, le principe fondamental que chaque ligne écrite de la main de Rousseau suggère et rend sensible. Ce n’est pas là intersubjectivité – ce thème appartient à Fichte et non pas à Kant – qui met en phase les partenaires de l’échange, qui rend possible la communication d’individu à individu, mais communion plutôt de tous les individus pris ensemble dans l’élan d’une vie universelle qui les soulève également, ce « jaillissement de la force vitale » sans lequel, selon Kant, il ne saurait y avoir de communauté parmi les hommes (22). Il ne s’agit pas ici de communiquer les uns avec les autres, mais de communiquer tous également dans l’ivresse rythmique impulsée par la rencontre, « une ivresse, écrit Rousseau, plus douce que celle du vin » (23), de participer également au libre jeu de la vie avec elle-même. La loi morale peut certes fonder la communion des saints qui rassemble tous les êtres de raison dans l’Eglise invisible, et les libertés dans le règne des fins. Les principes du jugement comme les catégories de l’entendement valent également, pour nous autres hommes, dans la cité savante que met d’accord l’architectonique de la connaissance spéculative. Mais entre l’exactitude des propositions logiques et l’universalité inconditionnée du devoir, il est une place intermédiaire, comme un pont au-dessus d’un abîme, un intervalle de variation entre les bornes duquel nos facultés sont libres de se livrer au bonheur de l’improvisation, une aire de jeu où les hommes doués de sentiment sont appelés à reconnaître leur mutuelle humanité. Sans l’octroi de la grâce, sans le plaisir pris à la beauté, les hommes, qui sont profanes, connaîtraient sans doute la dignité de l’humanité, qui seule est sainte en eux, et dont ils ont reçu la garde et le dépôt. Mais condamnés à surmonter toujours leur nature sensible et leur trop peu de volonté, ils ne réussiraient jamais à se rencontrer en ce monde et seraient contraints de repousser leur nécessaire réconciliation à la limite, portée à l’infini, de leur progrès moral. La beauté est la promesse, non du bonheur, mais de la béatitude, elle vient annoncer parmi les hommes la félicité qui n’appartient qu’à Dieu, elle « symbolise » le Bien et présente, dans le sensible, l’accord universel qui doit régner dans le supra-sensible. L’homme qui se réjouit de la beauté du paysage ne saurait être tout à fait un méchant homme (24). Le sauvage que Rousseau imagine sympathisant innocemment avec la nature ne saurait être déjà corrompu. Sans l’originaire pitié, rien ne réussit à faire obstacle à l’envahissement de la haine. Sans l’émotion esthétique, sans l’émotion partagée de la beauté, le cercle social serait dépourvu de motif immédiat et nulle inclination sensible ne porterait les hommes à se rapprocher les uns des autres, à s’entretenir ensemble d’un plaisir universellement éprouvé, dont aucun concept ne peut jamais venir à bout, une joie nécessaire qui cherche les mots pour se dire et poursuit sans relâche le dernier mot qui mettrait fin à toute discussion.
La terre est ronde, en effet. L’éblouissement de la rencontre découvre à l’œil naïf un espace de liberté, elle dessine le cercle d’un horizon où l’imagination peut se donner libre cours, un domaine où l’invention est appelée à prendre la mesure de son génie. L’artiste s’établit au centre de l’anneau, il cultive l’arborescence des rencontres improbables, il voyage au hasard, au hasard des chemins et, toujours disponible, cède à la tentation des détours et des échappées qui font signe. La ligne du progrès est une marche aléatoire, une ligne brisée dont chaque segment se joue aux dés. Le développement d’une culture ne procède pas selon l’ordre des raisons, selon le pas attentif et maîtrisé de la méthode, mais par bouquets et étoiles, par rencontres renouvelées, en renouvelant la surprise, infiniment recommencée. L’aberration de cette avance n’est pourtant qu’une illusion du sujet. Pour le voyageur égaré dans l’écheveau infini des occasions signifiantes, porté de part et d’autre selon les aléas de la conjoncture, l’itinéraire que la suite des événements suggère peut bien sembler incohérente. Son parcours erratique progresse sans raison. Il obéit néanmoins à l’ordre qu’une raison aléatoire assigne, il s’inscrit dans une enceinte, un domaine de dispersion qui distribue les sorts et diminue l’amplitude du jeu. Localement, la randonnée est aberrante, et comme ces courbes que les mathématiciens nomment « fractales », elle se fractionne à l’infini, déroutée par une infinité d’infimes accidents qui brouillent la piste, brisent la continuité et bifurquent vers le chaos. Mais globalement, le jeu du hasard obéit à une secrète cohérence, il fait naître l’ordre depuis le désordre apparent et recompose l’image que le détail discret décompose et réfracte. Il est toujours possible de définir l’unité d’un site sémantique, dans les limites duquel l’initiative individuelle reste libre d’improviser à sa guise, mais qu’elle ne saurait transgresser sans aussitôt se renier elle-même. Dans le cercle du « contract », une infinité de turbulences sont possibles. Chacun est également appelé à développer l’originalité de son talent, et si les voix consonnent dans la concorde républicaine, il n’en est pas deux qui soient si semblables qu’elles épousent la même ligne mélodique. Le hasard ne s'oppose nullement à la nécessité, mais il est le plus subtil expédient pour échapper aux contraintes de l'uniformité. L’unanimité de la volonté générale est dynamique et non monotone, elle accorde les différences dans l’unité du concert, elle s’oppose, diamétralement, à l’unanimité morte qui est le symptôme de la tyrannie : « A l’autre extrémité du cercle, écrit Rousseau, l’unanimité revient : c’est quand les citoyens, tombés dans la servitude, n’ont plus ni liberté ni volonté » (25). Ainsi l’unité d’une culture ne dicte nullement l’ordre linéaire d’une méthode, elle limite un champ que l’interprète peut arpenter selon l’inspiration du moment, tracer sa propre ligne de conduite – propre, c'est-à-dire à la fois adéquate et singulière – parmi l’infinité des lignes également compossibles qui forment le dessin cohérent d’une civilisation. Le hasard n’est pas la négation de l’ordre : il en est plutôt l’exploration spontanée, il s’achemine vers l’ordre, il s’avance à la rencontre d’une cohérence globale qui oriente la perspective de son histoire et qui donne au drame, que l’événement tragique provoque, l’unité de son action. La terre, dont les hommes interprètent le sens, est une boule ronde. L’intervalle distribue les variations sur la surface d’une sphère, qui est un univers, c'est-à-dire un espace à la fois infini et limité. La forme totale déploie le traumatisme de sa naissance, elle garde la forme par expansion depuis l’événement séminal, comme un corps maintient sa cohésion en se rapportant à son centre de gravité. C’est ainsi qu’un peuple n’est un peuple qu’en se forgeant une mémoire, en jurant fidélité à l’acte fondateur que les fêtes, qui raniment la flamme, commémorent et renouvellent. C’est ainsi que le peintre reconnaît l’unité de son art en cultivant le souvenir – qui réinvente et interprète, mais ne répète jamais – de l’éblouissement initial qui lui donna le jour. Il n’est pas de jeu possible si l’on ne limite d’abord un espace où jouer, il n’est pas de liberté possible – qui est randonnée exploratoire dans l’espace sémantique – qui ne se rapporte à ce point d’ancrage qui assure l’unité de l’ensemble. La série aléatoire des événements est le commentaire successif de son terme primitif. Bien des histoires sont possibles. Une infinité d’événements, sans doute, est appelée à féconder un devenir, chacun également porteur de sens et prétendant à la valeur du signe. Mais toute histoire, dans le domaine qui est le sien, ne sera jamais que l’explicitation de son origine.
Le beau plaît sans concept. Non par défaut, mais par excès. Le sentiment esthétique ne paralyse pas la spontanéité de l’entendement, il lui présente au contraire une profusion « d’Idées esthétiques » dont la richesse excède toute réglementation logique, il soumet l’esprit au flux mouvant, aux suggestions innombrables qui naissent et disparaissent par le libre jeu de l’imagination, comme la danse des flammes esquisse, sous les yeux du rêveur, des figures évanescentes (26). Si la beauté n’est pas concevable, si elle ne saurait être l’objet d’une connaissance, elle donne néanmoins, écrit Kant, beaucoup à penser : « Par l’expression Idée esthétique j’entends cette représentation de l’imagination qui donne beaucoup à penser, sans qu’aucune pensée déterminée, c'est-à-dire de concept, puisse lui être adéquate et que par conséquent aucune langue ne peut exprimer et rendre intelligible » (27). Le langage, qui fait s’entretenir les partenaires de l’échange au sein de la société esthétique, s’épuise à nommer ce qui le fait parler, mais qu’il ne saurait dire. Ainsi la communauté humaine naît de l’impact originaire qui l’institue, mais qu’elle échoue à comprendre. Le domaine de l’interprétation reste ouvert. La sphère, que parcourent en tous sens les randonnées herméneutiques, obéit aux lois d’une bizarre topologie : le centre, qui détermine le rayon de sa courbure, ne se situe pas à l’intérieur, mais à l’extérieur au contraire, rejeté en un point d’indécidabilité que le discours ne peut atteindre. La rencontre est la condition transcendante, et non immanente, du territoire sémantique dont elle élargit l’horizon. Le point de visée sur lequel prend appui l’orientation perspective est un point aveugle, un espace vide que le travail de l’interprétation ne parvient jamais à combler. L’arpenteur ne réussira pas à pénétrer dans le château. La logique, dit-on, est structure et architecture, architectonique et système. Curieuse architecture, cependant : la clé qui en ferme la voûte n’est pas de pierre dure, dense et solide, elle est une lacune au contraire, l’absence d’un concept, le non-sens où le sens prend sa source.
La dépression qui se creuse au centre non accessible du discours fausse insensiblement la dispersion aléatoire des rencontres : elle réduit l’amplitude de l’invention, elle finit par imposer sa loi au hasard. Ainsi dépérissent les cultures. Dans le voisinage de l’émerveillement originaire, le commentaire réussit à garder ses distances, porté par l’élan de la rencontre, il se porte dans le lointain, il lance la métaphore sur la parabole de la plus grande poésie. Mais quand la série des impacts au hasard laisse deviner la forme de l’ensemble, l’effet de surprise est chaque fois de moindre conséquence, la portée de l’interprétation diminue chaque fois davantage. La ligne de pente incline alors le discours à s’effondrer dans la lacune centrale qui le fonde, le langage officiel obstrue et recouvre progressivement l’énigme qui lui donne vie. Le déclin de l’improvisation engendre les dogmatismes, l’esprit cède à la tentation de nommer l’innommable, de démontrer son propre principe et d’exposer par concepts ce que le concept présuppose. Toute parole meurt quand elle prétend à l’impossible, tout langage se pétrifie quand il s’attribue l’honneur illusoire d’être à lui-même son propre métalangage. Le lancer qui porte le signe vers l’horizon le plus lointain de la perspective s’affaisse insensiblement jusqu’au point le plus bas de son potentiel, le cercle herméneutique se rétrécit et se tasse sur lui-même. Alors la fête devient célébration des autorités compétentes, cérémonie pompeuse et vaine qui répète inlassablement, de façon monotone, l’acte fondateur qu’elle ne sait plus régénérer. Le régime est en voie de normalisation quand il se stabilise en se déprimant, quand l’énigme a cessé de féconder la parole, quand la rencontre n’a plus lieu.
« Le corps politique, aussi bien que le corps de l’homme, écrit Rousseau, commence à mourir dès sa naissance et porte en lui-même les causes de sa destruction » (28). Ce qui n’était qu’un troupeau se constitue en peuple quand, soulevé par l’élan de la volonté générale, il proclame son indépendance et revendique son autonomie. Mais le peuple redevient troupeau quand il suit ce que Rousseau nomme sa « pente à dégénérer », quand l’ébranlement qui lui a donné naissance s’affaisse autour d’un point d’équilibre, quand la volonté à nouveau se déprime. L’oubli de l’origine engendre le déclin, et c’est le destin de l’origine que de se laisser oublier, puisqu’elle se retire dans l’inconcevable. La fête est enivrante, mais les troupeaux sont déprimants. Tous répètent le refrain auquel nul ne croit plus, et plus rien ne fait signe. Le chaos n’est pas la turbulence – de laquelle peut toujours surgir le hasard fertile – mais l’ordre invariable, le flux laminaire qui aligne uniformément la direction des volontés, le défilé militaire des automates par colonnes. Rien ne semble plus devoir ébranler le système qui s’est cristallisé. L’économie règne alors sans partage. Quand rien ne vaut plus vraiment, tout se vend à prix d’argent. L’échange esthétique d’effervescence maximale, infiniment sensible aux conditions initiales, aux sollicitations du hasard, noue le lien social. Il euphorise la volonté en amplifiant le rythme de la rencontre. Il découvre un domaine inédit, par trouvailles saisissantes, par variations discrètes. Mais l’échange marchand est un dépresseur universel : il réduit l’aliénation des partenaires au plus petit dénominateur commun, le transfert des équivalents également monnayables. L’économie est le degré zéro des sociétés. Elle fait du signe une simple marchandise, que mesure uniformément et abstraitement la quantité de travail social. Elle évalue l’originalité de l’invention en la rapportant à l’échelle des salaires, qui est un équivalent universel. Quand elles ne sont plus que réseaux économiques, les sociétés humaines entrent en agonie. L’art s’abandonne à la pente qui le fait dégénérer quand il n’est plus qu’un marché. L’œuvre ne vaut que par la résistance qu’elle oppose à l’entropie qui la réduit à sa valeur marchande. L’échange économique est une communication sans rencontre. Il est la communication de plus faible information possible. Alors la culture n’est plus que la gestion des communications, et non ce qu’elle est quand elle est vivante, fluctuation et turbulence, parasite fécond qui perturbe par surprise la normalité des échanges. Il n’y a pas de pire despotisme que celui du marché. Les prétendues contradictions du capitalisme – et le capitalisme n’est autre chose que la dictature universelle de l’économie, la mise à nu de la société minimale et l’assujettissement de l’homme à la production des marchandises – sont peut-être moins contradictoires qu’on a voulu le croire, qu’on a voulu l’espérer. L’histoire de ce temps montre combien la guerre peut s’éterniser, comment il est possible d’organiser rationnellement le massacre des populations, comment l’impérialisme peut se stabiliser sans rien renier de son œuvre dévastatrice. On exploite aujourd’hui les conflits armés, sources inépuisables de profits, comme on exploitait autrefois les mines d’or ou d’argent. La violence elle-même, qu’on disait être l’accoucheuse des sociétés, peut se normaliser, entretenue par les intérêts qu’elle enrichit et contenue par la terreur nucléaire. Le schéma orwellien démontre qu’il n’y a pas de contradiction structurelle à l’exploitation absolue. Si contradiction il doit y avoir, elle ne peut provenir que du refus assumé par une libre volonté, que d’une volonté d’insurrection qui se dresse contre la planification des échanges. L’histoire n’est pas un destin, l’événement n’est qu’une éventualité probable, jamais une nécessité. Quelque grande soit la tension de la situation, la révolution tragique ne peut jamais s’effectuer si nul ne survient pour prendre le chemin de Thèbes. L’art se maintient au foyer non réductible où l’initiative se détermine à agir, il tient la garde du sanctuaire sans lequel la liberté ne serait qu’un vain mot.
Marx ouvre Le Capital sur une énigme : nous ne savons pas encore penser la distinction de la valeur d’usage et de la valeur d’échange. La théorie de la plus-value rend compte de la seconde. De la première, rien n’est dit, sinon qu’elle est la mesure qualitative d’un besoin. C’est peu de chose. Qui plus est, quand l’interprétation sociologique – et tout particulièrement celle qui se réclame de Marx – entreprend de démontrer les raisons de l’événement esthétique, elle s’efforce surtout de montrer combien le plaisir que l’œuvre nous procure est le pur produit du mécanisme des échanges, simple reflet et non réalité effective en laquelle s’exprime une vérité propre et autonome. Ainsi, la valeur d’usage, que nous goûtons individuellement à la consommation de l’œuvre d’art, serait elle-même dérivée de la valeur d’échange qui socialise la marchandise. Où donc est la différence ? Si les fluctuations du goût reflètent fidèlement les impératifs de la production, la valeur d’usage n’a de sens que pour l’illusion d’un individu qui se croit seul estimateur. Elle n’est donc qu’une robinsonnade, un mythe auquel l’économie a recours pour se blanchir et s’innocenter. Seule règne sans partage la valeur d’échange. Mais alors, pourquoi se plaindre, et ne pas reconnaître, dans le développement du capitalisme, l’avènement de la vérité de toute valeur ? Marx n’aurait jamais écrit Le Capital s’il ne s’était pas refusé à faire de la valeur d’échange toute la valeur. La valeur d’usage, qui se trouve aussitôt recouverte alors même qu’elle est à peine définie, est problématique. Sa théorie reste à faire. Elle seule peut fonder l’autonomie de l’analyse esthétique. La théorie de la rencontre fut conçue pour exposer le mécanisme d’une invention qui ne doit rien à la stricte logique de l’échange marchand, pour mesurer un intervalle de variation en lequel l’imprévisible peut toujours survenir. Elle nous permet de comprendre combien l’art est peu de chose quand il n’a plus la force de manifester son indépendance, quand, privé de toute spontanéité, il s’effondre et s’aligne sur le minimum sémantique, sur l’exacte nullité de la normalité économique. Il est vrai, comme on le répète à satiété, et non sans une trouble complaisance, que les idées dominantes n’ont jamais été que les idées de la classe dominante. Mais on oublie d’ajouter que les idées dominantes sont celles qui n’ont plus rien à dire. Les idées qui dominent ne sont pas les lieux communs qui dépriment la pensée et cèdent à l’attraction de l’équivalence universelle. Celles-là circulent sans danger, on les répète sans risque. Les idées dominantes concluent un passé ; elles n’annoncent pas un avenir. L’avenir, c’est à d’autres pensées qu’il appartient, des pensées silencieuses qui viennent à l’esprit sans que nous n’y prenions garde. « Ce sont les pensées qui viennent comme portées sur des ailes de colombe qui mènent le monde », remarque Nietzsche (29). La rencontre signifiante naît toujours d’une turbulence accidentelle qui survient aux limites, dans la périphérie qui échappe au contrôle de ceux qui s’arrogent la domination et prétendent penser pour tous. La venue du signe est insolente, irréductiblement. Née du hasard, elle déjoue les prévisions et échappe à la surveillance des doctes qui s’imaginent régner sur les esprits. Nous ne serons pas bien savants tant que, de l’histoire des idées, nous ne saurons formuler que les dominances, tracer les lignes générales, calculer le déterminisme global. Ici comme ailleurs, le plus général est aussi le plus insignifiant. C’est au contraire parmi les fluctuations infinitésimales qui se forment en marge qu’il faut aller chercher l’origine de la catastrophe que l’avenir déploiera. L’uniformité des idées dominantes est monotone comme un flux laminaire, elle lamine les différences embryonnaires, elle écrase les initiatives non programmées. Ainsi le fleuve ruisselle selon la ligne de la plus grande pente, il dévale en cataracte vers son embouchure. Mais, près de la rive, se forment d’innombrables tourbillons qui réussissent – significativement – à remonter le courant.
Il faut rétablir la pluralité des histoires. Kant enseignait à l’humanité devenue autonome le chemin d’un progrès moral infini. Hegel ne manque pas de l’ironiser sur ce point : qu’est-ce donc en effet que progresser à l’infini, sinon faire du surplace ? Quelque grande soit la distance déjà effectuée, n’est-elle par rigoureusement nulle, un exact zéro devant l’infini qu’il faut encore parcourir ? S’il ne s’agissait, pour l’homme en son histoire, que de progresser à l’infini, il périrait d’ennui dès les premiers pas. C’est ainsi que les physiciens du XIXe siècle croyaient avoir tout dit de leur science quand ils la disaient commentaire sans fin de la mécanique newtonienne. D’immenses calculs attendaient la patience des chercheurs, mais rien de fondamental ne sollicitait plus leur génie. Triste destin ! Le progrès se ferait donc continûment, à l’infini depuis la « révolution subite » qui, une unique fois, a montré la voie, révolution spéculative quand l’entendement réussit à soumettre l’expérience à ses principes, révolution morale quand l’humanité s’est élevée jusqu’à la conscience de son autonomie. Ces révolutions faites une fois pour toutes pensent sans doute la grandeur de l’événement, mais disent tout aussi bien combien on souhaite peu le voir revenir, combien on craint son retour. Les grandes révolutions fournissent d’excellents arguments à ceux qui rêvent d’écraser les petites révolutions. La révolution se généralise par propagation, par la puissance expansive de la pitié qui communique progressivement à tout le corps de la Nation l’écart différentiel d’une perturbation originaire. La figure est invariante, par transformation d’échelle. Les « révolutions subites » qui, selon Kant, tracent à jamais la voie d’un progrès infini, recouvrent une multitude de révolutions minimales, les unes appelées à disparaître, les autres à enfanter des mondes. L’unité de notre histoire, la continuité de son flux est l’effet d’une illusion : le mouvement rétrograde du vrai nous incline à ne percevoir dans le passé que l’ombre projetée de notre présent. Rien de véritablement nouveau n’est alors possible sous le soleil, le devenir rabâche et nul ne peut vraiment agir depuis que fut accompli, une fois pour toutes, l’acte fondateur. Le progrès à l’infini n’est qu’un déclin à l’infini, la déclinaison monotone d’une unique origine. La théorie de l’entropie est myope : elle ne discerne pas l’infinité des détails infinitésimaux qui annoncent le renversement de la tendance. Elle stérilise l’invention en s’arrogeant le monopole de la signification.
Le développement d’une culture est parcours erratique, randonnée parmi l’infinité des possibles, tous également situés à l’intérieur d’un même horizon sémantique. Il existe un nombre aussi grand que l’on veut – infini, donc – de parties jouables dans les limites de cette aire. Leur succession forme une série aléatoire qui progresse en effet, puisque aucun terme ne s’y rencontre deux fois, puisque les itinéraires n’y sont jamais identiques, et qui progresse à l’infini. On ne saurait assigner de terme au libre jeu des interprétations. Il est toujours possible, sans doute, de composer un chef d’œuvre en do majeur. Ceux qui se lamentent sur le déclin de l’art contemporain se consolent en admirant les natures mortes que certains peintres exécutent encore, à la façon des maîtres d’autrefois. Il faut reconnaître cependant que cette infinité-là ne réserve guère de surprises et s’approche d’un seuil de saturation qui tend – infiniment sans doute – à amenuiser les différences, à céder à la facilité de la répétition pure et simple. Progresser à l’infini, c’est, somme toute, peu de chose. S’il est certes impossible – ce serait une fastidieuse tâche – de dénombrer l’infini, il est cependant possible de démontrer rigoureusement, par correspondance univoque, de telle classe infinie, qu’elle est dénombrable. L’infinité dénombrable, dont le progrès est illimité, n’est qu’une faible infinité, le degré zéro dans l’échelle des transfinis, l’infinité de moindre cardinalité. Il existe toujours une infinité d’ordre supérieur, qui surpasse la puissance du dénombrement et excède la totalité des termes qui composent l’infinité d’ordre inférieur. Ainsi chaque rencontre porte avec elle la promesse d’une signification infinie et néanmoins dénombrable. Il appartient au destin en lui-même illimité d’une culture de réaliser ce dénombrement. Mais une infinité de rencontres est encore possible, et chacune ouvre un nouvel horizon, qui est un ensemble infini d’itinéraires à parcourir. Il existe une infinité de styles susceptibles chacun d’engendrer des œuvres en nombre infini. Le progrès ne se fait pas à l’infini, mais d’infinité en infinité, et cela infiniment, par catastrophes et ruptures. La créativité du devenir est inépuisable. Une infinité d’infinités attend encore sa découverte. C’est ainsi que dans les limites d’un mode, ou d’un ton donnés, rien n’interdit de composer l’infinité des mélodies dénombrables. Mais rien n’interdit non plus d’explorer l’infinité non dénombrable des modes, ou des tons possibles.
Le progrès à l’infini est un régime stationnaire qui emprisonne le sens dans les limites d’un jeu, et d’un seul. L’invention, qui tend nécessairement à maximaliser le hasard, ne saurait rester toujours soumise à la même contrainte. Ce n’est pas assez d’une seule infinité pour rassasier notre appétit de savoir. Dès qu’une culture est en mesure de reconnaître l’horizon au sein duquel son discours se déploie, elle s’efforce aussitôt de le briser, elle retourne contre elle-même l’énergie qu’elle avait dépensée pour conquérir son territoire. Voici un siècle, Nietzsche diagnostiquait déjà les symptômes d’un nihilisme actif souterrainement à l’œuvre dans les cultures européennes : non pas une simple anémie de la volonté, l’ordinaire fatigue entropique, mais la résolution tenace qui porte à se détruire soi-même, à liquider un passé devenu encombrant, à réapprendre les vertus de l’oubli. Il est vrai que cela fait déjà quelque temps que, parmi les divers styles que se donne aujourd’hui l’art contemporain, l’anti-art – qui se dit tel – semble encore le plus vivant. Le vide onirique, en lequel vient se dissoudre la forme saisie au point de l’inversion hallucinaire, hante notre culture : l’artiste rêve de faire le vide et de désencombrer du bric-à-brac qui l’oppresse l’espace de la représentation. Le peintre veut dégager du tableau tout ce qui vient en offusquer la blancheur, le musicien veut se mettre à l’écoute du silence en lequel s’ensevelit, discrète, la vibration sonore. Art minimal, sensible à la tentation de l’inexistence, cédant au magnétisme du néant : « Plutôt que de ne rien vouloir, énonce Nietzsche, la volonté humaine veut le rien » (30). C’est ainsi que les généticiens inclinent aujourd’hui à croire que tout organisme parvenu au seuil de sa maturité – qu’on suppose atteint quand est perdu le pouvoir de se reproduire – déclenche contre lui-même le signal de la dégénérescence (31). La mort est au programme, elle est inscrite dans le programme génétique, et il est aussi nécessaire à l’organisme vivant de s’accroître de l’embryon jusqu’à l’adulte que de prononcer, quand vient la sénescence, la sentence de mort. Seules les cellules cancéreuses sont immortelles : nul ne connaît la limite de leur prolifération. Chaque jour des vies s’éteignent, étouffées par le développement en leur sein de la tumeur d’immortalité. On peut mourir en effet d’être immortel. Toute vie aurait depuis longtemps disparu si elle avait eu pour seul destin de progresser à l’infini. L’infinité de notre histoire n’est pas stable, mais infiniment turbulente. Les surprises ne sont pas dénombrables. La mort laisse sa chance au hasard : elle multiplie la probabilité des mutations les plus étranges, des métamorphoses les plus inouïes. Elle participe activement à la reconnaissance ininterrompue de l’infinité des infinis qui nous appellent à penser. La volonté de néant, les mécanismes autodestructeurs du nihilisme nous évitent l’uniformité de la normalité et l’enfer de l’immortalité. Seul le rythme est éternel, par pics et dépressions, par attaques et syncopes, par naissances et par morts. Le chiffre, sur qui tombe le sort, qui stabilise les dés, ne dure qu’un instant. L’enfant, éternellement, renouvelle le lancer.
CONCLUSION
[Cette courte conclusion a été rédigée pour rendre plus explicite encore le lien entre la théorie esthétique ici développée et l’ouvrage que j’ai publié aux éditions de La Lagune en 1993 sous le titre : Métaphores du regard. Ce texte, qui est une réflexion générale sur l’histoire de la peinture en Europe depuis la première renaissance italienne du Trecento, est entièrement structuré sur les trois moments de la rencontre esthétique, que je nomme le Spectaculaire, l’Hallucinaire et l’Onirique. Il s’ouvre en outre, dans le premier chapitre intitulé « Majesté », sur une longue analyse de l’œuvre de Giotto.]
***
Ce parcours, qui s’origine dans la collision fertile de la rencontre et se prolonge jusqu’au seuil de la mort volontaire, il est possible de le suivre pas à pas, œuvre par œuvre, selon l’histoire de la peinture en Europe. Tout autre domaine d’invention aurait également pu le mettre en évidence. Penser cette histoire, c’est penser comment elle reproduit, jusqu’en ses détails les plus infimes, la structure invariante d’une rencontre qui a valeur de signe. Toute l’histoire de la peinture est le déploiement de la saccade exquise qui saisit le regard quand il fait face à l’image surgissante. Le génie de Giotto consiste en ce qu’il sut le premier élever la sensation visuelle à la dignité de la fonction sémantique. La rencontre merveilleuse de l’apparence qui chatoie dans la lumière est source d’une signification infinie, et le corps stigmatisé par les rayons du soleil – tel François d’Assise miraculé sur le mont de l’Alverne – répond, infiniment, à la violence de sa vocation sensible. Il y a dans le pur acte de voir l’ouverture d’une vie qui s’épanche dans le monde, l’affirmation d’une volonté qui accroît son rayon d’univers. Giotto comprit le premier que l’œil avait de l’esprit, et que la majesté du monde visible est un dieu qui fait signe, et appelle à penser. Ce choc féconde toute la peinture. Il donne à l’interprète le ton, à l’histoire, le rythme. Considérée dans sa généralité, la topologie de l’espace – le paysage qui s’élève progressivement dans la brèche de l’ouverture perspective – arpentée des siècles durant par les peintres, ne diffère pas significativement de la topologie qui définit le relief de tel ou tel domaine de culture, de tel ou tel territoire sémantique. Spectaculaire, hallucinaire et onirique ne sont que les formes picturales des trois actes qui manifestent le destin de l’événement et scandent la rencontre du signe. Seul appartient en propre à la peinture d’avoir su magnifier l’acte visuel en l’élevant à l’extrême tension de la rencontre, en le faisant participer au devenir maïeutique de l’esprit, pour qu’il s’exalte lui-même et qu’il donne son plein. Analyser le tableau, c’est le situer dans l’ordre général de la symphonie, dans la figure étoilée jaillie de l’explosion initiale. C’est reconnaître surtout en lui une interprétation, parmi l’infinité des possibles, de l’incidence miraculeuse qui guérit les aveugles et jette l’œil vivant à l’océan de la lumière. Cela n’était peut-être pas évident. À première vue, le tableau représente tout ce qu’on veut et n’importe quoi, des compagnies de hallebardiers comme des bœufs écorchés, les tours d’un escamoteur démoniaque (32) comme la naissance d’un enfant divin, des courtisanes langoureuses comme des saintes en extase. Il n’était peut-être pas facile de retrouver dans le labyrinthe des thèmes et des sujets l’interprétation toujours recommencée d’un unique événement, l’éveil et le sursaut du regard étonné que le rayon lumineux ensemence. L’histoire de la peinture expose, somptueusement, la sémiologie de l’humaine vision. Elle fait jouer le chiasme visuel qui provoque et renouvelle par saccades l’éclair de l’image signifiante. Il est temps de revenir au lieu d’où nous sommes partis : à cette chambre où luit le miroir qui ne représente pas une chambre, ni un miroir, mais l’œil du peintre qui conçoit l’image ; à ce mariage qui ne représente pas un mariage, mais l’accouplement de l’œil à la lumière (33). Le tableau est la métaphore du regard. Il soumet l’acte visuel au difficile exercice du « connais-toi toi-même ». Les peintres donnent à voir, en effet. Nous avons contracté envers eux une dette : sans leur leçon, nous ne saurions peut-être pas encore quelle puissance terrifiante, à jamais émerveillante, fait frémir nos yeux fertiles dans l’universelle passion de la lumière.
NOTES
1- J.-J. Rousseau, Le Contrat social, I, 5 ; Œuvres complètes, Pléiade, 1964, tome III, p. 359.
2- J.-J. Rousseau, Essai sur l’origine des langues, chapitres VIII à X.
3- J.-J. Rousseau, Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes, dans Œuvres complètes, Pléiade, tome III, 1964, p. 162 et 167. Sur l’empreinte ineffaçable des différences infimes : Jacques Derrida, « Nature, culture, écriture », dans De la grammatologie, Minuit, 1967, p. 145-445.
4- « Le premier langage de l’homme, le langage le plus universel, le plus énergique, et le seul dont il eût besoin avant qu’il fallût persuader des hommes rassemblés, est le cri de la nature » (Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes, dans Œuvres complètes, Pléiade, tome III, 1964, p. 148. Et : « Un homme sauvage en rencontrant d’autres se sera d’abord effrayé. Sa frayeur lui aura fait voir ces hommes plus grands et plus forts que lui-même ; il leur aura donné le nom de géants » (Essai sur l’origine des langues, chapitre III).
5- J.-J. Rousseau, Les rêveries du promeneur solitaire, Cinquième promenade.
6- L’opposition de l’amour de soi et de l’amour propre, que Rousseau emprunte aux moralistes de l’âge classique, est un point sensible de sa pensée. On lira par exemple la note 15 du « Second Discours », dans Œuvres complètes, tome III, Pléiade, 1964, p. 219 ; également Les Rêveries du promeneur solitaire, « Huitième promenade », dans Œuvres complètes, Pléiade, 1959, tome I, p. 1079.
7- Essai sur l’origine des langues, chapitre IX.
8- J.-J. Rousseau, Le Contrat social, I, 6 ; Œuvres complètes, Pléiade, tome III, 1964, p. 360.
9- J.-J. Rousseau, « Second Discours », dans Œuvres complètes, Pléiade, tome III, 1964, p. 132-133.
10- J.-J. Rousseau, Le Contrat social, II, 7 ; dans Œuvres complètes, Pléiade, tome III, 1964, p. 381.
11- Sur le principe originaire de la pitié, posé par Rousseau dès l’état de nature, voir le Discours sur l’origine et les fondements…etc. dans Œuvres complètes, Pléiade, tome III, 1964, p. 126, et la note correspondante rédigée par Jean Starobinski, p. 1298-1299.
12- L’expression « âme expansive » se lit dans Les Rêveries du promeneur solitaire, « Huitième promenade », dans Œuvres complètes, Pléiade, 1959, tome I, p. 1074. Sur le double thème de l’expansion et du resserrement de l’âme chez Rousseau, on lira les belles et savantes pages d’Henri Gouhier, Les Méditations métaphysiques de Jean-Jacques Rousseau, Vrin, 1970, chapitre III, p. 107-117.
13-« Le précieux far niente fut la première et la principale de ces jouissances que je voulus savourer dans toute sa douceur, et tout ce que je fis durant mon séjour ne fut en effet que l’acception délicieuse et nécessaire d’un homme qui s’est dévoué à l’oisiveté » (J.-J. Rousseau, Les Rêveries du promeneur solitaire, dans Œuvres complètes, Pléiade, tome I, 1959, p. 1042).
14- J.-J. Rousseau, Le Contrat social, I, 6 ; dans Œuvres complètes, Pléiade, tome III, 1964, p. 361.
15- J.-J. Rousseau, Le Contrat social, I, 9 ; dans Œuvres complètes, Pléiade, tome III, 1964, p. 365.
16- J.-J. Rousseau, Lettre à M. d’Alembert, dans Œuvres complètes, Pléiade, tome V, 1995, p. 115.
17- Sur la liaison entre l’arbre de la Liberté et l’arbre de Mai, voir Mona Ozouf, La fête révolutionnaire, 1789-1799, Gallimard, « Folio », 1976, p. 391-440.
18- J.-J. Rousseau, Lettre à M. d’Alembert, dans Œuvres complètes, Pléiade, tome V, 1995, p. 116.
19- J.-J. Rousseau, La Nouvelle Héloïse, « Lettre XIV à Julie », dans Œuvres complètes, Pléiade, tome II, 1964, p. 63-65.
20- J ;-J. Rousseau, Les Confessions, « Livre neuvième », dans Œuvres complètes, Pléiade, tome I, 1959, p. 438 et suiv.
21- J.-J. Rousseau, Le discours sur l’origine et les fondements… etc., dans Œuvres complètes, Pléiade, tome III, 1964, p. 165.
22- E. Kant, Critique de la faculté de juger, § 9 et § 39 à 41. Pour Schiller, qui prolonge et radicalise cette pensée, seul le sentiment partagé de la beauté peut fonder la République (Lettres sur l’éducation esthétique de l’homme, lettres I à IX).
23- J.-J. Rousseau, Lettre à M. d’Alembert, dans Œuvres complètes, Pléiade, tome 5, 1995, note p. 123-124.
24- E. Kant, Critique de la faculté de juger, § 42 : « … je soutiens que prendre un intérêt immédiat à la beauté de la nature (et non point seulement avoir du goût pour en juger) est toujours le signe d’une âme qui est bonne. »
25- J.-J. Rousseau, Le Contrat social, IV, 2 ; dans Œuvres complètes, Pléiade, tome III, 1964, p. 439.
26- E. Kant, Anthropologie du point de vue pragmatique, Vrin, 1964, § 30, p. 51.
27- E. Kant, Anthropologie du point de vue pragmatique, Vrin, 1964, § 49, p. 143-144.
28- J.-J. Rousseau, Le Contrat social, III, 11 ; dans Œuvres complètes, Pléiade, tome III, 1964, p. 424.
29- F. Nietzsche, Ainsi parlait Zarathoustra, Deuxième partie, « L’heure la plus silencieuse ».
30- F. Nietzsche, La généalogie de la morale, « Troisième dissertation », § 1 ; dans Œuvres complètes, Gallimard, tome VII, 1971, p. 288.
31- Léonard Hayflick, « La biologie cellulaire du vieillissement », Pour la Science, mars 1980, n° 29, p. 84-92.
32- Il s’agit d’une allusion au tableau attribué à Jérôme Bosch et conservé au musée de Saint-Germain-en-Laye : L’Escamoteur. Une longue analyse de cette œuvre ouvre le deuxième chapitre des Métaphores du regard (Paris, La Lagune, 1993), chapitre consacré au moment hallucinaire de la rencontre esthétique. J’ai en outre consacré un petit essai à cet énigmatique tableau : Jérôme Bosch et la fable populaire. Une légende médiévale aux sources de L’Escamoteur de Saint-Germain-en-Laye, Paris, La Lagune, 1995.
33- Allusion au tableau de Jan van Eyck, Le portrait des époux Arnolfini, 1434, National Gallery de Londres. L’analyse de ce tableau, de mon point de vue paradigmatique, occupe la plus grande part de l’introduction des Métaphores du regard.
|
|