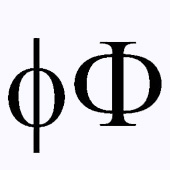L’écriture des grotesques
Dans le Proemio qui introduit aux trois arts du dessin, et qui précède le récit des « vies », Vasari consacre, dans la partie qui traite de la peinture, deux chapitres aux grotesques : le chapitre XII, sur les « graffitis » utilisés pour la décoration des façades (telle celle du palazzo dei Cavalieri, à Pise, peinte par Vasari lui-même en 1562) et sur le procédé utilisé pour faire des grotesques à fresque (come si lavorino le grottesche nelle mura) ; et le chapitre suivant, consacré aux grotesques en stuc, c'est-à-dire ciselés en léger relief. Ces deux chapitres font suite au chapitre XI, consacré aux arcs de triomphe dressés lors des fêtes publiques, entrées princières ou mariages royaux, et sont eux-mêmes suivis par un court chapitre consacré aux techniques de la dorure et à ses ornementations. Les grotesques, qui ont pour vocation d’agrémenter le cadre de l’œuvre, plutôt que de constituer une œuvre à part entière, sont donc eux-mêmes encadrés par un art de l’éphémère, celui du décor de la fête, et par les techniques de dorure héritées des anciens enlumineurs, aujourd’hui surtout employées, précise Vasari, « pour le décor des selles, les arabesques et certains ornements » (I, 186). Ainsi est-on enclin à considérer, comme le suggère cet encadrement, l’art des grotesques comme un art mineur, tel le trompe l’œil d’un décor de bois ou de plâtre qui donne l’illusion d’être de marbre ou de bronze (les architectures de théâtre qui embellissent provisoirement la ville pour la venue des princes) ou telles les décorations dorées à la feuille, œuvres selon Vasari de l’orfèvre, simple artisan, plutôt que de l’artiste peintre. Art de l’accessoire et du bas-côté, les grotesques s’apparentent à l’illusion de la fête, sorte de parenthèse enchantée dans le calendrier des travaux et des jours, ou à la technique de la dorure dont l’un des usages qui intéresse le plus directement les peintres consiste précisément à embellir le cadre ouvragé du tableau. Pourtant, loin de manifester du mépris pour l’art des grotesques, Vasari le considère au contraire comme un exercice de style qui permet d’éprouver le génie de l’uomo virtuoso : « Ces compositions demandent de la hardiesse, une forte définition graphique et un beau style enlevé (forzà, vivacità e bella maniera). Leur expression vigoureuse doit révéler l’art sans sentir l’effort » (I, 179). A l’inverse de la composition centrale, dont le thème est souvent dicté par le commanditaire, la frise des grotesques est laissée à la fantaisie de l’artiste, et c’est ainsi surtout dans les marges qu’il lui est permis de donner toute la mesure de son génie et faire preuve d’originalité. L’accent se déplace ainsi du centre vers la périphérie, de la loge royale pour laquelle le peintre met en scène ce qu’Alberti nommait l’istoria vers les côtés qui biaisent la perspective et glissent un regard dans les coulisses. Pourtant, le point de vue latéral de la fantaisie, de la « fatrasie » des grotesques n’est pas sans noblesse, puisqu’il peut se réclamer du modèle antique à l’imitation duquel se voue l’art de la renaissance, et Vasari plus que tout autre peintre : « Les grotesques sont une catégorie de peintures libres et cocasses (pitture licenziose et ridicole molto), inventées dans l’Antiquité pour orner les surfaces murales où seules des formes en suspension dans l’air pouvaient trouver place. Les artistes y représentaient des difformités monstrueuses nées du caprice de la nature ou de la fantaisie extravagante des artistes (sconciature di mostri, per strattezza della natura e per gricciolo e ghiribizzo degli artefici) ; ils inventaient ces formes en dehors de toute règle (senza alcuna regola), suspendaient à un fil très fin un poids qu’il ne pouvait supporter, transformaient les pattes d’un chevreuil en feuillages, les jambes d’un homme en pattes de grue, et peignaient ainsi une foule d’espiègleries et d’extravagances (e infiniti sciarpelloni e passerotti). Celui qui avait l’imagination la plus folle passait pour le plus doué (chi più stranamente se gli immaginava, quello era tenuto più valente) » (I, 182). Non seulement l’extravagance des grotesques fait renaître parmi les modernes le fastueux décor des anciens, celui des premiers temps de l’Empire (« ces œuvres, précise plus loin Vasari, résistent bien au temps et on en voit de très anciennes en grand nombre à Rome et à Pouzzoles près de Naples »), mais encore le texte même de Vasari imite un passage fameux de Vitruve, il est vrai en en détournant le sens, puisque ce qui était blâme chez Vitruve devient éloge chez Vasari : « Par je ne sais quel caprice, écrivait l’architecte romain au chapitre 5 du livre VII du De Architectura, on ne suit plus cette règle que les anciens s’étaient prescrite, de prendre toujours pour modèle de leurs peintures les choses comme elles sont dans la vérité ; car on ne peint à présent sur les murs que des monstres, au lieu des images véritables et régulières. On remplace les colonnes par des roseaux qui soutiennent des enroulements de tiges, des plantes cannelées avec leurs feuillages refendus et tournés en manière de volutes ; on fait des chandeliers qui portent de petits châteaux, desquels, comme si c’étaient des racines, il s’élève quantité de branches délicates, sur lesquelles des figures sont assises ; en d’autres endroits ces branches aboutissent à des fleurs dont on fait sortir des demi-figures, les unes avec des visages d’hommes, les autres avec des têtes d’animaux ; toutes choses qui ne sont point, qui ne peuvent être, et qui n’ont jamais existé » (1). Par la suite, Vitruve réprimande longuement les extravagances des modernes et donne pour modèle le métier et la rigueur des anciens, qui se refusaient de telles licences. Pourtant Vitruve, devenu à son tour un ancien aux yeux de Vasari, est secrètement présent dans le texte du peintre des Médicis, mais cette fois enrôlé malgré lui dans l’apologie des grotesques. Il est encore un autre texte, plus célèbre encore, que Vasari avait à l’esprit en rédigeant le chapitre sur les grotesques ; il s’agit des premiers vers de l’Art poétique d’Horace, souvent présentés à la renaissance, par une torsion assez semblable à celle que Vasari fait subir à Vitruve, comme la déclaration d’indépendance de l’artiste, le droit de libre invention naturellement accordé au génie : « Si un peintre voulait ajuster à une tête d’homme un cou de cheval et recouvrir ensuite de plumes multicolores le reste du corps, composé d’éléments hétérogènes, de sorte qu’un beau buste de femme se terminât en laide queue de poisson, à ce spectacle, pourriez-vous, mes amis, ne pas éclater de rire ? Croyez-moi, un tel tableau donnera tout à fait l’image d’un livre dans lequel seraient représentés, semblables à des rêves de malade, des figures sans réalité, où les pieds ne s’accorderaient pas avec la tête, où il n’y aurait pas d’unité. – Mais, direz-vous, peintres et poètes ont toujours eu le droit de tout oser. – Je le sais, c’est un droit que nous réclamons pour nous et accordons aux autres. Il ne va pourtant pas jusqu’à permettre l’alliance de la douceur et de la brutalité, l’association des serpents et des oiseaux, des tigres et des moutons. » De ce texte si souvent cité à la renaissance, on retient surtout le quidlibet audendi potestas, le droit qui est celui de l’artiste d’oser tout ce qui lui plaît, et l’on oublie volontiers la condamnation prononcée par Horace d’un art fantastique qui transgresse avec insouciance le précepte aristotélicien de la vraisemblance. Les architectures extravagantes réprouvées par Vitruve, les hybrides impossibles incriminés par Horace, seront ressuscités avec enthousiasme par les peintres italiens dès la fin du Quattrocento, fervents admirateurs de la peinture antique, de son imagination délirante, et peu respectueux des réprimandes des lettrés, au titre desquels prétendait pourtant, et avec raison, Vasari lui-même. On devine ainsi, en surimpression du chapitre des Vite sur l’art des grotesques, les deux textes de Vitruve et d’Horace, mais au prix d’un renversement du sens : les visions fantastiques, velut aegri somnia, censurées par les théoriciens, séduisent bien davantage que les règles dans lesquelles on prétend enfermer l’invention. On oubliera volontiers les secondes, mais on rivalisera de génie pour donner vie aux premières, à cette femme improbable, un peu oiseau, un peu cheval, un peu poisson, qui ouvre l’art poétique d’Horace. Vasari, qui fait de l’art des grotesques un exercice virtuose où le génie peut donner sa vraie mesure, participe de ce renversement. Dans le chapitre qu’il consacre à la vie de Giovanni da Udine, peintre qui a voué tout son art à ce genre d’ornementation, auteur, avec Raphaël lui-même, des décors de la Farnésine ou du Palais Madame, Vasari prononce un éloge enthousiaste de la fantaisie, de la diversité et de la grâce de la décoration des grotesques. Cette irrévérence envers Vitruve, et plus encore envers l’art poétique d’Horace, référence canonique des théories académiques, peut étonner, en un siècle où les textes anciens sont, dans l’esprit des humanistes, paroles d’évangile, ou peu s’en faut. A quelles secrètes raisons obéit la soudaine promotion des grotesques parmi les modernes ?
En un temps où les Académies commencent de dicter aux artistes les règles de leur art (2), les grotesques entreprennent avec insolence de ne reconnaître d’autre règle que le refus de toute règle. En ce domaine, la « bonne manière » réside seulement dans la richesse et la diversité des inventions, le génie de l’artiste rivalisant non par l’imitation des produits de la nature, mais avec la nature elle-même, avec son inépuisable fécondité qu’aucune aberration, hybride ou monstruosité, ne réussit à contenir : « Les artistes représentaient dans les grotesques des difformités monstrueuses nées du caprice de la nature ou de la fantaisie extravagante de leur imagination ; ils inventaient ces formes en dehors de toute règle. » Puisqu’aucune règle ne semble limiter la prolifération du règne végétal comme du règne animal, les inventions de l’art qui miment, dans l’ordre du simulacre et de l’imaginaire (aegri somnia, écrivait Horace, « les songes d’un esprit malade »), ce que la création divine enfante dans l’ordre du réel, ne se plieront pas davantage à la contrainte de la règle. Cet art du pur arbitraire prétend même s’affranchir des lois générales que semble respecter la nature elle-même : sur les frises des grotesques, il est licite de « suspendre à un fil très fin un poids qu’il ne pourrait supporter », contredisant ainsi les lois de l’équilibre et de la pesanteur, ou bien de mêler le règne végétal avec le règne animal (« transformer les pattes d’un cheval en feuillages ») et le règne animal avec le genre humain (« ou les jambes d’un homme en pattes de grue »).
Il est possible de discerner, dans ce dérèglement systématique mis en avant par le maniériste Vasari, l’image inversée des règles de la perspective formulées plus d’un siècle plus tôt par Alberti, et données pour architecture fondamentale, ou « construction légitime », de la composition du tableau chez les modernes. Au livre I du De Pictura de 1435, Leon Battista Alberti invite le peintre à considérer le tableau comme une fenêtre, c'est-à-dire une ouverture sur une vue qui paraît dans le cadre rectangulaire de l’embrasure : « Je trace d’abord sur la surface à peindre un quadrilatère de la grandeur que je veux, fait d’angles droits, et qui est pour moi une fenêtre ouverte par laquelle on puisse regarder l’historia » (I, 19). Le peintre de grotesques suit une démarche exactement inverse : il ne saurait en effet se soumettre à la limitation du cadre, puisqu’il se situe d’emblée dans le cadre lui-même, et par conséquent en dehors du tableau. Dans la décoration murale comme sur les tapisseries, la frise des grotesques entoure la composition centrale, elle court encore dans le tableau lui-même, dès la fin du quinzième siècle, par exemple dans l’art d’un Pinturrichio, sur les pilastres et les architraves des architectures antiques que les peintres renaissants introduisent dans leurs compositions, envahissant toutes les surfaces vides qui se prêtent au jeu de la décoration. Sa prolifération est anarchique, et l’on voit mal comment il pourrait en être autrement : on aura beau encadrer le cadre lui-même, il faudra bien en venir, au terme de la série, à un cadre que rien n’encadre, que nulle règle ne saurait contenir. Quant au repère orthonormé du rectangle de la représentation, il ne saurait davantage refouler l’indiscipline des grotesques qui se sont affranchis de cette limite post quem, à partir de laquelle seulement commencent leurs acrobaties et singeries. Quant à l’historia, selon Alberti « œuvre majeure du peintre, amplissimum pictoris opus, II, § 33, ou œuvre suprême, summum opus, III, § 60 », qui est l’art de composer la scène sur le théâtre du tableau, l’artiste de grotesques n’a pas à s’en soucier : il ne prétend ni raconter une « histoire » ni représenter une action cohérente et se plaît seulement à enchaîner les figures par libre association et selon son entière fantaisie, sautant du coq à l’âne dans un pêle-mêle qui semble défier toute logique. Revenons à Alberti : la construction légitime demande encore qu’on choisisse un point de vue, qu’on situera de préférence au centre, depuis lequel on trace la ligne d’horizon et vers lequel convergent, « presque jusqu’à une distance infinie, usque ad infinitam distantiam » les lignes des « quantités transversales ». Il n’est pas de centre en revanche pour le libre déploiement des grotesques, pas de point d’Archimède qui puisse donner une assise sûre à leurs fantasques évolutions. Le motif ornemental se continue en se renouvelant, l’arabesque sans fin du rinceau fournissant à l’imagination un support toujours changeant pour y loger de nouvelles chimères. A l’inverse de la perspective qui prend appui sur le regard central d’un unique spectateur, à la façon du décor illusionniste qui détermine au théâtre, dès le début du XVIe siècle, le point de vue et l’horizon en relation avec la loge du prince, les grotesques supposent un regard errant qui va de scène en scène sans trouver le lieu de son repos, une curiosité qui se plaît au jeu de l’innovation sans fin. Et tandis que la composition perspective dispose ses figures en vue d’un spectateur central qui monopolise le regard, vers lequel converge l’attention, les grotesques se livrent à des exercices de voltige, se poursuivent, se menacent, se combattent ou s’enlacent sans accorder le moindre intérêt au regard qui les voit. Emancipés de la monarchie du point de vue, ils ne s’occupent que d’eux-mêmes et gambadent librement dans un labyrinthe végétal ou dans des architectures aériennes qui font un microcosme auquel nous n’avons pas accès, un monde à part sans relation avec le nôtre. En outre, la calligraphie grotesque se dessine sur un fond plat de couleur uniforme, refusant ainsi la scénographie perspective qui creuse dans le tableau la dimension virtuelle de la profondeur. « La grottesque » (Chastel baptisait ainsi cet art pour le distinguer du genre prisé des romantiques) est une arabesque sans queue ni tête, réfractaire absolument à la normalisation de la géométrie perspective : « Le domaine des grottesques, écrivait l’historien d’art, est assez exactement l’antithèse de la représentation, dont les normes étaient définies par la vision "perspective" de l’espace, et la distinction, la caractérisation des types » (Morel 87). Dans cet espace de nulle part où résident le grotesque, les genres se mêlent dans un jeu de perpétuelle métamorphose, et toutes les extravagances sont permises. Vision décentrée, déstabilisée, qui a littéralement perdu le nord et envahit toute surface libre en diffusant indifféremment dans toutes les directions.
L’art des grotesques, qui connaît une extraordinaire fortune au début du XVIe siècle jusque vers 1580, c'est-à-dire en un âge où règne ce style qu’on a baptisé « maniériste », serait ainsi le renversement à la fois insolent et excentrique, du dogmatisme perspectif qui définit à la renaissance, et pour des siècles, l’espace de la représentation. Les monstres de la marge renversent la toute-puissance du point de vue central, consacré par la « construction légitime » dont Alberti avait défini le cadre géométrique. On le vérifiera sur le Triptyque de la Tentation, réalisé par Jérôme Bosch, sans doute dans les années 1505-1506, et qu’on conserve aujourd’hui au musée de Lisbonne. Ce très célèbre ensemble de trois panneaux a souvent été interprété comme la survivance d’un archaïsme médiéval qu’on imagine volontiers horrifié par le démoniaque. Il n’en est rien et Bosch, contemporain de Léonard, est un peintre moderne qui participe puissamment à la crise que traverse son art en ce début du XVIe siècle. La tentation qui accable Antoine est en premier lieu une leçon de perspective, leçon il est vrai dévoyée, diaboliquement pervertie par la composition de ce paysage de cauchemar, et surtout par l’entrée en scène d’une cohorte de monstres drolatiques qui assiègent la prière du saint, et effectuent dans les marges grimaces et singeries. Sans doute la hantise de l’hérésie et la proximité du diable ne sont-elles pas étrangères à cette fantasmagorie, mais le peintre fait preuve ici d’une verve et d’un humour qui tempèrent l’expression de l’épouvante. Tout le tableau peut être lu comme une parodie de l’ordre institué par la quadrature de la construction légitime, le renversement bouffon du centralisme perspectif qui régnait en monarque depuis un siècle sur la vision du peintre. Au centre du tableau, saint Antoine est agenouillé, mais il faudrait plutôt dire affalé, devant un parapet, escorté à sa gauche par une courtisane, à sa droite par un grylle, une tête directement greffée sur deux jambes et coiffée d’un turban noir, qui le considère avec attention et en lequel la tradition reconnaît un autoportrait. Autour d’eux se multiplient les scènes horrifiques et saugrenues, telles ce qui semble bien être une parodie infernale du sacrement de la communion, un évêque mitré de serpents donnant les saintes espèces à un ménestrel dont le visage se prolonge en hure de sanglier. Antoine se trouve devant un édifice en ruine, vestige précaire de ce qui fut une église : « Or tournons les yeux par tout, tout croule autour de nous, écrira plus tard Montaigne : en tous les grands Etats, soit de Chrétienté, soit d'ailleurs, que nous connaissons, regardez y, vous y trouverez une évidente menace de changement et de ruine ». Dans le chœur délabré, le Christ est là, debout, bénissant le vrai calice qui peut seul nous sauver des fausses communions, et montrant de la main le crucifix devant lequel est allumé un cierge. Cette architecture vacillante s’élève elle-même sur une estrade incertaine qui surmonte une eau marécageuse où pataugent, affairés à leurs stupides besognes, des monstres hétéroclites. L’ensemble de ce théâtre obéit approximativement aux lois de la perspective, mais une perspective sournoisement biaisée, et sur le point de perdre l’équilibre. Au centre s’élèvent un Christ inquiet, qui contemple avec effarement la sarabande qui règne sur le monde, et la croix, minuscule et lointaine, repère fragile d’un ordre menacé, allusion infime aux coordonnées orthonormées de la construction albertienne, à l’ordre d’un point de vue qui ne doutait pas de lui-même. Pour que ce monde retrouve la foi et la paix, pour qu’il s’appuie de nouveau sur un sol ferme et constant, il faudrait que le regard se fixe sur ce pôle sans lequel il n’est pas d’orientation pour la créature révoltée de son dieu. Quel est alors l’objet véritable de la tentation ? Ces monstres sont hideux, rien de séduisant en eux qui puisse tenter notre désir. Il suffit de les rapporter à la figure archétypale de la tentation, l’Eve du jardin d’Eden dont les peintres, tels Cranach, évoquent alors la très voluptueuse silhouette, pour discerner le paradoxe de cette « tentation », qu’il faudrait bien plutôt identifier comme une scène d’épouvante. On peut dire de Bosch qu’il est véritablement l’inventeur cette scène, bientôt reprise par Manuel Deutsch et surtout par Grünewald, mais qui avait été ignorée par les artistes des siècles précédents. On sait par ailleurs que le thème est voué à une grande fortune et donnera lieu, tout au cours du Cinquecento, à de nombreuses variations. Pourquoi ce succès ? La passion de saint Antoine montre le dévoiement d’un regard saint, autrefois assuré sur le centre stable de la croix, converti en Christ et affermi en sa foi, aujourd’hui diverti par la gesticulation drolatique des monstres forcenés. Antoine en effet ne tourne pas son regard vers l’autel, il se détourne du Fils de Dieu qui lui montre le centre, son regard cède à l’attraction de la marge, il se laisse séduire par les formes aberrantes que la droite raison refoule aux frontières. Que regarde Antoine ? On ne sait trop, le grylle peut-être, c'est-à-dire le peintre lui-même qui le contemple avec gravité, ou les singeries des pitres qui se pressent alentour, ou bien encore nous-mêmes qui regardons le tableau, qui assistons au naufrage immense du monde ancien tandis que se répand de toutes parts la débâcle des modernes, sans nul repère pour indiquer désormais le chemin du salut. Notre perspective chavire, l’espace se désoriente et se renverse insidieusement. Le sanctuaire où l’on célèbre l’eucharistie est devenu une nef des fous emportée par l’universelle déraison. C’est depuis ce mal que prolifèrent les grotesques, dans un monde chancelant qui inverse l’ordre divin, chaos dont le centre est nulle part et la marge partout.
On comprend mieux alors la généalogie des monstres bizarres imaginés par le peintre. Ils proviennent des marges des manuscrits médiévaux, où trottait déjà le grylle agile, où sautillaient le sphinx et la chimère, où s’affrontaient la sirène et le centaure. L’inversion perspective de la tentation déplace le regard du centre vers la périphérie. Dans les lisières du texte sacré, pieusement calligraphié sur la page, les grotesques conduisaient depuis longtemps un charivari burlesque, et donnaient libre cours aux licences du carnaval, à l’extravagance de la fête des fous. Le regard savant et attentif de Baltrusaitis a su montrer combien les inventions tératologiques du maître de Bois-le-Duc prolongent les fantaisies bouffonnes qui encadrent le texte sur les manuscrits enluminés du moyen âge. On se souvient que le chapitre de Vasari qui présentait l’art des grotesques faisait suite à une évocation des décors peints dressés les jours de fête. La ville en fête transfigure la scène quotidienne, elle met en scène une utopie provisoire que refoule l’ordinaire. Comme on le voit sur le tableau de Bruegel, qui se réclamait explicitement de l’art de Jérôme Bosch, Le combat de carnaval et carême (1559), les fêtes du carnaval envahissent la place du village et miment une sorte de parodie du tournoi chevaleresque, Carnaval obèse juché sur une barrique, et qui brandit une broche en guise de lance, affrontant un Carême phtisique armé d’une pelle de boulanger et traîné par deux commères sur une planche munie de quatre roues. Le jour de la fête, les grotesques investissent le centre et règnent sur le monde à l’envers. Mikhaïl Bakhtine a longuement développé ce thème dans son célèbre ouvrage sur Rabelais (1970 pour la traduction française), et plus récemment Michael Camille (1992) a su discerner, dans les marges enluminées du manuscrit médiéval, le même renversement obscène de la scène sacrée, les épisodes disséminés d’une farce subversive qui se permet toutes les transgressions, et ose même parfois ce qui apparaît à nos yeux comme une véritable profanation. C’est ainsi que dans ce manuscrit du second quart du XIVe siècle, l’adoration des Mages qui orne la lettre capitale se redouble au registre inférieur dans la farandole de trois singes qui semblent parodier la pieuse image qui les surmonte. Les scènes érotiques ou scatologiques sont innombrables, la paresse ou la cupidité de l’Eglise est férocement dénoncée, des nains difformes et phalliques se contorsionnent dans les bordures comme grimacent les gargouilles à l’extérieur de la cathédrale, des infirmes, des lépreux et des mendiants, que les villes refoulaient hors les murs, claudiquent dans les rinceaux qui entourent le texte, des scènes paillardes, ou des illustrations de proverbes populaires, ornent les miséricordes, ces sièges discrets sculptés dans les stalles et qui soulageaient la fatigue des moines pendant les longs offices, art véritablement « marginal », sinon « postérieur », puisqu’il était fait pour qu’on s’assoie littéralement sur lui. Dans son Apologie de l’abbé Guillaume, saint Bernard, vers le milieu du douzième siècle, avait fermement condamné « ces monstres ridicules dont la beauté difforme et la belle difformité frappent d’étonnement, ces singes immondes, ces lions féroces, ces monstrueux centaures, ces êtres à demi humain, ces tigres tachetés, ces soldats qui se battent, ces chasseurs qui sonnent de la trompe » (Camille 86). Bosch s’en est évidemment inspiré, et le grylle de la Tentation de Lisbonne courait déjà dans les marges des manuscrits médiévaux. Il est vrai que ces figures prolongent une veine bouffonne qui emprunte ses modèles à la plus haute antiquité, qu’il faut par exemple remonter, pour trouver le véritable ancêtre du grylle, jusqu’à la figure de Baubô qui, par ses singeries, réussit à dérider la tristesse endeuillée de Déméter, et par delà la Grèce, jusqu’à l’Egypte ancienne, au dieu Bès, un nabot hilare et difforme qui chasse les idées noires et déclenche le rire. Cependant, à trop suivre le fil de ce labyrinthe, ne risque-t-on pas de perdre de vue ce qu’il y a de spécifique et de propre dans l’art de « la grottesque » ? Et faut-il mettre cette décoration, qui n’appartient en toute rigueur qu’au maniérisme du XVIe siècle, sur le compte de l’éternelle licence de l’imagination des hommes ?
S’il est bien vrai que les monstres de Bosch doivent beaucoup aux facéties des créatures difformes qui gambadent dans les marges des manuscrits du moyen âge, ce n’est pas en revanche à ce modèle que se réfère Vasari. Bien au contraire, il souligne combien la décoration des grotesques appartient au style des modernes, dont il fait le constant éloge, l’opposant invariablement au style gothique, selon lui barbare, dont relève évidemment l’enluminure médiévale. La grottesque est un art noble qui se réclame directement du modèle antique, et ne veut rien savoir des possibles ressemblances qui l’apparentent aux extravagances des enlumineurs de l’ère précédente. Le moyen âge tardif désignait ces figures de fantaisies sous le nom de babuini, « singeries », que l’on rencontre pour la première fois dans un document de 1344, et que Chaucer, à la fin du XIVe siècle, nommait « compasinge » (singe « compassé », c'est-à-dire mesuré par le dessin qui le définit) ou « babewynes » (Camille 20). Il faut attendre la fin du XVe siècle, c'est-à-dire la transition de l’âge d’or de la renaissance au temps de sa crise, pour que le mot « grotesque » fasse son apparition. Il naît en effet de la découverte fascinée, par les peintres de la Rome de Sixte IV, appelés dans la ville sainte pour peindre la chapelle qu’on nommera plus tard « Sixtine », des somptueuses décorations qui ornaient les murs de la Domus Aurea, l’immense palais, proche du Colisée, que fit jadis construire l’empereur Néron et dont les voûtes souterraines, jusque là ignorées et hermétiquement closes, avaient conservé intactes par delà les siècles la grâce de leurs dessins et la fraîcheur de leurs couleurs. « Alors qu’on faisait des fouilles de Saint-Pierre-aux-Liens, raconte Vasari dans la vie de Giovanni da Udine, dans les ruines et les vestiges antiques du palais de Titus [il s’agit en vérité de celui de Néron] pour y trouver des statues, on découvrit des salles souterraines entièrement recouvertes de grotesques, de petites figures et de scènes variées, avec des ornements de stucs en bas des parois. Conviés à les voir, Raphaël s’y rendit en compagnie de Giovanni da Udine et tous deux restèrent stupéfaits de la fraîcheur, de la beauté et de la qualité de ces œuvres. Il leur paraissait merveilleux qu’elles se soient conservées si longtemps : en fait, ce n’était pas très étonnant puisqu’elles n’avaient pas été au contact de l’air qui, avec le temps, consume habituellement toute chose, en raison des variations de l’atmosphère au fil des saisons. » Découverte saisissante puisqu’elle réalise en quelque sorte le rêve de la renaissance : être transporté directement, et comme par magie, dans le passé de l’antique Rome, retrouver d’un coup l’inspiration de l’art véritable en faisant le saut sur cette longue période de ténèbres que fut la barbarie gothique. Vasari donne alors la véritable étymologie de cet art ressuscité : « Ces grotesques sont ainsi appelées parce qu’on les avait trouvées dans des grottes ». Tout se passe comme si l’inculture médiévale avait refoulé dans les marges souterraines, dans les cavernes de l’oubli, l’art magnifique de la Ville Eternelle, du temps qu’elle régnait sur le monde. La mise à jour de ce qu’on avait enseveli dans l’ombre, qui accomplit pleinement le rêve et l’idéal de la Rinascità, a la valeur d’un véritable retour du refoulé : la libre invention du paganisme, l’authentique génie du peuple romain, réprimés par l’ignorance et la superstition de l’Eglise médiévale, ressuscités par la culture humaniste, sortent enfin de la nuit où on les avait ensevelis pendant des siècles. Pourtant, en ce début du XVIe siècle, la renaissance des grotesques n’est pas sans susciter quelque appréhension : cet art en effet méconnaît la leçon chrétienne, et il se pourrait bien que ces décorations aient conservé quelque chose des transgressions sacrilèges auxquelles s’abandonnaient sans retenue les fêtes de la Rome impériale, et tout particulièrement celle qu’on célébrait à la cour de Néron, dans la Domus Aurea. On connaissait bien sur ce sujet les témoignages antiques, ceux par exemple de Tacite ou de Suétone. Ce mort qui ressuscite, qui sort soudain de la nuit où le règne du Christ l’avait plongé depuis des siècles, est un spectre vaguement inquiétant, le revenant d’un autre monde. Vasari consacre un chapitre à un peintre de Feltre, dont l’identification est aujourd’hui encore problématique, un « tempérament mélancolique », « cerveau fantaisiste et bizarre », passionné de « la manière d’enrouler des rinceaux à l’antique », et qui passa une partie considérable de son existence enterré dans les ruines pour dessiner les grotesques qui les décoraient. C’est la raison pour laquelle nous ne le connaissons que par le surnom que lui avaient donné ses camarades, « il Morto da Feltre » (VI, 223 sq), le « Mort » de Feltre. Il y a en effet quelque chose de morbide dans l’attraction que ces compositions fantastiques, issues des songes d’un malade, aegri somnia, exercent sur les esprits déréglés. Lorsque le 14 janvier 1506 on exhume, précisément au-dessus de la Maison Dorée, et sous les yeux de Michel-Ange appelé pour l’occasion, le groupe hellénistique de Laocoon et ses enfants, le châtiment inhumain du prêtre d’Apollon surgit des profondeurs de la terre comme le retour à la conscience d’une faute très ancienne : image d’un supplice atroce ordonné par un dieu sans amour, étranger encore à l’enseignement des Evangiles. Les serpents qui se lovent autour du réprouvé façonnent la figure serpentine si souvent recommencée par les artistes maniéristes. On en retrouve le souvenir dans les arabesques, par courbes et contrecourbes, où se logent les acrobaties bouffonnes des grotesques. Cet art ancien, miraculeusement ressuscité, ne sait rien des règles académiques de la convenance ni de la bienséance et menace, par sa licence et sa sauvagerie, par son imagination débridée, le respect que l’on doit à la norme, à l’ordre des raisons et à la distinction des genres. Il y a dans la grottesque quelque chose de monstrueux, et la fascination qu’elle inspire n’est pas sans rapport avec la curiosité perverse qui se repaît de l’exhibition des monstres. C’est sans doute la raison pour laquelle Benvenuto Cellini, dans le récit qu’il fait de sa vie (vers 1560), désapprouve ce nom de « grotesque » et propose de le remplacer par « monstre » : « Les grotesques ont été ainsi nommé par les modernes parce que les chercheurs d’antiques ont trouvé ce type de décorations dans les cavernes de Rome qui servaient autrefois de chambres, d’étuves, de cabinets de travail, etc. Ces lieux étaient devenus caverneux par suite de l’exhaussement progressif du sol environnant, et comme on désigne à Rome ces excavations sous le nom de grottes, les ornements qui les décorent ont pris le nom de grotesque. Cette appellation ne leur convient pas car, de même que les anciens se plaisaient à composer des monstres en combinant les formes de la chèvre, de la vache et du cheval, et appelaient monstres le résultat de ces mélanges, de même ils formaient avec leur feuillage des sortes de monstres ; c’est donc le nom de monstres qu’il faut donner à ces ornements, et non celui de grotesques » (I, 128-129). De ces monstres naît un art monstrueux, dont un bon chrétien doit savoir se prémunir. En 1582, le cardinal Gabriele Paleotti, ardent militant de la normalisation des images que la Contre-réforme exige, condamne cet art extravagant et débauché. Si le grotesque provient de la grotte, c’est, selon le prélat, parce que les Romains croyaient que « ces grottes privées de lumière et pleines d’horreur regorgeaient de fantômes, de monstres et de choses difformes, et plus encore que ces divinités se transformaient en fauves, en serpents et en d’autres monstres. C’est à partir de là qu’ils représentèrent ces dieux qu’ils appelèrent lemures sive larvae et qui inspirent la terreur avec leur apparence inhabituelle » (Morel 120).
Rien cependant, dans les pages que Vasari consacre à ces ornements mis récemment à la mode, ne laisse transparaître l’horreur sacrée qui environne la figure du monstre ou du réprouvé. Certes, les monstres fantastiques qui angoissent la prière de saint Antoine, sur le triptyque de Bosch, ont quelque rapport avec la damnation : ils tentent la sainteté en l’invitant à la délinquance, à la dissidence de l’hérésie, et leur parenté avec les « babouineries » qui inversent dans la marge la scène de l’Ecriture par l’obscénité de l’enluminure, trahit leur nature infernale. Mais Vasari se détourne délibérément de cette verve subversive, et la culture humaniste avec lui, de même qu’il demeure indifférent aux monstruosités latentes qui se conçoivent dans le labyrinthe des grotesques, et qui avaient pourtant frappé l’esprit de son contemporain Cellini. Bien au contraire, Vasari est surtout sensible au charme, à l’élégance, à la délicatesse du dessin, à la fraîcheur de l’invention, c'est-à-dire à l’innocence d’une imagination rêveuse et aérienne qu’aucune culpabilité ne vient lester. Quand il évoque l’art merveilleux de Giovanni da Udine, selon lui le maître du genre, il décrit un paradis verdoyant, une nature en fête en laquelle le péché ne s’est pas encore insinué : « Giovanni imagina des tonnelles de roseau en trompe-l’œil, où grimpaient des vignes chargées de grappes, des clématites, des jasmins, des rosiers, avec toutes sortes d’animaux et d’oiseaux » (IX, 343). Aux yeux du décorateur maniériste, les monstres grotesques sont jeux de la nature, ludi naturae, ou de l’imagination, inventions capricieuses d’une verve innocente. S’ils avaient senti le soufre, ils n’auraient pas envahi, comme ils l’ont fait sous la protection de Léon X, les Loges du palais pontifical. En interprétant de cette façon l’art des grotesques, Vasari est sans doute plus proche de l’esprit qui conçut la peinture ornementale des fresques antiques ; il est encore le contemporain d’une culture savante et raffinée, culture de cour dont Baldassare Castiglione a défini l’idéal courtisan (Il libro del Cortegiano est publié en 1528), volontiers attirée par l’ésotérique et l’étrange, et que la discipline du concile de Trente n’a pas encore mise au pas. La sprezzatura, cette élégante désinvolture qui confère aux formes les plus apprêtées de la politesse le charme du naturel, est la vertu suprême de l’homme de cour ; elle n’est pas sans rapport avec la virtuosité dont le peintre de grotesques doit faire preuve, ce far presto, sûreté du geste et rapidité de l’invention, dont Vasari, parfaite incarnation du peintre courtisan, se flatte sans retenue dans l’autobiographie qui conclut son ouvrage. La beauté élégante des grotesques est l’œuvre d’un génie heureux, continuellement inspiré, sans rien qui sente le labeur, « sans rien en lui qui pèse ou qui pose ». Cet art réussit la gageure d’une éblouissante et constante improvisation. Il faut, pour y exceller, de la hardiesse (fierezza), un génie du trait (disegno), de la vivacité (vivacità), et un beau style plein de verve (bella maniera) (Proemio, « La peinture », chap. XI, I, 179 ; éd. italienne p. 85). Les grotesques, ajoute encore Vasari, doivent être animés par une « expression vigoureuse qui révèle l’art sans sentir l’effort, une gagliardezza che mostri arte e non stento » (éd. iltal. 84). Ce sont là les valeurs d’une culture aristocratique, qui se plaît à souligner l’excellence des élites, et son aisance dans l’exploit. Loin de se rapprocher de l’imagination médiévale honnie par la culture humaniste, l’art de la « grottesque » s’apparente à la préciosité cultivée par le second maniérisme, à l’esthétique de la « bella maniera », à l’image des poèmes amphigouriques d’un Pietro Bembo, la figure serpentine répondant dans les arts figuratifs au jeu du chiasme et de l’oxymore qui font alors les délices des rhéteurs et des poètes. Les numéros de haute voltige qu’effectuent, de branche en branche, les créatures hybrides qui peuplent le royaume des grotesques, sont à l’image du funambulisme de l’artiste qui s’abandonne sans réserve aux risques de l’improvisation. Fantaisie délibérément gratuite, et qui se fait un titre de gloire de son rigoureux arbitraire, les grotesques sont sans commune mesure avec l’inversion carnavalesque qui renverse dans la marge le pouvoir qui règne au centre. Les grotesques de la renaissance italienne sont presque toujours dépourvus de valeur parodique, et il faut toute l’érudition d’un Philippe Morel, qui a consacré à cette question une belle et savante étude, pour dénicher dans la loggia du castello di Levante de Lagnasco, près de Saluzzo, une sorte de contrefaçon bouffonne du motif médiéval de l’arbre de Jessé : du ventre d’un satyre endormi surgit, tel un sexe monstrueux, un arbre sec dont les ramures en volutes supportent tout un échantillonnage de monstres lilliputiens (Morel 97-98). Il s’agit pourtant d’une vague allusion, d’ailleurs exceptionnelle, plutôt que d’une dérision déclarée. Morel remarque par ailleurs que le grylle, si présent dans les enfers de Bosch et qui hante, de sa gesticulation obscène et goguenarde, les marges des manuscrits, figure démoniaque du péché, de la bestialité qui menace l’homme, est remarquablement absent du décor des grotesques (Morel, 17, 18 et 84). En règle générale, rien d’insolent ni de subversif dans cet art, rien de plus courtisan même que cet exercice de style destiné à éblouir les cours et orner les palais des princes. Il ne s’agit en somme que de jouer, en ce sens toutefois où l’on a pu dire de l’art qu’il est un jeu sérieux, de déployer la finalité sans fin d’une calligraphie virtuose, à l’image de ces jeux subtils destinés à tromper l’ennui des cours, à la faveur desquels le parfait homme de cour était mis en demeure de briller de tout son génie. Aussi a-t-on rapproché avec raison la peinture de grotesques du sous-titre d’un ouvrage que publie à Venise, en 1552, Anton Francesco Doni (1513-1574), religieux défroqué à la verve intarissable et fantaisiste, proche de Vasari par l’admiration sans réserve qu’il vouait à Michel-Ange. Son livre, intitulé La Zucca, est ainsi sous-titré : « Tableau, ou registre des bavardages, litanies, broderies, chimères, châteaux en Espagne, philosophies, pensées et tours d’esprit, sornettes, sentences, mensonges, controverses, lubies, palabres, caprices, inepties, parlotes à tort et à travers, mélanges, fantaisies, nouvelles, caquetages, paraboles, bêtises, proverbes, bons mots, humeurs et autres pirouettes et histoires (Pinelli, La Belle manière, 215). Encyclopédie ludique des caprices les plus extravagants enfantés par l’imagination, la grottesque ne prétend qu’à plaire, elle orne et agrémente le luxe du décor princier, elle embellit la mise en scène de l’ordre établi et se garde bien d’en dénoncer l’injustice.
On s’interrogera pourtant sur cet assagissement du monstre sur la scène de la représentation. Le sociologue soulignera sans doute l’idéal moderne de la civilité, la domestication des pulsions qui façonne la « société de cour », contrôle les affects et favorise l’établissement de l’absolutisme monarchique. Il s’agit pourtant, selon ce schéma de lecture, d’une simple répression qui s’expose fatalement au retour du refoulé, et Norbert Elias n’hésite pas à reconnaître, dans la violence révolutionnaire, le renversement violent de la contrainte, devenue trop évidemment formelle et arbitraire, que le cérémonial de cour imposait aux passions. En ce sens, les monstres narquois qui font régner, dans les marges de l’ordre médiéval, les lois d’un monde renversé, chassé quelque temps par le cérémonial de cour, devraient tôt ou tard revenir sur le devant de la scène et prendre leur revanche. Une telle lecture n’est sans doute pas impossible, et il n’est pas interdit de considérer la caricature politique, qu'on voit apparaître dès le XVIIe siècle dans les dessins du Bernin et qui prend son essor en Angleterre dans les milieux contre-révolutionnaires, ou l’apologie du grotesque revendiqué par les romantiques (préface de Cromwell), ou bien enfin, plus proche de nous, ce grotesque de l’absurde qu’affichent les pitres désespérés, bégayant un discours devenu impossible, obsédés par l’imminence du néant, de Ionesco ou de Beckett, comme les héritiers lointains du renversement carnavalesque auquel un moyen âge à la vérité surtout mythique (car l’ordre médiéval était beaucoup moins accueillant aux renversements de Dame Folie qu’on – Foucault à la suite de Bakhtine – a bien voulu le croire) donnait droit de cité, ne lui réservant cependant que les marges de son théâtre. Je souhaiterais pourtant, en conclusion, suggérer une autre voie.
Il se pourrait bien en effet que la disparition des grotesques ne soit pas l’effet nécessairement provisoire du refoulement, mais plutôt l’irréversible conséquence d’une véritable métamorphose. Toute profanation est évidemment solidaire du sacré qu’elle provoque, et dont elle ne présente que l’image inversée. Le sacrilège est le symptôme d'une insurmontable dépendance au sacré, et non la prouesse d’une émancipation véritable. La subversion marginale des Saintes Ecritures, qu’on croit reconnaître non sans complaisance dans l’enluminure médiévale (Camille a montré de façon convaincante le conformisme de cette prétendue insolence) suppose du moins qu’un espace, quelque part, soit consacré aux Saintes Ecritures. La révolution des grotesques n’a de sens que s’il est au centre un dieu dont on puisse renverser le trône, un Christ contre lequel on puisse dresser l’adversité d’un Antéchrist. L’art de Jérôme Bosch n’est sans doute pas étranger à cette mécanique de l’inversion, et c’est pourquoi il peut sans doute recueillir les monstres drolatiques de l’imagination médiévale, tout en les intégrant dans la crise religieuse et politique qui inaugure les temps modernes. Giorgio Vasari, Arétin, avocat talentueux de l’art virtuose de la grottesque, est citoyen d’un autre monde, celui de Machiavel, Florentin, qui le précède de près de deux générations. L'artiste partage avec l’auteur du Prince l'idée que l’histoire est le combat des hommes entre eux, plutôt que l’accomplissement des desseins de la divine Providence. L’homme est seul maître de son destin, dans la mesure du moins où il échappe aux coups de Fortune, sa dignité est à la hauteur du génie de son œuvre, dont il est l’unique auteur et le seul responsable, et que le peintre conçoit comme une sorte de prouesse semblable, dans l’espace virtuel de la représentation, aux exploits que les chevaliers n’accomplissent plus désormais que dans les romans, la guerre moderne ne laissant plus guère de place au rituel codifié du tournoi. La sécularisation de l’artiste, devenu un personnage de la cour enrôlé pour la mise en scène du pouvoir politique, en l’aliénant au prince, le libère des contraintes du dogme catholique, libération bien entendu relative et à laquelle la remise en ordre tridentine mettra bientôt fin. L’épisode maniériste, qui connaît une exceptionnelle diffusion du décor grotesque, résulte de cet affranchissement de l’invention qui abandonne l’artiste, dans la mesure évidemment où il se soumet à l’ordre politique, aux caprices de son propre génie. Il faut alors concevoir le triomphe de la nouvelle ornementation, librement inspirée du modèle antique, comme la pure expression d’un art livré à lui-même, une sorte d’art pour l’art avant la lettre, une « performance » qui permet au peintre de faire étalage de sa virtuosité. Le flou de la commande (on ne s’étonnera jamais assez de la liberté concédée à Michel-Ange par le pape Jules II pour la décoration de la voûte de la Sixtine) accorde à l’œuvre une certaine liberté dans la définition de son contenu, et met l’accent sur l’élégance de la forme, sur la verve du style plutôt que sur le mimétisme de la représentation, sur la « manière » plutôt que sur l’expression. Le maniérisme est sans doute dans l’histoire cet intervalle où le métier du peintre devient à lui-même sa propre fin. On s’en convaincra en considérant l’œuvre assez exceptionnelle de Lancelot Blondel (1498-1561), un artiste brugeois, en un temps où la cité marchande autrefois prospère est en plein déclin, ornemaniste auquel on confiait la décoration des entrées princières, auteur en 1545 d’un Saint Luc peignant la Vierge, que conserve le musée de Bruges. L’allusion à l’évangéliste est ici un simple prétexte pour montrer en médaillon le peintre et son modèle, pour mettre en abîme le métier du peintre. Cette scène toutefois disparaît dans une extraordinaire architecture dorée et ornée de grotesques antiques, morceau de bravoure par lequel l’artiste entend montrer l’excellence de son métier. Tout se passe comme si l’exubérance du cadre ornemental prenait la première place, tandis que la scène pourtant figurée an centre, et ici explicitement rapportée au métier du peintre, n’était que la cause occasionnelle de la fabrique du chef-d’œuvre. On comprend alors que la prolifération du décor des grotesques est l’effet secondaire du vide béant dans le centre, la crise que connaît alors l’iconographie religieuse déstabilisant l’espace de la représentation et abandonnant le peintre au jeu gratuit de la pure virtuosité. S’il n’est plus donné au peintre un dieu pour le représenter, il ne reste à son art que la finalité sans fin de l’arabesque virtuose. On comprend encore le tempérament mélancolique qui accable et inspire à la fois le peintre maniériste : la condition de l’émancipation de son génie, les fantasmagories qui hantent désormais son imagination, sont la contrepartie d’une lacune centrale, le vide fondateur creusé au centre du tableau, au lieu même où Alberti situait autrefois le foyer convergent de la construction perspective, la zone laissée par le dieu qui s’est exilé pour toujours de l’espace de la représentation. La mélancolie maniériste ne se console pas de ce deuil de la vérité et du sens, et le jeu infini, la prolifération illimitée de la grottesque ne suffit plus à combler le néant, ni l’ennui qui s’en nourrit.
Montaigne commence par ces mots le chapitre XXVIII du livre I des Essais, intitulé De l’amitié : « Considérant la conduite de la besogne d'un peintre que j'ai, il m'a pris envie de l'ensuivre. Il choisit le plus bel endroit et milieu de chaque paroi, pour y loger un tableau élaboré de toute sa suffisance ; et le vide tout autour, il le remplit de crotesques : qui sont peintures fantasques, n'ayant grâce qu'en la variété et étrangeté. Que sont-ce ici aussi à la vérité que crotesques et corps monstrueux, rapiécés de divers membres, sans certaine figure, n'ayant ordre, suite, ni proportion que fortuite ? Desinit in piscem mulier formosa superne. » On reconnaît le quatrième vers de l’Art poétique d’Horace que nous avons cité en ouvrant cette conférence. De cette décoration de grotesques au château de Montaigne, il reste quelques traces, dans le cabinet surtout qui précède le cercle de la librairie où furent rédigés les Essais, peu de chose en vérité, le fragment de ce qui semble être une scène de naufrage, un homme nu et athlétique tenant une lance, quelques décorations en trompe-l’œil architectural à la manière antique, et des guirlandes de fleurs enroulées en rinceaux dans l’encadrement des scènes disparues. Des témoignages du XIXe siècle nous apprennent qu’il s’agissait d’un ex-voto pour une scène de naufrage, du jugement de Pâris, de l’incendie de Troie, d’un combat, des amours de Vénus et Mars, de Vénus pleurant Adonis et d’une Charité romaine (Alain Legros, Essais sur poutres, 119-150). Décor imité de la manière antique, et qui n’emprunte rien à l’iconographie du christianisme. L’analogie est en effet frappante entre l’écriture sans fin des Essais (III, 9, « De la vanité » : « Qui ne voit, que j'ai pris une route, par laquelle sans cesse et sans travail, j'irai autant, qu'il y aura d'encre et de papier au monde ? ») et l’arabesque illimitée de l’ornementation grotesque : le vide qui s’ouvre dans le centre porte le deuil de l’ami disparu, Etienne de la Boétie, à la mémoire duquel Montaigne consacre l’essai plus haut cité sur l’amitié. Il nous fait comprendre que le travail d’écriture est en quelque sorte le prolongement intérieur et silencieux de l’entretien réciproque qui vivifiait la parfaite correspondance, la quasi gémellité des deux amis. Le livre supplée ainsi à la merveilleuse vitalité que communiquait à Montaigne le double qui, en s’absentant, l’abandonne désormais à sa solitude. Au centre du premier livre des Essais (très exactement au chapitre 29 qui sépare les 28 premiers des 28 derniers chapitres du Livre I), Montaigne, qui conçut d’abord son œuvre comme un tombeau édifié à la mémoire de l’ami disparu, voulait publier le Discours sur la servitude volontaire, mais les calvinistes l’ont précédé, sous le titre usurpé Contr’Un, enrôlant le texte de La Boétie au service de leur mauvaise querelle : « Cet ouvrage a été depuis mis en lumière, et à mauvaise fin, par ceux qui cherchent à troubler et changer l’état de notre police ». A cette œuvre prématurément divulguée, Montaigne substituera donc vingt-neuf sonnets du même La Boétie qu’un ami commun vient de lui communiquer. C’est ainsi qu’au centre du premier livre de son ouvrage, comme au centre vide autour duquel le peintre de grotesque brode ses rêveries, s’ouvre le vide creusé par un deuil très cuisant, absence à laquelle le texte du Discours aurait pu remédier s’il n’avait été lui-même dérobé, ce qui a la valeur pour Montaigne d’une trahison posthume et comme d’une seconde mort ; pour corriger l’effet de cette seconde soustraction, Montaigne publiera donc ces vingt-neuf sonnets (leur nombre est identique au numéro du chapitre qui les accueille) qui ont conservé quelque chose du feu de la jeunesse et portent l’empreinte comme vivante de celui qui s’en est allé au royaume des morts. Ces sonnets « ont je ne sais quoi de plus vif et de plus bouillant, comme il fit en sa verte jeunesse, et échauffé d’une belle et noble ardeur que je vous dirai, Madame [il s’agit de la dédicace adressé à madame de Grammont], un jour à l’oreille. » Les sonnets qui remplacent le Discours, qui devait représenter l’ami disparu, ont un je ne sais quoi de plus vif qui s’efforce d’occuper la place du mort. Sur l’exemplaire de Bordeaux, c'est-à-dire cette édition de 1588 retrouvée à sa mort et qu’il avait enrichie de très nombreux « alongeails » (III, 9 : « Laisse Lecteur courir encore ce coup d'essai, et ce troisième alongeail, du reste des pièces de ma peinture. J'ajoute, mais je ne corrige pas »), Montaigne a rayé d’un trait de plume les sonnets de La Boétie, inscrivant en marge : « Cela se voit ailleurs », ce qui supposerait une édition publiée entretemps, et dont on n’a pourtant pas trouvé la moindre trace. Aveu sans doute que le vide central, qui fournit à la fois la source et l’occasion de la calligraphie des grotesques, est irrémédiable, et que rien ne saurait vraiment le combler. Le principe de l’écriture est cet inconsolable néant qui laisse la place libre à la variation sans fin de la « rêverie » mélancolique. Les additions, les « alongeails », qui dessinent dans la marge les excroissances d’un texte décidément démesuré font une sorte d’ornementation grotesque à l’écriture qui court au centre de la page ; et le texte lui-même se nourrissant de cette protubérance, destinée à passer au centre dans l’édition suivante, n’est qu’une sorte d’addition de grotesques, la glose paradoxale et illimitée d’une parole de vérité dont le monde est dépourvu, et qui seule pourrait mettre fin à la série jamais achevée des Essais. Les Essais tentent un autoportrait de l’artiste en reclus mélancolique, et les monstres et chimères qui courent dans les marges de l’extravagance grotesque se retrouvent encore au centre, Montaigne se découvrant, avec intérêt et curiosité, monstrueux lui-même en ce miroir : « Dernièrement que je me retirais chez moi, délibéré autant que je pourrai, ne me mêler d'autre chose, que de passer en repos, et à part, ce peu qui me reste de vie : il me semblait ne pouvoir faire plus grande faveur à mon esprit, que de le laisser en pleine oisiveté, s'entretenir soi-même, et s'arrêter et rasseoir en soi : Ce que j'espérais qu'il peut meshuy [désormais] faire plus aisément, devenu avec le temps, plus pesant, et plus mûr : Mais je trouve, qu'au rebours faisant le cheval échappé, il se donne cent fois plus de carrière à soi-même, qu'il ne prenait pour autrui : et m'enfante tant de chimères et monstres fantasques les uns sur les autres, sans ordre, et sans propos, que pour en contempler à mon aise l'ineptie et l'étrangeté, j'ai commencé de les mettre en rôle : espérant avec le temps, lui en faire honte à lui-même. » (I, 8). Espérance déçue, l’essai de soi-même progressant par la découverte de la monstruosité croissante qui nous rend étrange à nous-mêmes : « Jusques à ceste heure, tous ces miracles et événements étranges, se cachent devant moi : Je n'ay vu monstre et miracle au monde, plus exprès que moi-même : On s'apprivoise à toute étrangeté par l'usage et le temps : mais plus je me hante et me connais, plus ma difformité m'étonne : moins je m'entends en moi » (II, 11). Difformité en laquelle s’exprime « la nihilité de l’humaine condition » (II, 6), l’homme portant au cœur de lui-même, telle la lacune centrale dans le cadre de laquelle le peintre de grotesques dessine ses arabesques, un néant fondateur qu’entoure et orne l’écriture rhapsodique de Montaigne, le graffiti des Essais. Exercice bien fait pour corriger la bêtise et la présomption des esprits suffisants et pleins d’eux-mêmes, oublieux de leur néant, qui se prennent pour le centre du monde et érigent les coutumes de leur pays en lois universelles. Combien valent mieux ces sauvages (l’homme sauvage, ou homo silvaticus, est un personnage bouffon qui faisait dans la marge médiévale un contrepoint au sérieux du texte qui occupait le centre) dont les mœurs sont si merveilleusement étrangères aux nôtres, ces sauvages que nous avons honteusement trompés et cruellement massacrés, et auquel l’essai 6 du livre III (« Des coches ») accorde bien volontiers la place du centre, la place du roi ; quant aux animaux, relégués également par le pouvoir central dans la marge des grotesques, l’apologie de Raimond Sebond, qui occupe la majeure partie du livre II, leur reconnait une sagesse bien supérieure à celle de l’homme lui-même. L’Essai de Montaigne, toujours excentré et qui fait de la digression la substance même de son style, n’est ainsi lui-même qu’un immense grotesque, ouvrant à l’écriture une carrière illimitée, un jeu qui divertit efficacement son auteur du néant qui endeuille sa nature, par l’énigme inépuisable qu’il se découvre pour lui-même, et l’entraîne dans la chasse d’une vérité qui se dérobe toujours : « Et si je fais le fol, c'est à mes dépens, et sans l'intérêt de personne : Car c'est une folie, qui meurt en moi, qui n'a point de suite […] C'est une épineuse entreprise, et plus qu'il ne semble, de suivre une allure si vagabonde, que celle de notre esprit : de pénétrer les profondeurs opaques de ses replis internes : de choisir et arrêter tant de menus airs de ses agitations. Et est un amusement nouveau et extraordinaire, qui nous retire des occupations communes du monde : oui, et des plus recommandées. Il y a plusieurs années que je n'ai que moi pour visée à mes pensées, que je ne contrerolle [que je tiens le registre] et n'étudie que moi » (II, 6, « De l’exercitation »). Par un ultime renversement, la douleur du deuil devient ainsi l’événement fondateur d’une conversion, la révélation du labyrinthe de l’intériorité où l’écrivain, seul avec lui-même, est en communication avec les plus grands esprits qui ont paru dans le monde, et dont les maximes mémorables sont inscrites sur les poutres de la librairie qui conserve leurs œuvres. En choisissant d’être à lui-même la matière de son ouvrage, il s’est voué à une tâche infinie. Montaigne, seul avec son livre, sera toujours en bonne compagnie : une infinité de voix contraires parlent en lui, et font de son personnage une rapsodie curieusement décousue, un théâtre aux multiples rôles, une discordance dont la richesse est inépuisable : « Si je parle diversement de moi, c'est que je me regarde diversement. Toutes les contrariétés s'y trouvent, selon quelque tour, et en quelque façon : honteux, insolent, chaste, luxurieux, bavard, taciturne, laborieux, délicat, ingénieux, hébété, chagrin, débonnaire, menteur, véritable, savant, ignorant, et libéral et avare et prodigue : tout cela je le vois en moi aucunement, selon que je me vire : et quiconque s'étudie bien attentivement, trouve en soi, voire et [et même] en son jugement même, cette volubilité et discordance » (II, 1, « De l’inconstance de nos actions »).
________________________________________
NOTES
1- Sed haec, quae ex veris rebus exempla sumebantur, nunc iniquis moribus inprobantur. <Nam pinguntur> tectoriis monstra potius quam ex rebus finitis imagines certae: pro columnis enim struuntur calami striati, pro fastigiis appagineculi cum crispis foliis et volutis, item candelabra aedicularum sustinentia figuras, supra fastigia eorum surgentes ex radicibus cum volutis teneri plures habentes in se sine ratione sedentia sigilla, non minus coliculi dimidiata habentes sigilla alia humanis alia bestiarum capitibus. Haec autem nec sunt nec fieri possunt nec fuerunt.
2- Vasari fonde en 1563, sous l’égide de Cosme de Médicis, grand duc de Toscane, l’Accademia del disegno, première académie de peinture et de sculpture.