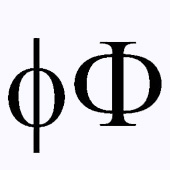Mis en ligne le 29 octobre 2007
Complété le 2 mai 2008
Les Religions du Livre
Quel est le vrai nom de Dieu? Où situer l’Absolu? A cette question qui ne cessera pas de se poser, du moins pour les hommes qui pensent et ne sont pas des bêtes, les sociétés méditerranéennes ont répondu d’une façon originale et profonde : l’Absolu est un livre. Ce qui signifie que toute vie humaine ne peut tenir et se maintenir qu’en demeurant fidèle au livre. Il y a dans l’écriture une essentielle sainteté, puisque le livre conserve trace écrite, et marque par là sa volonté de sauvegarde, d’un pacte qui scelle un lien entre celui qui engage et celui qui s’engage, entre l’auteur et le lecteur. On a montré que les premières écritures qui nous sont parvenues (écriture cunéiforme de la Mésopotamie) correspondaient surtout à des transactions commerciales, quelque chose comme des livres de compte. L’engagement des contractants est solennisé par le document écrit, et l’écriture est l’empreinte matérielle de cette aliénation de l’homme à l’homme, qui est constitutif de l’humanité même. C’est par cet engagement mutuel, cette double reconnaissance, que tout ce qui appartient à l’humanité se lève et se cultive en l’homme. L’homme n’est homme que dans la mesure où il demeure fidèle à sa parole, où il est le témoin d’un serment. Je ne suis homme, c'est-à-dire que je ne suis né au langage, que parce que j’ai répondu à la parole qu’on m’a adressée, entrant ainsi dans le pacte mutuel instituteur d’humanité. L’écriture est parole conservée, fixée, qu’on ne peut plus reprendre ; elle démontre donc la sainteté, la valeur irrévocable que l’homme attache à sa propre parole.
Les Juifs ont été les premiers à penser ainsi Dieu. Ce qui distingue le Dieu des Juifs de tous les autres, ce qui fait de Lui « le Dieu unique », c’est qu’il est l’auteur d’un livre, d’une écriture sainte donnée par lui à sa créature (mais le témoin qui écoute la parole est toujours la « créature » de celui qui lui adresse la parole). Ce Dieu est étrange : il n'a pour attribut essentiel ni la force, ni la beauté, ni l’invincibilité, ni même la toute-puissance, ni la perfection, attribut cardinal de tout autre dieu. Ce qui définit le Dieu paradoxal des Juifs, c’est sa demande, son désir, l’acte par lequel il se tourne vers moi et m’adresse la parole, l’avance qu’il me fait pour que je m’engage envers lui par un serment irrévocable, par un lien d’amour que rien ne doit parvenir à desceller. Étrange Dieu, puisque les diverses religions situaient le divin dans la perfection, l’autarcie, donc dans l’indifférence aux malheurs et à la misère des hommes. Le Dieu des Juifs est un Dieu qui veut à l'inverse signer un pacte avec les hommes, qui veut que sa créature s’engage à l’aimer, à l’adorer, un Dieu qui a besoin de l’amour de sa créature, un Dieu jaloux qui sera terrible pour celui qui, après s'être engagé, aurait la légèreté de reprendre sa parole, et se donnerait à un autre dieu. L’intuition de la religion juive, c’est d’avoir compris ce qu’il pouvait y avoir d’absolu, donc de divin, dans cette simple déclaration : « Je t’aime », et plus encore, en cette autre déclaration que contient la première : « Je veux que tu m’aimes ». Le Dieu des Juifs déclare son amour à sa créature, et veut être aimé, passionnément, et à l’exception de tout autre. Aussi noue-t-il une alliance, comme une arche entre le ciel et la terre, avec les hommes qu’il élit pour être les objets de son amour. Étrange Dieu puisque c’est sa faiblesse, le besoin qu’il ressent d’un amour qui lui manque, et non sa puissance ni sa gloire, qui le désignent. Le Dieu des Juifs est un névrosé d’amour : ne va-t-il pas demander, pour preuve de son amour, au père de tuer son enfant? L’amour est au-dessus de la moralité, Abraham doit sacrifier Isaac à l’Éternel, cela sans un mot, car l’amour obéit et ne marchande pas. Il était donc nécessaire qu’un tel Dieu scelle l’Alliance par une sainte Écriture. Il fut, le premier parmi les dieux, le Dieu du Livre. Du Livre, c'est-à-dire du Testament, ou témoignage, la trace écrite d’un engagement irrévocable et réciproque, une parole sur laquelle on ne peut revenir, une Loi gravée non dans les rochers de la terre mais dans le cœur de la créature appelée à s’engager, élue par la parole de son Créateur. Bien des religions, sans doute, invoquent l’autorité d’une Ecriture sainte : le Veda pour l’hindouisme, l’épopée de Gilgamesh pour les Mésopotamiens, Le Livre des morts pour les Egyptiens, Homère et Hésiode pour les Grecs… Mais s’il est vrai qu’il appartient à l’essence de l’écriture de pérenniser une promesse, de conserver la trace matérielle d’un engagement indissoluble, alors il faut bien reconnaître que, si toutes les religions ont un livre, seule la religion des Juifs peut être dite la religion du Livre.
Cette révolution que la sagesse juive a fait subir à l’idée de Dieu, il y a trois façons de l’interpréter : le judaïsme, le christianisme et l'Islam.
Les Juifs l’interprètent littéralement. Dieu est celui qui demande un amour exclusif, un pacte amoureux à l’élu qu’il désigne. Le culte n’est pas l’expression de l’amour de la créature pour son Dieu, il est inversement l’effet de la demande d’amour adressée par Dieu à sa créature. C’est Dieu qui prend l’initiative, et l’homme n’aime Dieu que parce que Dieu d’abord l’a engagé dans cet amour. Or, on ne saurait aimer en général : l’amour ne se décline qu’au singulier, on aime l’unique que le cœur élit, à l’exception de tous les autres. Le Dieu des Juifs sera donc le Dieu des Juifs, le peuple que son amour élit à l’exclusion de tout autre. Mais ce n’est pas assez dire : il sera le Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob, le Dieu de chacun de ceux qu’il appelle personnellement à l’aimer. Il n'est en vérité, tant l'amour de Dieu est exclusif, que le dieu d'Abraham, l'Unique, le singulièrement Elu, puis de ses fils, et de toute sa descendance, qui est le peuple juif tout entier, et qui ne forme qu'une chair avec son Père Abraham, qui fut aimé de Dieu. Car le Dieu des Juifs est le Dieu d’un peuple et non d’un individu : ce Dieu là est éternel comme l'amour même, comme doit être éternelle la parole donnée, qui transmet l'amour selon la descendance des hommes mortels. L'engagement d’amour ne saurait mourir, mais les hommes, individuellement et personnellement, sont appelés à mourir, comme ils ont été appelés, individuellement et personnellement, à aimer. Il faut donc que la promesse, dont le Livre porte témoignage, ne meure pas avec l’individu singulier que Dieu a pris à témoin, et que cette bénédiction, cette sainte alliance, se transmette aux fils, et aux fils des fils, et cela tant que Dieu sera vivant dans le cœur des hommes. Ce qui demeure dans le fils, c’est la parole du père, puisque le fils n’est un fils, c'est-à-dire n’est humain, que par le don de la parole qui lui a été d’abord fait, et qui a fait naître en lui, à son tour, la grâce de la parole, et l’a ainsi élevé à la dignité de répondant, de responsable, de témoin de la parole donnée. C’est par le Verbe que la lumière se fit dans l’esprit des hommes, c’est par la seule puissance de la parole que Dieu est créateur, faisant naître un homme responsable là où il n’y avait d’abord que le plus misérable des animaux. Le Dieu d’Israël aime comme une mère, qui donne la vie et continue la descendance, et veut que son enfant l’aime, passionnément et à jamais. C’est ainsi que tous les descendants d’Abraham, que l’Ange après son combat avec Jacob, petit fils d’Abraham, a nommés « Israël », sont les élus du dieu d’Amour, objets de l’amour d’un Dieu jaloux qui ne veut pas qu’on le trahisse, qui ne saurait supporter qu’on se détourne de lui. L’Élu du Dieu d’amour devient un peuple, qui se déclare seul témoin du Dieu unique, puisqu’il est le seul peuple que l’amour de Dieu a élu, et dans ce peuple, un individu, le premier qui ait osé s’engager amoureusement envers le divin, Abraham. Tous les autres, privés d’amour, seront damnés. La religion juive est la transposition métaphysique, dans le registre de l’Absolu, du délire passionnel de la paranoïa amoureuse.
Le christianisme prolonge la révolution accomplie dans l’idée de Dieu par la pensée juive. Si Dieu est tout entier demande d’amour, c’est donc que le divin est tout entier dans le manque et non dans l’autarcie, dans la souffrance et non dans la jouissance, dans l’angoisse et non dans la plénitude, dans la passion et non dans la sérénité. Dieu perdant alors les attributs de la toute-puissance, s’efface et s’éloigne pour laisser paraître son Fils, qui épouse la souffrance de la condition humaine, c'est-à-dire qui s’incarne, non pour la jouissance (tel Zeus qui prend la forme d’Amphitryon), mais pour la passion, pour le supplice et pour la mort. Le christianisme opère ainsi un prodigieux renversement des valeurs : le mystère de l’agonie est plus divin que le bonheur de vivre, la pauvreté est plus divine que la richesse et sa suffisance, l’enfance démunie est plus divine que l'arrogance de l’âge adulte, l’aveu d’ignorance est plus divin que la superbe des savants, l’humiliation est plus divine que la royauté, et la folie de Dieu plus divine que la sagesse des hommes. Réfléchis dans le miroir du Christ, qui est le roi du monde à l’envers, les premiers seront toujours les derniers et les derniers les premiers. Saint Paul est le maître de cette rhétorique de l’inversion systématique, il est le témoin de la « conversion », qui est renversement du pour au contre. Il y a pourtant là davantage qu’une simple logique formelle : le christianisme me fait toucher du doigt l’énigmatique trésor des humbles, la royauté vraiment renversante des offensés et des humiliés, le mystère plus qu’humain de la victime qui tourne vers moi son regard égaré. Nietzsche ne se trompait pas quand il devinait, dans le christianisme, « la métaphysique du bourreau » : le bourreau cesse de l’être, en effet, du jour où lui apparaît le Christ, la Sainte Face muette et regardante, sur le visage de la victime qu’il s’apprêtait à immoler. De ce jour-là, mais de ce jour-là seulement, le bourreau sera sauvé, le couteau lui tombera des mains et, touché par la grâce, il prendra pitié de l'exclu, désormais son prochain et son frère. Le christianisme est méditation sur la mort, et cette méditation n’est pas sans rapport avec la méditation sur l’amour, tant l’amour est nécessairement mort à soi-même et résurrection en un autre. Le Livre devient alors le Livre du Fils, qui témoigne pour la souffrance qui le fait humain, et en révèle la part divine. Le judaïsme commémore le silence et l’engagement d’Abraham ; le christianisme célèbre la substitution, à l’enfant innocent sur le point d’être égorgé, du bélier ou de l’agneau du sacrifice. Le judaïsme garde la foi inébranlable de l’Elu ; le christianisme prie pour le miracle qui fait naître la pitié dans les cœurs. La leçon du christianisme est leçon de charité. Et l’objet de cette charité est universel comme est universelle l’angoisse de mort, il plaide non pour l’individu singulier qui demande l’aumône, mais pour l’universelle misère de notre condition, pour le Christ qui agonise en chacun de nous. La leçon de charité est leçon de ténèbre. Le christianisme ne saurait être limité à un peuple élu, et vaut également pour tous les hommes, qui sont égaux devant la mort. Le dieu des Juifs est le Dieu d’un peuple, mais le Dieu des chrétiens est le Dieu de tous les hommes. Il doit l’être, et l’on n’hésitera pas à recourir à la force pour qu’il le soit en effet. La religion chrétienne est la seule qui ambitionne de devenir « catholique ».
L'Islam s’éloigne de cette méditation sur la mort qui oriente le christianisme, et l’incline dans un sens plus humaniste et civil. L’engagement passionnel du Juif envers son Dieu, qui est le Dieu de nul autre, est excessif et non exempt de narcissisme : il n’est pas difficile de soupçonner que l’amour-propre est le mobile caché de l’amour passionnel, et que le délire de la jalousie est un jeu de doubles. Pour en conserver la sainteté, le musulman modère donc cet engagement qui lie le Créateur à sa créature : amitié plutôt qu’amour, amitié en ce sens où Aristote l’entend (les Arabes, qui nous ont transmis la sagesse grecque, n’y sont pas non plus demeurés sourds), la philia qui rassemble les individus dans le cercle d’une même société, dans l’harmonie d’une communauté. Le Dieu des Musulmans est le Dieu de l’amitié, de l’échange respectueux d’autrui, de la reconnaissance du cœur. Sans ce Dieu, rien d’humain n’aurait pu naître, car l’homme est un animal politique, il est le fruit le plus précieux de la communauté civile. Les peuples du désert étaient sans doute prédestinés à percevoir cette vérité, menacés à chaque instant par un monde inhospitalier et inhumain, contre lequel le lien social est le seul rempart : celui qui s’égare seul dans le désert est voué à une mort certaine. Il n’y a de salut que par le lien civil, par l’engagement amical, venu du cœur et non pas simplement formel, de tous les membres d’une même communauté. Dieu est celui qui est parmi nous chaque fois que nous nous réunissons en son nom. Le Livre devient alors le Livre d’une société civile qui prescrit à chacun ses droits et ses devoirs, qui rassemble les individus dispersés dans l’ordre et dans l’harmonie d’une communauté. C’est ainsi que la médina se construit autour de la mosquée et des souks. Les souks sont à l’image d’une société profane, non ordonnée par Dieu, par la divine amitié : chaque marchand poursuit son intérêt propre et cherche légitimement son profit. L’amitié est pourtant présente, sinon le souk serait guerre et non marché, par le jeu amusé mais grave du marchandage : la transaction est une occasion de s’estimer l’un l’autre, de faire fonctionner cette réciprocité sans laquelle rien d’humain n’aurait lieu, ni la malice, ni la tromperie, ni la bienveillance et même une forme raisonnable de générosité (l’avare ne sait pas marchander) : ainsi les partenaires d’un jeu apprennent-ils, coup par coup, à se connaître l’un l’autre, et à se reconnaître. L’important en ce cas est moins celui qu’on est que celui que l’autre croit qu’on est. Et ce jeu est encore un bon exercice pour former le sens de la politesse, sans laquelle il n’y a cité ni politique qui tiennent : toute insulte, tout acte de brutalité brise le cercle du marchandage, cette évaluation réciproque sans laquelle il ne saurait y avoir d’estime ni de reconnaissance entre les hommes. Le faire-croire du marchandage marque le caractère seulement humain de la transaction. Mais on ne saurait faire croire ce qui n’est pas au Dieu qui fonde l’alliance d’amitié entre les hommes, qui sonde les cœurs et les reins et sait, juge suprême, d’un unique regard, si l’amitié vient du cœur, ou n’est qu’une grimace sur le visage. La mosquée ordonne alors la sainte amitié qui témoigne pour le divin, rigoureusement et sans la moindre déviation individuelle. A l’heureuse anarchie du souk s’oppose l’alignement impeccable des fidèles à l’heure de la prière, tous orientés vers le mirhab, qui désigne la direction de la Mecque, d’où partit le prophète. Une mosquée est un jeu de miroir qui perpétue à l’infini l’image du corps qui se livre à la génuflexion et à la révérence de la prière : les colonnes qui se perdent dans l’obscurité définissent des allées par une succession de travées dont chacune contient un orant, les orientant tous vers la ville du Prophète. Chacun est ici, non le concurrent du voisin, comme c’est le cas dans le souk, mais l’exacte image de son voisin, faisant les mêmes gestes en même temps que lui, tous démultipliés par cette machine à unir et à ordonner qu’est la voûte recommencée de la mosquée. Celui qui verrait tous ces hommes parfaitement alignés par la direction qui leur est commune, unis par un culte commun, saurait en vérité que Dieu est grand. L’amour de Dieu est encore semblable à celui d’un père pour ses enfants, le père qui assume l’autorité politique et la transmet à sa descendance par le fils aîné. Dieu volontiers conformiste, respectueux des traditions, soucieux des coutumes, qui veille à ce que l’ordre social, qui porte l’image de l’amour de Dieu, ne tombe pas sous les coups des fils rebelles, qui insulteraient l’amitié éternelle qui maintient les hommes ensemble et mettraient en péril l’unité du clan.
Cette approche de l’Islam est pourtant insuffisante : elle définit le lien religieux horizontalement, comme lien civil des Croyants au sein de la Communauté musulmane. En ce sens, l’Islam est fondateur d’une réflexion sur le droit, lui-même issu du respect de la coutume et des commandements du prophète, il définit et fonde la cohésion d’une communauté religieuse et politique tout à la fois. Mais il existe encore une autre dimension de l’Islam, à la fois complémentaire et en apparence opposée à la première. Tant que nous considérons Allah dans la communauté des Croyants, nous l’incarnons pour ainsi dire dans la société des hommes. Or, des trois visages du Dieu des religions du Livre, c’est-à-dire des religions monothéistes, celui de la religion musulmane est certainement le moins incarné, en ce sens qu’il est aussi celui dont la transcendance est la plus affirmée. Allah est au-delà de tout ce qu’il nous est possible de connaître et même de penser, il est en quelque sorte l’absolu du surhumain, la transcendance infinie en laquelle s’abîme l’extase mystique. C’est ainsi que Jésus n’est qu’un prophète, nullement le Fils de Dieu : que Dieu puisse s’incarner sous figure humaine est une pensée aberrante pour un Musulman, et qui plus est que cette incarnation soit destinée à l’humiliation et au supplice de la croix. Aussi la tradition prétend-elle que ce n’est pas Jésus, mais un sosie qui mourut sur la croix. Cette transcendance absolue du divin, elle est connue, dans la tradition musulmane, sur le mode de l’inspiration sacrée. Le modèle en est l’inspiration du prophète lui-même, Mahomet, qui reçut le Coran sous la dictée de Dieu et par l’entremise de l’archange Gabriel. Il existe ainsi des révélations qui sont données à la créature par l’effet d’une incompréhensible fulguration. Le prophète reçoit passivement le don de la transcendance, et la foi consiste en cette humilité qui accepte de n’être rien pour que Dieu soit tout en nous. C’est en cet abandon entre les mains de Dieu que consiste la croyance. D’Allah lui-même nous ne savons rien, sinon qu’il est le miséricordieux, celui qui donne la connaissance dans le ravissement qui élève l’âme à la dignité prophétique. Allah est l’absolument unique (rejet violent de la part du Coran du dogme catholique de la Trinité), et en cet Un (c’est ainsi que Plotin au IIIe siècle définissait la première hypostase), il est aussi l’absolument inconnaissable, puisque connaître c’est toujours et nécessairement analyser et différencier, distinguer un sujet de ses attributs distincts. On ne peut dire que Dieu « s’incarne » lorsqu’il s’empare de l’âme prophétique, il faut plutôt dire que l’homme s’abîme et s’anéantit dans la pure extase du surhumain. Dieu ne descend jamais jusqu’à l’homme, c’est plutôt l’homme qui, en de rares instants, est élevé dans les cieux, parmi les anges, et reçoit l’illumination fulgurante de la science divine. L’effet de cette aliénation du mortel dans l’infini, c’est un texte (plutôt qu’une parole, qui suppose une proximité trop grande, presque une familiarité entre le Dieu et son prophète, comme on le voit chez les prophètes de l’Ancien Testament, et plus que tous chez Abraham). Dieu ici se manifeste dans une langue d’une extraordinaire pureté, d’une beauté poétique et littéraire inimitable. Allah est ainsi, si l’on peut parler de cette manière trop humaine, le foyer surhumain de l’inspiration poétique, il est la source de tous les ravissements de l’âme lorsqu’elle enfante une parole nouvelle. C’est ainsi que l’Islam est aussi religion du Livre, mais le Livre devient alors le texte qui fixe la langue et définit une poétique qui nourrit tout l'imaginaire et la littérature d'un peuple. En ce sens, le Coran est moins l’engagement de la promesse d’un Dieu qui se fait proche de sa créature en nouant avec elle une alliance, que la connaissance révélée par la fulgurance d’une absolue transcendance, le texte immuable en lequel Dieu s’est fait connaître aux hommes. La Tōrah signe une alliance entre Dieu et son peuple, le peuple juif ; le Nouveau Testament enseigne la leçon de la charité à tous les hommes ; le Coran soude la communauté des Croyants dans l’unité de l’Islam (horizontalité du lien juridique), mais par l’effet d’un transport céleste, d’une extase surnaturelle, délivre la vraie connaissance en élevant la créature dans l’absolu de la transcendance divine (verticalité de l’inspiration). Toute poésie se réclame de cette dictée inspirée, créatrice d’une langue pure et nouvelle, riche en images et métaphores. Le néoplatonisme byzantin s’insinuera dans cette tradition littéraire : le ravissement de l’âme, arrachée du mortel et élevée dans l’immortel, s’abîmant au terme de son ascension dans « l’océan du beau », telle que le rapporte Diotime dans le Banquet, s’associera à l’inspiration absolue du prophète écrivant sous la dictée de Dieu, en proie au travail de la transcendance. Au XIIIe siècle, la poésie d’un Djalal Od-Din Rûmi, fondateur de la secte des derviches tourneurs (danse du vertige de l’âme qui s’abîme progressivement dans l’infini) est une magnifique illustration de cette mystique de pure poésie.
Les deux dimensions de l’Islam, horizontale et verticale, juridique et prophétique, sont assez opposées pour donner lieu, dans l’histoire de la religion musulmane, à deux courants distincts : la fidélité à la foi affirme d’abord un lien juridique et civil. En tant que ce lien est respect de la jurisprudence et de la tradition, l’Islam est l’Islam sunnite ; en tant qu’il affirme, plus encore que le respect de la tradition, la loi du clan familial et les liens du sang, il est l’Islam chiite, fidèle au calife Ali, gendre de Muhammad et époux de sa fille Fatima. L’autre dimension, verticale, du ravissement prophétique et de l’inspiration poétique, donnera lieu à l’admirable poésie et à la mystique du soufisme, qui se rend étranger à ce monde en se laissant consumer par la flamme de la transcendance, en se perdant vertigineusement dans l’extase de l’infini.
On conclurait sans peine que le judaïsme est menacé par le narcissisme aveugle et l'enflure hyperbolique du moi, le christianisme par le despotisme comme humiliation nécessaire de la vanité humaine et méditation sur la mort, l'Islam par le conformisme et le respect méticuleux des hiérarchies, toute innovation devenant trahison à l'égard du pacte amical qui rassemble les hommes dans un ordre nécessairement sanctifié ; ou par le vertige et l’extase qui transportent dans l’infini, et réduisent à néant toute valeur simplement terrestre.