|
PETIT ECHANGE AVEC CHATGPT
APHORISMES
ETRE ET EXISTER
ENSEIGNER LA PHILOSOPHIE
ESTHETIQUE DE L'ABSTRACTION
PRINCIPES DE PHILOSOPHIE ESTHETIQUE
LA PEINTURE HOLLANDAISE AU SIECLE D'OR
LES FANTOMES DE L'OPERA
ON DEVRAIT DIRE...
QU'EST-CE QUE LE NEOREALISME ?
1- Le néoréalisme italien
2- Le néoréalisme dans le monde
3- Le destin du couple
4- Personnages en quête d'auteur
5- Commediante...
6- Le cinéma dans le cinéma
LA STAR, LA VIVANTE ET LE SANS POURQUOI
ESTHETIQUE DU PARADIS TERRESTRE (1)
LE REALISME SELON CEZANNE
NOTE SUR WITTGENSTEIN
ENTRETIEN
CEZANNE ET LA FORCE DES CHOSES
MANTEGNA : ANCIENS ET MODERNES
LE TABLEAU ET LE MIROIR
LE JARDIN A LA FRANCAISE
REMBRANDT, BETHSABEE
PHILOSOPHIE ET RHETORIQUE
LES RELIGIONS DU LIVRE
DU CARACTERE A LA CARICATURE
QUELLE VANITE QUE LA PEINTURE...
LES GROTESQUES
LE ROSSIGNOL ET LA DIVA
LA STATUE AMOUREUSE
L'INTERPRETATION DE L'OEUVRE D'ART
DE L'IDEE DU BEAU A L'ESTHETIQUE
CARAVAGE ET L'OPERA
|
QU'EST-CE QUE LE NEOREALISME ?
REFLEXIONS SUR LE CINEMA
(1945-1960)
2- Le néoréalisme dans le monde
Qu’est-ce que le néoréalisme ? On ne saurait le réduire, comme le voulait Aristarco, à un cinéma militant, prenant le parti de la classe ouvrière contre le mélodrame des téléphones blancs dont raffolait le cinéma mussolinien ; on ne saurait davantage le réduire, comme le voulait Bazin, à une nouvelle esthétique, une phénoménologie du dépouillement (ce qui conduisait Bazin à classer Robert Bresson, et tout particulièrement Les Dames du bois de Boulogne de 1945 parmi les œuvres « néoréalistes ») qui tend vers le « cinéma-vérité », le regard objectif du documentaire ou du reportage. Dans la mesure où la nébuleuse néoréaliste peut-être enclose dans une définition, il faut plutôt la rapporter au regard désenchanté de l’immédiate après-guerre, aux décombres de la vieille Europe dévastée par les bombardements, à la désorientation des peuples, à l’écroulement de l’image paternelle et de son double mythique – le héros qui revendique en son nom la responsabilité de l’action – à la fin des grands récits qui fondaient autrefois la grandeur des nations. L’Histoire fait le vide. Le cinéma néoréaliste témoigne pour le « désert » (Antonioni, Il deserto rosso, 1964) que laissent derrière elles les fureurs meurtrières de la modernité : temps mort d’une mise en scène qui perd le fil du récit, ennui du désœuvrement, détresse de la démobilisation, errance sans but ; espace vide, désaffecté, encombré de gravas, de Berlin en ruines – anno zero, Jahre Null – où va et vient, sans trouver l’issue, le jeune Edmund (Rossellini, 1948), terrains vagues de la banlieue romaine dans l’Accattone de Pasolini (1961), morne plaine où coule le Pô, que célèbre le documentaire d’Antonioni, équivalent pour le cinéma de ce qu’est le poème en prose pour la littérature (Gente del Po, 1943), où tentent vainement de fuir les amants de Visconti (Ossessione, 1943), où meurent les partisans, jetés dans le delta du fleuve, comme dans une immense lagune sans mémoire, dans le sixième et dernier épisode de Païsa (Rossellini, 1946), rives déshéritées du fleuve gris le long desquelles se succèdent les stations de la passion d’Aldo, abandonné de l’unique femme qui pouvait lui donner l’amour, pour un road movie circulaire, donc sans but, puisque le voyage n’a d’autre fin que de revenir, pour mourir, au point de son départ (Il Grido, Antonioni, 1957). Le néoréalisme serait ainsi le miroir désenchanté du nihilisme passif et contemplatif qui se trouve à l’origine de notre postmodernité – opposé en ce sens au nihilisme héroïque et violent du fascisme ou du nazisme – esthétique presque abstraite d’un monde nu, enclos dans le double horizon d’un espace de nulle part et d’un temps qui ne mène à rien. Bazin, plus attentif à la sensibilité du regard néoréaliste, était sans doute plus proche qu’Aristarco de cette intuition d’un monde néantisé. Mais il ne voulait considérer en cette nouvelle vision que ses qualités formelles, sans la rapporter explicitement à l’effondrement de l’Europe des nations.
La métaphore de la boxe : le film noir et Rocco
Il se peut que le cinéma néoréaliste soit un cinéma de vaincus : c’est sans doute en Italie et au Japon qu’il produira ses œuvres les plus remarquables, tandis qu’on ne peut parler de néoréalisme américain, ni britannique, même si l’ancêtre de la lignée, l’Ossessione de Visconti (1943), se présente comme une libre adaptation du roman noir de James Cain – Le facteur sonne toujours deux fois – et même si les écrivains comme les cinéastes italiens cherchaient à s’affranchir du maniérisme à la d’Annunzio, qui alourdissait l’esthétique du fascisme, en se réclamant du style constatatif des romanciers américains, Dos Passos ou Hemingway. Certes, si l’on s’en tient à l’attention portée aux humbles comme aux opprimés, le film noir américain n’est pas sans rapport avec l’inspiration néoréaliste, mais il en transforme cependant radicalement l’accent en le convertissant vers l’action, son engagement, son efficacité : Philippe Marlowe, auquel Humphrey Bogart prête son flegme, a beau être revenu de tout, il conserve cependant une énergie redoutable pour rétablir la situation (Le grand sommeil, Howard Hawks, 1946). Héros négatif, winner travesti sous le masque du looser, le détective ou le gangster – on finit par les confondre tant ils se ressemblent – conduit résolument le scénario jusqu’à son terme, dût-il y succomber. La vie ne vaut rien, certes, mais rien ne vaut une vie quand on a le caractère assez bien trempé pour tenir bon jusqu’au dernier round, dont nul n’ignore qu’il sera fatal. Le match de boxe devient alors l’allégorie de l’humaine condition, et son héros amoché le prototype du titan foudroyé par un destin aveugle, absurde et inhumain. On pourrait dire en ce sens que le magnifique film de Robert Wise, Nous avons gagné ce soir (1949), est l’équivalent américain du cinéma néoréaliste italien, épopée désastreuse d’un boxeur sur le retour qui emporte une dernière victoire, qui se révélera être en vérité sa dernière défaite. Mais le film noir américain – plus proche de l’expressionisme allemand, qui pathétise l’ombre et la lumière, le noir et le blanc, que du paysage gris et brumeux du néoréalisme italien – ne se résigne jamais à la passivité ni à la contemplation : le sublime vaincu rend coup pour coup, pourtant conscient de la vanité de son combat. Il se trouve que le dernier film de Visconti qu’on puisse rattacher à la tradition néoréaliste raconte aussi une histoire de boxeurs : Rocco et ses frères (1960, tourné trois ans seulement avant Le Guépard). Mais la boxe n’est plus ici, comme dans le film noir, le corps à corps où l’emporte celui qui cogne le plus fort, mais le noble art, une ordalie que seuls peuvent surmonter les cœurs purs : Simone, qui est une brute, sera vaincu tandis que Rocco, dont l’honnête Ciro dit qu’il est un saint, triomphe sur le ring. Rocco est pour ses frères comme un ange gardien, il ressemble à cette première pierre qu’en Lucanie, entre les Pouilles et la Calabre, le pays de la famille en exil à Milan, on jette en sacrifice sur l’ombre du premier venu pour assurer la solidité de la maison familiale (1). Le sacrifice de Rocco – l’Aliocha des frères Parondi-Karamazov – ne sauvera pas Simone, mais il baigne le film dans la lumière de la grâce et fait de la boxe non une mise à mort, mais une danse où l’esquive l’emporte sur l’assaut. Les quatre frères, entraînés par leur mère dans la grande ville du nord pour sortir de la misère qui les accable au pays, rêvent, à la fin du film, de retrouver la terre ingrate qu’ils ont abandonnée. Un humanisme, qui doit beaucoup à la compassion chrétienne, donne au film de Visconti une douceur, une sensibilité à vif qui l’apparente au mélodrame. La désillusion néoréaliste – car, dans ce Milan de la fin des années cinquante, en pleine reconstruction, encombré de chantiers et d’échafaudages, la famille en exil est condamnée à perdre toutes ses illusions – est éclairée par une incompréhensible rédemption qui la nimbe de mystère. On dira que c’est là une grâce – totalement étrangère au film noir – qui n’est accordée qu’à cette œuvre, et à nulle autre. Ce serait oublier, par exemple, la même compassion muette qui réunit, à la fin du Voleur de Bicyclette, l’enfant au père humilié. Nombreux étaient alors ceux qui ne considéraient, en cette pitié retrouvée, qu’une sentimentalité trop facile, et qui auraient préféré que De Sica s’engage dans un art plus ouvertement politique, plus résolument engagé dans les luttes objectives et moins sensible aux troubles de la vie intérieure (2). La réussite éclatante de ces deux films – que nul ne conteste aujourd’hui – suffit à réfuter ce jugement. Il y a pourtant là une énigme, dont l’enjeu philosophique est, pour l’âge contemporain, considérable : si le néoréalisme est, comme nous le pensons, l’expression de la démoralisation qui s’abat sur la conscience européenne au lendemain de la guerre, d’où vient ce rayon de lumière qui tempère l’accablement d’un avenir sans espérance ? Si le néoréalisme est un nihilisme, si son rôle est d’inaugurer l’esthétique des temps nouveaux, esthétique de la vacuité, de l’errance, de la mélancolie et de la solitude – temps mort, espaces désaffectés – comment comprendre qu’il puisse subsister, dans ces ténèbres, la promesse d’une rédemption ? Et si le néoréalisme – comme le démontre magnifiquement l’art d’un Vittorio De Sica – est aussi un humanisme, comment comprendre cette dignité retrouvée par delà l’humiliation, et alors même que l’humanité en guerre vient de s’effondrer dans l’inhumain ? Comment penser cette persistance de l’humain à l’aube des temps nouveaux qu’on prophétisait pourtant au-delà de l’humain, l’homme, cette « invention dont l’archéologie de notre pensée démontre aisément la date récente », étant sur le point de « s’effacer, comme à la limite de la mer un visage de sable » (3) ?
Réalisme et nihilisme européen (Flaubert et Verga)
Parmi les prophètes de malheur qui se dressent au seuil de notre temps, celui dont les imprécations sont les plus furibondes, les plus inspirées aussi, est certainement Frédéric Nietzsche. Ne lançait-il pas, contre le vingtième siècle alors sur le point de commencer, la malédiction du nihilisme ? « Le nihilisme est devant la porte : d’où nous vient ce plus inquiétant de tous les hôtes ? » (4). Dans les derniers chapitres de La généalogie de la morale (1887), Nietzsche attribuait à « l’idéal ascétique » – qui fait de la volonté son propre bourreau en la condamnant aux travaux sans fin de l’examen de conscience – le responsable de l’irrésistible progression du nihilisme en Europe : « Ici, la neige est partout, la vie s’est tue ; les dernières corneilles croassent : “A quoi bon ?”, “En vain”, “Nada !” » (5). Le « pessimisme instinctif » de Flaubert comptait, aux yeux du philosophe, parmi les symptômes les plus marquants de cette épidémie de la désespérance. Il est vrai que le réalisme, et donc peut-être aussi le néoréalisme, se définit volontiers lui-même comme une esthétique du néant, du nihil, du rien. On sait que Flaubert, dans une lettre célèbre de 1852 adressée à Louise Colet, rêvait d’écrire un livre dont le « rien » serait le thème principal : « Ce qui me semble beau, ce que je voudrais faire, c’est un livre sur rien, un livre sans attache extérieure, qui se tiendrait de lui-même par la force interne de son style, comme la terre sans être soutenue se tient en l’air, un livre qui n’aurait presque pas de sujet ou du moins où le sujet serait presque invisible, si cela se peut » (6). Lorsqu’il rédige cette lettre, Flaubert est en train d’écrire Madame Bovary, et c’est peut-être à ce roman qu’il songe en faisant cet étrange aveu, bien que la lettre mentionne explicitement les deux manuscrits trois fois recommencés de L’Education sentimentale et de La Tentation de saint Antoine. Il n’est pas facile d’en bien comprendre le sens : Flaubert semble dire que l’importance du sujet est inversement proportionnelle à la magnificence du style, et qu’il faut réduire à presque rien le récit – ici un fait divers survenu à l’époque de Louis Philippe : le suicide par empoisonnement de l’épouse de l’officier de santé Delamare – pour que l’œuvre s’élève aux sommets de « l’Art pur ». Mais il y a beaucoup de faconde et de rodomontades dans la correspondance avec Louise Colet, et il est permis de soupçonner que c’est en un autre sens que Madame Bovary est aussi « un livre sur rien » : un livre sur le néant plutôt qu’un livre sur l’insignifiant. La mort d’Emma est sans doute l’épisode le plus puissant de ce roman extraordinaire et glaçant. Elle est, nous dit Flaubert, dont le réalisme est ici proche de l’hallucination, « la survenue du néant » : « Il y a toujours après la mort de quelqu'un comme une stupéfaction qui se dégage, tant il est difficile de comprendre cette survenue du néant et de se résigner à y croire. Mais, quand il s'aperçut pourtant de son immobilité, Charles se jeta sur elle en criant : – Adieu ! Adieu ! ». Il y a dans l’agonie d’Emma, accompagnée par le chant obscène de l’Aveugle, une indicible épouvante qui réduit à néant toute volonté de vivre, et n’accorde de valeur qu’au travail obstiné de l’artiste. Il se trouve que le « réalisme » de Flaubert n’est pas sans relation avec le « vérisme » italien qui inspire les romanciers à la fin du XIXe siècle, et tout particulièrement Giovanni Verga (1840-1922) qui avait, pour l’auteur de Madame Bovary, une profonde vénération. Son roman le plus célèbre, Les Malavoglia (c'est-à-dire ceux qui avancent à contre cœur dans l’histoire, les hommes de mauvaise volonté), retrace l’épopée funèbre d’une famille de pêcheurs siciliens condamnés sans appel par le progrès : malgré leur courage, leurs luttes, ils seront irrémédiablement anéantis, comme par une incompréhensible et terrifiante malédiction. L’histoire, en arrachant les hommes à leur famille, à leur terroir, à leur village, en les condamnant à l’exil, les condamne à la mort. Le roman faisait partie d’un cycle plus vaste, Les Vaincus, qui demeure inachevé (I Vinti : c’est également le titre de l’un des premiers films d’Antonioni, tourné en 1953, un long métrage composé de trois épisodes consacrés à la jeunesse désorientée de l’après-guerre qui, par ennui, verse dans le crime). C’est de ce sombre roman que s’inspire assez précisément Visconti dans La terra trema (1948), dont la critique politiquement engagée fera alors le chef-d’œuvre du néoréalisme. La caméra de Visconti transfigure cette ténébreuse misère par des plans savamment composés, par l’esthétique raffinée du noir et du blanc, mais aussi en laissant entendre, à l’inverse de Verga, que tant d’injustices feront qu’à la fin la terre tremblera, quand se soulèveront les damnés de la terre et que sera mis fin au règne des oppresseurs. Le parti communiste italien aurait été moins enthousiaste si la leçon de ce film se bornait au désespoir et à la résignation, s’il n’annonçait pas, au moins par son titre, qui contredit presque celui de Verga, des lendemains qui chantent. D’où vient cette espérance qui illumine secrètement un monde sans espoir ?
La tombe d’Ozu : nihilisme du néant et nihilisme du rien
Au livre sur « rien » de Flaubert, on est alors tenté d’opposer un autre « rien » somptueusement calligraphié sur la tombe d’un cinéaste japonais, dont l’art précisément semble nous offrir la forme la plus accomplie de ce que pourrait être un néoréalisme extrême-oriental : Yasujiro Ozu (1903-1963) est l’auteur d’une œuvre étonnamment cohérente, qui se joue tout entière sur la scène de la famille japonaise rassemblée dans la maison familiale, en s’attachant plus précisément aux passages des modes (les enfants, fascinés par l’occupation américaine, rêvent de devenir joueurs de base-ball), aux seuils de la vie qui rendent sensible l’écoulement du temps, aux séparations qui nous font prendre conscience de notre radicale solitude (la maison abandonnée par les enfants qui se marient, les morts qui laissent après eux une pièce vide, mais hantée par le souvenir). Ainsi passe la vie des hommes, scandée par des petits « riens » qui sont comme les coups de plectre qui font brusquement vibrer le shamisen de l’âme (7). Ces « presque rien » sont aussi des « je ne sais quoi », puisqu’ils ont le pouvoir de magiquement représenter le flux invisible et silencieux du temps, et rendent ainsi en quelque sorte présente l’absence même. Ainsi Ozu se penche-t-il avec une tendresse amusée sur les infimes incidents de la vie domestique, qui ne semblent petits qu’à un regard superficiel et distant, mais qui laissent en vérité des traces ineffaçables dans le secret des cœurs. Ce sont sans doute ces « riens » que signifie le caractère chinois « mu », gravé sur la face d’un cube de granit, qui fait l’unique ornement de la tombe d’Ozu, d’après une calligraphie de Sôgen Asahina, un moine du temple Engaku réputé pour la souplesse de son trait, et qui a rédigé par ailleurs plusieurs livres sur le bouddhisme zen. Cette notion joue, dans la spiritualité zen, un rôle central. On la traduit par « vide », « rien », « vacuité », « impermanence ». Il ne s’agit pas ici de se lancer dans une exégèse de la notion de vide dans le bouddhisme japonais, tant cette culture nous demeure étrangère (malgré la mode qui met aujourd’hui le zen à toutes les sauces !), mais plutôt d’accéder à une autre pensée du « rien », par-delà notre nihilisme, en prêtant attention au seul cinéma d’Ozu, qui s’offre à nos regards, à l’inverse de l’écriture traditionnelle de l’ancien Japon qui reste, aux yeux de nombreux occidentaux, indéchiffrable. Wim Wenders, qui a consacré un film à Ozu (Tokyo-Ga, 1985, tourné en 1983), fait de cette tombe un véritable sanctuaire du cinéma, vers lequel il accomplit de périodiques et pieux pèlerinages. Cette vénération aurait sans doute paru outrée aux yeux d’Ozu lui-même, dont la pudeur répugnait à l’exhibitionnisme des grands sentiments. Les Japonais ont en détestation les dissertations sur la prétendue « japonité » d’Ozu, car c’est à leurs yeux la condition de l’homme dans sa plus grande universalité que donne à voir ce cinéma, notre passion dans le temps, l’exercice de la patience qui lentement, doucement, nous conduit à la mort. On ne trouvera pas trace ici de l’emphase de la mort de Dieu ni des prophéties déclamatoires du nihilisme européen. Dans le cinéma d’Ozu, les humains meurent discrètement, en prenant garde à ne pas déranger les voisins, dans l’immense indifférence du temps qui passe. Il n’y a rien, dans ce « rien », de dramatique, rien qui justifie qu’on en fasse un drame, seulement le mystère silencieux de l’impermanence des choses et des êtres, la douleur de la séparation, le travail du deuil qui nous fait insensiblement accepter l’absence, car le temps sait aussi bien guérir que blesser. Selon cette poétique non-aristotélicienne, où tous les rôles sont pour les hommes du commun, pour les gens de peu et non pour les héros, où il ne se passe rien, ou presque rien – l’impossible nostalgie du retour et le trouble de l’irréversible – la tragédie, avec ses ruptures, ses retournements et le développement rigoureux des conséquences de l’action, semble par comparaison une déclamation hyperbolique. A l’inverse, une discrète comédie se joue dans les scènes toujours semblables de la vie quotidienne, avec son rituel de politesse, le rythme symétrique des mutuelles courbettes, le soin scrupuleux qu’on met à ne pas irriter les amours-propres, et les apartés qui nous apprennent que, sous le masque, nul pourtant n’est dupe. Le jeu subtil de l’allusion et du sous-entendu porte à sourire, jamais à rire aux éclats, tant l’œil et l’oreille apprennent à se faire attentifs aux plus infimes variations de l’expression du visage comme du ton de la conversation. Les premiers films d’Ozu furent d’ailleurs des comédies, prenant pour modèle non le théâtre traditionnel japonais mais les films d’Ernst Lubitsch, pour lesquels Ozu éprouvait une grande admiration. Il y a dans cet art l’esquisse d’un nihilisme amusé et serein, qui ouvre une voie nouvelle au cinéma de la désillusion. Il arrive même que le vide soit, chez Ozu, source de joie : les personnages, qui sont de petites marionnettes, dérisoires et attachantes, diversement disposées sur le damier de l’habitat japonais, comme les pions sur le tableau du jeu de go, se font rarement face, comme si leur extrême courtoisie les incitait à esquiver toujours la confrontation du duel : ils se disposent plutôt à côté l’un de l’autre, regardant tous deux dans la même direction, fixant le regard sur « rien », ou s’abandonnant à leurs rêves les yeux perdus dans le vide. C’est paradoxalement alors qu’ils goûtent le plus intensément le plaisir d’être ensemble, partageant le bonheur de l’instant sans qu’il soit besoin de prendre la parole, communiant mieux dans le silence qu’ils ne pourraient jamais s’entendre par le discours, toujours et nécessairement ambigu. Ozu nous enseigne que penser à « rien » n’est pas perdre son temps, que cette ascèse peut-être occasion de béatitude, et qu’il y a un nihilisme heureux. Il faudrait distinguer un réalisme du néant, propre à l’occident, d’un réalisme du rien, propre à l’orient : le néant (ne-gentem) est une négation, il nie la valeur de toutes choses, il affirme que tout est vanité et se définit ainsi lui-même non comme renoncement, moins encore comme détachement, mais inversement comme volonté de néant. C’est bien sur cette pensée que Nietzsche, en 1887, achève sa Généalogie de la morale : « Tout cela signifie, osons le comprendre, une volonté d’anéantissement, une hostilité à la vie, un refus d’admettre les conditions fondamentales de la vie ; mais c’est du moins, et cela demeure toujours une volonté !... Et pour répéter encore en terminant ce que je disais au début : l’homme préfère encore avoir la volonté du néant que de ne point vouloir du tout… » : lieber will noch der Mensch das Nichts wollen als nicht wollen (Généalogie de la Morale, derniers mots de la troisième et dernière dissertation : « Que signifient les idéaux ascétiques ? »). En revanche, le rien (rem) est une affirmation : il a d’abord désigné le bien qu’on possède, la propriété dont on jouit, avant de désigner la « chose » (rem, plus tard supplantée par causa) dans sa plus grande généralité, si générale qu’elle en vient à supprimer l’existence sensible, donc nécessairement singulière, des objets divers qui meublent notre monde. Dans un monde vidé des objets qui l’encombrent, il n’y a plus « rien ». Mais en ce rien, il y a « quelque chose ». C’est cette « chose », sans doute, qui réjouit secrètement les personnages d’Ozu quand, se détournant l’un de l’autre et fixant parallèlement les lointains, mer ou ciel, sans regarder rien de précis, une discrète jouissance les illumine intérieurement, faisant naître sur le visage lisse l’esquisse d’un sourire. Il y a dans le néant occidental la violence d’un acte d’exclusion ; il y a dans le rien oriental une incompréhensible présence qui procure, à celui qui sait la contempler avec détachement, un contentement doux et profond.
L’humanisme néoréaliste : Umberto D.
Cette voie, dira-t-on, n’appartient qu’à l’orient, l’occident en est incapable, qui préférera toujours la volonté de néant au non-vouloir du rien, l’affirmation de la négation au détachement de la contemplation. De ses désillusions, de ses désenchantements, l’occident, incapable de renoncer au lyrisme des grands récits, fera toujours un drame, ou un roman. Pourtant, est-ce bien sûr ? N’est-ce pas précisément la rhétorique de la narration que le cinéma néoréaliste a voulu mettre entre parenthèses ? Et si le cinéma d’Ozu se rattache aussi naturellement à l’esthétique néoréaliste, n’est-ce pas parce que cette esthétique, qu’on ne saurait réduire au seul cinéma italien, avait déjà, et d’elle-même, une réelle affinité avec le regard oriental ? Cette pensée ne laisse-t-elle pas entrevoir qu’il existe un remède au désespoir, une consolation au nihilisme ? « Comment nous consoler, nous, meurtriers entre les meurtriers ? » demandait avec emphase le Nietzsche du Gai Savoir (1882, livre III, § 123 ; le meurtre dont il est ici question est celui dont Dieu est la victime…). Tournons-nous vers l’un des films les plus sombres, les plus désespérés du néoréalisme italien : Umberto D. de Vittorio De Sica (1952), qu’André Bazin considérait comme l’un des plus grands chefs-d’œuvre de l’histoire du cinéma (8). Umberto Domenico Ferrari, abrégé en « Umberto D. » qui réduit son second prénom à son initiale et qui escamote son nom, ce qui est déjà une manière de le vouer à l’anonymat, est un fonctionnaire du ministère des travaux publics, où il travailla pendant plus de trente ans, et qui se trouve maintenant à la retraite, avec une maigre pension qui lui permet à peine de subsister. Il vit à Rome, dans la pièce d’un appartement que lui loue sa propriétaire, pour un loyer qui dépasse ses moyens, et qu’il éprouve de plus en plus de difficultés à régler. Sa logeuse, qui souhaite épouser le directeur d’un cinéma voisin, le cinéma Iride (en italien : l’iris, ou l’arc-en-ciel), veut se débarrasser de cet encombrant locataire et se montre, pour le vieillard sans ressource, impitoyable. Umberto n’a d’autre soutien dans la vie qu’un petit terrier qui répond au nom de Flike (prononcer à l’américaine), ainsi qu’une petite bonne exploitée sans scrupule, Maria, qui s’attache à Umberto, la jeune fille reconnaissant dans le vieillard le dénuement qui est aussi le sien. Rien ne se passe dans ce film, sinon le temps, c'est-à-dire quantité de petits riens qui dépouillent progressivement le vieil homme de tous les secours sur lesquels il peut compter, le réduisent à la misère et l’acculent au suicide : deux fois Umberto tente de se tuer, la première en imaginant de se jeter par la fenêtre sur les pavés luisant de la via San Martino della Battaglia (9), la seconde en tentant de se jeter sous un train. L’une comme l’autre fois, c’est son chien qui le sauve du désespoir : la première fois, l’animal dormant en toute confiance sur le lit du vieil homme l’émeut et l’apitoie, et Umberto choisit de demeurer en vie pour ne pas abandonner ce petit être innocent ; la seconde fois, Umberto, tenant Flike dans ses bras, veut se précipiter sous les roues de l’express qui file en grand vacarme de l’autre côté du passage à niveau ; mais l’animal s’effraie et s’enfuit, arrachant ainsi son maître à l’attraction de la mort. Ce film, qui raconte l’histoire d’une inéluctable agonie, est d’une rare noirceur. D’où vient pourtant qu’il nous inspire un sentiment profond d’humanité, sans haine ni amertume, malgré l’indifférence des hommes, leur inconsciente cruauté qui abandonne Umberto à sa solitude, à sa vieillesse et à sa mort ? D’où vient la chaleureuse émotion qu’il nous transmet, alors qu’il ne devrait inspirer qu’une poignante désolation ? L’humanisme rayonnant de De Sica, l’amour qu’il voue à tous ses personnages, y est sans doute pour quelque chose, sans que nous comprenions pour autant ce mystère : comment peut-il y avoir une joie secrète dans ce désespoir sans issue ? De même que la fin du Voleur de bicyclette surmontait la détresse d’Antonio en faisant se joindre les deux mains du fils et du père, de même, mais de façon plus mystérieuse encore, la fin d’Umberto D. semble promettre une vague rédemption. Le vieillard, désormais sans domicile, vient échouer dans un jardin public où jouent les enfants. Après son suicide manqué, il tente d’amadouer Flike effrayé, et cherche à le faire revenir à lui en lui lançant une pomme de pain pour qu’il la lui rapporte. Ainsi disparaissent dans la profondeur de champ le vieillard et son chien jouant ensemble, parmi les enfants qui eux-mêmes jouent au ballon : tandis qu’Umberto s’éloigne, un groupe d’enfants se précipite en sens inverse vers la caméra en poursuivant un ballon, bientôt dissimulé par le mot « FINE » qui envahit tout l’écran.
Pourquoi faut-il que ce film s’achève dans un jardin où jouent des enfants ? Tout se passe comme si les seuls humains, dans un monde inhumain, étaient les chiens et les enfants. Non parce qu’ils sont meilleurs que les autres, au sens où ils seraient plus moraux, mais seulement parce qu’ils se contentent d’être au monde, de s’en étonner sans idée préconçue, et d’en jouir, heureux de ce que simplement le présent leur soit donné. Ce regard curieux, ouvert à tout ce qui passe dans le monde, regard du chien ou de l’enfant, c’est aussi celui de la caméra. Il y a dans l’étonnement avec lequel la caméra explore le visible, comme enfouie très secrètement, une consolation à l’infinie détresse d’Umberto. Cette joie du jeu, ce contentement du peu, cette curiosité du visible semblent la seule réponse de De Sica au nihilisme effrayant de ce film. Avec le chien Flike et les enfants qui jouent, une autre personne humaine habite le film de De Sica : c’est Maria, la petite bonne qui semble avoir été surtout choisie pour l’immensité de ses deux yeux noirs et toujours interrogatifs. Il y a en elle une vie secrète, toujours silencieuse mais que l’on pressent néanmoins intense, qui semble contredire le désespoir de la mort inéluctable. Enceinte de trois mois, sans bien savoir qui est le père de l'enfant et sans espoir de mariage, elle n’ose revenir au pays, redoutant la raclée de son père, ou de son frère. Ne disant rien mais comprenant tout, Maria jette sur le monde et les êtres un regard d’enfant, à la fois interrogatif et compréhensif. Elle est sœur du cinéaste, lui aussi en travail, sur le point d’enfanter son œuvre. La disparition finale d’Umberto jouant avec son chien, et l’apparition simultanée des enfants poursuivant un ballon, signifie sans doute que les jeunes prennent la relève des vieillards, et que, somme toute, la vie continue. Mais il ne s’agit pas seulement d’une répétition, plutôt de quelque chose qui ressemble à une renaissance, sinon à une résurrection. Tant que l’innocence d’un regard enfantin illuminera ce monde, tant qu’une caméra enregistrera son image lumineuse, la vie sera mystérieusement justifiée, comme si le grand œil ouvert de l’objectif sauvait ce monde du néant vers lequel il se dirige, comme si le regard des enfants, de la caméra, et de toutes les créatures qui savent prendre la vie comme elle vient, était le sel de la terre, en ce sens qu’il donnait à cette vie son goût et sa saveur. Le cinéma est un exercice d’admiration.
Les enfants dans le cinéma néoréaliste
Le regard qui sauve le monde est celui des créatures que la société met en dehors du jeu de la puissance et de la hiérarchie, les laissés-pour-compte, les déclassés : les chiens, les jeunes filles, exploitées comme employés de maison, enceintes de leur amant qui les abandonne, les vieillards à la retraite… mais aussi les cinéastes, qui se mettent d’eux-mêmes hors du monde pour mieux le filmer, comme s’il fallait s’extraire de la présence pour advenir à la re-présentation. La caméra-œil, à l’inverse du témoignage militant prôné par Dziga Vertov, n’est pas engagée dans le monde, mais se tient hors du monde, regard contemplatif du visible qui se déroule sous nos yeux. C’est ce même regard attentif et amical qui accompagne les personnages d’Ozu sur son petit théâtre de marionnettes. Ce regard est encore celui des enfants, en lequel Baudelaire avait su deviner, dès le milieu du XIXe siècle, la vérité de notre modernité et de son esthétique : « L’enfant voit tout en nouveauté ; il est toujours ivre. Rien ne ressemble plus à ce qu’on appelle l’inspiration, que la joie avec laquelle l’enfant absorbe la forme et la couleur […] Le génie n’est que l’enfance retrouvée à volonté, l’enfance douée maintenant, pour s’exprimer, d’organes virils et de l’esprit analytique qui lui permet d’ordonner la somme des matériaux involontairement amassés. C’est à cette curiosité profonde et joyeuse qu’il faut attribuer l’œil fixe et animalement extatique des enfants devant le nouveau, quel qu’il soit, visage ou paysage, lumière, dorure, couleurs, étoffes chatoyantes, enchantement de la beauté embellie par la toilette » (10). Il existe ainsi une sagesse du cinéma, qui nous sauve du nihilisme par la passion de la curiosité, la joie inépuisable de la contemplation esthétique, l’amour du visible tout entier. Telle est la raison pour laquelle les enfants, qui redoublent dans le film l’ingénuité du regard, la curiosité vorace de la caméra, sont les véritables héros du cinéma néoréaliste. Ce sont les gamins de Naples, dans le second épisode du Païsa (1946) de Rossellini : l’un d’entre eux, mélange de rouerie et d’innocence, cherche à se faire un copain d’un grand GI ivre, un noir, tous deux se reconnaissant par leur commune exclusion, mais l’enfant va-nu-pieds n’hésitant pas, quand l’autre finit par tomber de sommeil, à lui voler ses chaussures ; ou bien la même année, dans Naples occupée par les Américains, d’autres gamins misérables qui subsistent par combinazione et marché noir, les « Sciuscia » (de « shoe shine », le cri qu’ils lancent à l’adresse des passants) qui cirent pour trois sous les chaussures des riches – en ces temps de pénurie extrême, une paire de chaussures en cuir est un luxe inestimable – Giuseppe et Pasquale dont l’aventure commence par l’ivresse d’une cavalcade lancée au galop, et qui se termine tragiquement par la prison et la mort (Vittorio De Sica, 1946). A cette enfance martyre, abandonnée du père, répond une autre enfance, adossée au modèle paternel, faisant l’apprentissage de son autonomie et sur le point de devenir adulte, tel Bruno, fils d’Antonio, le voleur de bicyclettes (Vittorio De Sica, 1948). Ce regard enfantin, toujours avide de vivre et que le présent seul passionne, c’est encore le regard de François d’Assise dans les Onze Fioretti de Rossellini (1950), un film aimé de Truffaut qui comparait les courses des moines dans les prés fleuris de l’Ombrie aux jeux et gambades des enfants dans une cour de récréation ; auquel il faudrait joindre sa transcription joyeuse en fable indifféremment marxiste ou franciscaine par Pasolini, dans Les Oiseaux petits et grands (Uccellacci e uccellini, 1966). Ce sont encore les enfants qui sauvent le triste fonctionnaire Watanabe, surnommé par ses collègues « la momie », qui, apprenant qu’un cancer ne lui laisse que quelques mois à vivre, décide de consacrer toute l’énergie qui lui reste à la réalisation d’un parc où pourront jouer les gamins dans un quartier déshérité de Tokyo. Cet Umberto D. japonais meurt doucement, bercé sur une balançoire, redevenu enfant, seul la nuit dans le parc enfin réalisé, murmurant un refrain populaire qui chante la vie brève et l’amour éphémère (Akira Kurosawa, Vivre, 1952). Ce sont les chants d’enfants qui animent et illuminent le magnifique film de Keisuke Kinoshita, qui mériterait d’être mieux connu et reconnu : ces Vingt-quatre prunelles (1954), ce sont celles des douze élèves d’une institutrice nommée dans un village perdu de la mer intérieure du Japon, et auxquels elle communiquera sa joie de vivre. Ces enfants, auxquels la jeune femme tient comme à la prunelle de ses yeux, joyeusement réunis pour une photo de classe, seront désunis par la guerre pour les garçons – tuant les uns, faisant des autres des infirmes – par la vie pour les filles – mal mariées ou réduites en servitude par la misère. « Avec le temps, va, tout s’en va », mais demeure pourtant la joie d’être ensemble, comme une enfance préservée, quand se réunissent les survivants par-delà les épreuves traversées. Et l’on retrouve le même émerveillement enfantin l’année suivante, avec le Pather Pantchali de Satyajit Ray (La complainte du sentier, 1955) : la grande misère de la famille d’un brahmane, dans le Bengale des années vingt, est transfigurée par le lyrisme, l’innocence et la grâce du regard, celui du jeune Apu, héros d’une trilogie, méditation rêveuse et contemplative sur le chemin de vie et le destin des hommes (ce film consacré à l’enfance se poursuit avec la jeunesse : L’Invaincu ou Aparajito, 1956 ; puis avec la maturité : Le monde d’Apu ou Apur Sansar, 1959). Satyajit Ray a confié qu’il était venu à la réalisation à la suite de l’éblouissement qu’il avait éprouvé lors d’une projection du Voleur de bicyclettes : il existe donc un néoréalisme bengali comme il existe un néoréalisme italien, comme il existe un néoréalisme japonais, et bien d’autres encore, tous réunis dans un même lyrisme qui réussit à dépasser l’effondrement moral de l’après-guerre par l’intensité d’un regard attentif, à la fois grave et léger, aux riens de l’existence, au présent du présent, à la splendeur toujours passagère du monde flottant, l’ukiyô-e de « l’époque Edo » (1603-1868) qui précède heureusement l’ouverture à l’occident ou « ère Meiji » (1868-1912). Mais le regard de l’enfance ne se résume pas à cette contemplation admirative et muette, il se fait aussi pénétrant et même impitoyable quand il accède à la révolte de l’adolescence. Tel le regard de Monika (Harriet Andersson) dans le film de Bergman (Un été avec Monika, ou Monika et le désir, Sommaren med Monika, 1953), jeune fugueuse en rupture de ban qui, fixant longuement la caméra avec des yeux également brillants de défi et embués de larmes, revendique son entière liberté et ne veut rien renier de ses actes. Il faudrait lui joindre son double masculin, le jeune Antoine Doinel des 400 coups (Truffaut, 1959) – c’est précisément une photo de Monika-la-provocante qu’Antoine et son ami René volent à l’entrée d’un cinéma (on affichait alors, pour faire rêver les passants et mieux les appâter, les photos de plateau du film sous des vitrines qui donnaient sur la rue) – autre fugueur en divorce de sa famille qui, derrière les grilles d’une camionnette de la police qui le conduit en maison de correction, tournera vers les spectateurs le même regard insistant, où se mêlent indistinctement le défi et la détresse, le mépris et la demande d’amour. On connaît la fin magnifique de ce grand film : le jeune adolescent, réussissant une évasion qu’on pressent de courte durée, se lance, en un long et merveilleux travelling, dans une course éperdue qui le conduit à la mer. Cette « FIN » est une ouverture, sur l’immensité – plage, mer, ciel – qui est aussi bien un territoire du vide, un royaume du rien que la promesse de la liberté, ou le lieu d’un embarquement pour l’ailleurs. En tournant ce film, François Truffaut tourne avec le regard d’Antoine, qui est aussi celui de sa propre enfance, à la fois naïf et lucide, passionné et désarmé, et c’est la qualité de ce regard qui nous permet de reconnaître, dans les 400 coups, l’une des œuvres majeures du cinéma néoréaliste.
Le cinéma d’Ozu
Nous pourrions prolonger longuement ce passage en revue. Mieux vaut revenir pour terminer à l’art de Yasujiro Ozu, que nous n’avons fait qu’évoquer, sans doute l’un des cinéastes les plus remarquables, les plus originaux aussi, de la veine néoréaliste. On se plaît à souligner l’exotisme de son art, qui nous est pourtant plus proche que nous voulons bien le dire. Point n’est besoin de pénétrer les mystérieuses arcanes de « l’âme japonaise » pour en apprécier la saveur : Ozu parle à tous les hommes, dans le cours le plus ordinaire de leur existence, en tant qu’ils sont des êtres sensibles et pensant qui passent dans le Temps. Bien que spécifiquement japonais, il n’y a rien, en ce regard, qui nous soit étranger.
L’homme se trouve, on ne sait pourquoi – puisque cette histoire n’a pas de sens – situé dans un monde qui est un vaste non-sens. Au Japon, la terre est toujours une île, c'est-à-dire une étendue qui émerge incompréhensiblement – les tremblements de terre en font parfois apparaître une nouvelle ou disparaître une ancienne – de l’étendue horizontale, illimité et scintillante – ce tremblement de la lumière qui nous fait cligner des yeux et qui ressemble lui-même à un clignement d’yeux – de la mer toujours recommencée. Claudel : « Tout est île au Japon, tout émerge de quelque chose » (11). Aussi s’étonne-t-on de ce qu’il y ait ici quelque chose et non pas plutôt rien. Non qu’il faille nous résigner au poids accablant de l’Absurde : le silence du monde, la neutralité de son cours, l’indifférence des choses sont plutôt des grâces qui nous sont accordées, le vaste monde ayant la politesse de s’effacer pour que nous puissions venir nous y loger, y laisser notre trace. Ainsi faut-il d’abord fabriquer le rouleau de soie blanche pour que le lettré puisse venir ensuite calligraphier librement sur cette surface vierge les idéogrammes du poème. La page blanche n’inspire aucune angoisse, elle est au contraire heureuse, et c’est la page saturée par les graffitis du phantasme qui nous bouche la vue et nous empêche d’écrire. Au Japon, qui est un archipel fait de milliers d’îles, la densité démographique est très élevée, d’autant que la population est concentrée sur les côtes, les massifs montagneux demeurant inhabitables. Aussi les espaces cultivés sont-ils saturés de signes, ils s’élèvent sur le flanc des montagnes jusqu’à la limite extrême des terres arables, recouvrant le paysage de leur écriture ténue, à la façon du trait sinueux que dessinent en Asie les terrasses des rizières comme autant de lignes de niveau, les villes offrant de même le spectacle d’un invraisemblable enchevêtrement de panneaux indicateurs, comme s’il fallait cet excès de signifiant pour suppléer à l’universelle insignifiance, tandis que les espaces sauvages – montagne, ciel et mer – conservent leur virginité, espaces libres, ouvert pour un avenir encore indéterminé. Dans l’insignifiance du monde sauvage vibre la promesse de tous les possibles. Et c’est ainsi que le vide est plus dense que le plein, le rien plus exaltant que la profusion et le dénuement plus riche que l’abondance. N’ayons donc pas peur du vide : il est le plus accueillant de tous les hôtes.
Mais l’homme se détourne de ce visage sans regard, de cette immensité muette, désorienté par le « rien », pris de vertige dès qu’il prend conscience qu’il est en ce lieu sans point d’appui pour s’assurer, sans garde-fou pour se retenir. Pourtant, le vide est accueillant à celui qui, surmontant son étourdissement, s’aventure en son sein : ainsi dans la peinture chinoise, le bienheureux ermite immobile, vertigineusement perché, qui contemple longuement le poème de l’eau et de la montagne. Mais le Sage est un homme d’exception, et les hommes ordinaires préfèrent se blottir au cœur emboîté de la maison, parlant avec leurs amis de choses sans importance, buvant le thé, faisant les comptes, préparant méticuleusement la cuisine – qui est une offrande à la famille réunie – ou repassant soigneusement des linges qui seront ensuite empilés dans des armoires composées d’un nombre étonnant de tiroirs. Il faut à l’homme un repère pour trouver son chemin, un sol ferme et constant pour construire sa maison. Au grand Vide du monde, ouvert à l’indéfini, s’opposera donc le lieu rigoureusement borné et clos de l’habitat. La maison japonaise est un système extravagant de boîtes multiples imbriquées les unes dans les autres, à la façon des poupées gigogne. Pour se détourner du grand « rien », qui est la Mère, autre nom du Tao (12), dont l’univers est l’enfant, il importe de se caser au plus vite. C’est même une obsession dans le cinéma d’Ozu : ses personnages sont toujours affairés à se trouver un toit, un emploi, à s’enfermer dans un bureau, à se trouver un époux, une femme, à entrer dans la vie de couple comme dans un cercle dont on ne sortira jamais. Cette maison, toute en horizontales et verticales, comme une toile de Mondrian qui serait indéfiniment amovible, ou bien encore comme un jeu de go dont les habitants seraient les pions, et dont les cases pourraient glisser les unes à la place des autres comme au jeu de pousse-pousse, laisse pourtant au hasard l’espace de son jeu : les panneaux coulissants (shoji) font de l’intérieur un théâtre constant ponctué d’entrées en scène toujours imprévisibles, mais annoncées par une discrète sonnette, qui sonne tout autant dans la mémoire d’Ozu que, dans la mémoire du narrateur, celle que fait vibrer Swann en visite à Combray. Les pièces ne sont jamais bien définies, tantôt salle à manger, salon pour prendre le thé ou fumoir pour lire le journal. La maison elle-même n’est pas homogène, elle conjugue des milieux distincts qu’il faut veiller à maintenir séparés : le rez-de-chaussée est un espace plutôt réservé aux hommes, à l’exception de la mère qui tient du mariage le privilège de venir habiter au plus près du sol, mais dont le lieu propre est surtout la cuisine, de laquelle elle apporte quantité de petits plats gourmands, délicatement préparés dans lesquels on picore du bout de la baguette tout en causant des petites choses de la vie (puisque, des grandes, de quelque façon qu’on s’y prenne, on ne peut rien dire). Au premier étage se trouve la chambre des jeunes filles, qui y reçoivent leurs amies pour des confidences et des éclats de rire, toujours étouffés par discrétion, où la mère monte leur faire la leçon quand elles ont dérogé aux bienséances. Entre les deux, assurant la liaison contrôlée des deux niveaux, un escalier de bois luisant presque aussi raide qu’une échelle. Ozu ne le montre jamais, comme s’il était le passage secret et mystérieux entre les deux mondes, le masculin où l’on tue le temps en buvant du saké, et le féminin où l’on boit le thé en grignotant des petits gâteaux. Il n’y a qu’à la fin du Goût du saké (1962), le dernier film d’Ozu, que la caméra s’attarde sur l’escalier devenu désert (ce qu’on appelle encore un « plan vide »), le père venant de marier sa fille – Charles Tesson remarquait justement que rien ne ressemble plus chez Ozu à un mariage qu’un enterrement – rentrant seul dans la maison et, doublement veuf, rêvant mélancoliquement devant cet escalier que sa fille plus jamais ne descendra. Dans cet intérieur aux régions si rigoureusement définies, aux lieux si strictement limités, le rituel de la vie quotidienne est réglé comme du papier à musique : courbettes réciproques – chacun étant comme l’image en miroir de son hôte – pour le bonjour du voisin, courbettes pour remercier d’un cadeau (toujours extraordinairement empaqueté, même si, une fois dépouillé de toutes ses enveloppes, on constate qu’il ne contient rien, ou presque rien) (13). Comme on le dit très bien : « c’est le geste qui compte », et cela n’est jamais aussi vrai qu’au Japon, où la perfection du geste, par exemple pour la préparation du thé, fait l’essentiel du rituel de la vie quotidienne. Visites aux voisins qui se formaliseraient si l’on ne venait leur présenter la cousine venue faire un séjour ou l’étranger de passage, ce qui offre l’occasion de nouvelles courbettes. Chaque « bonjour » obéit ainsi à une méticuleuse mise en scène sur ce théâtre du banal. Chaque repas a sa liturgie, le bain – que les enfants prennent parfois ensemble, ou le père avec le fils – conclut invariablement la journée, tandis qu’habillages et déshabillages marquent les transformations des acteurs selon le masque qu’ils empruntent – costume gris pour le bureau, uniformes sombres d’écoliers pour les enfants, kimono d’intérieur en fin de journée, et pour les mariages : habit de cérémonie à queue de pie, haut de forme et gilet noir pour les hommes et kimonos ornés de fleurs aux couleurs vives pour les femmes ; et pour les enterrements : le même costume, exactement, pour les hommes mais kimono noir pour les femmes.
Ainsi deux temples se distinguent : le temple de la Clôture, sur lequel veille l’autel des ancêtres (non pas au centre mais plutôt dans une pièce latérale : l’orient est centrifuge, à l’inverse de l’occident toujours centripète) ; et le temple de l’Ouvert, grand vide que seule habite la lumière, espace sacré si l’on veut, mais en ce sens que l’homme ici ne se rappelle à notre attention que par la perfection de son absence. Contraires, ils sont pourtant en harmonie plutôt qu’en opposition. C’est ainsi que la maison s’inscrit toujours dans un site, elle accompagne le paysage qui veut bien le recevoir. Claudel remarquait en ce sens que l’accent circonflexe du toit situe le temple japonais dans le paysage, il se relève en se recourbant comme pour envelopper l’atmosphère qui l’enveloppe : « Le toit japonais, c’est la géométrie éludée par l’aile ! […] Le triangle du fronton grec est fermé. Celui-ci est ouvert ! Les deux lignes divergentes se recourbent et se relèvent légèrement créant au-dessous d’elles un vide qui attire à lui tout l’édifice dont elles sont la base en l’air et non pas le couronnement. Le fronton grec est taillé dans un marbre inerte, il est la force du poids, mais ici nous avons un triangle végétal et vivant, quelque chose d’autonome. Ce n’est pas le faîte en qui se consomme la montée, c’est tout l’édifice qui est suspendu hors de la réalité ; féérique, soustrait au travail » (14). Et la maison elle-même, dont les parois intérieures sont en papier coloré, vibre dans le vent comme si elle participait de la vie qui anime le paysage et fait au dehors incliner les feuillages. Augustin Berque remarquait que la maison occidentale est d’abord une façade qui s’affiche dans la rue, proclamant extérieurement le rang et la dignité des personnages qui l’habitent. Mais une fois franchi le seuil, la maison occidentale est un domaine privé, soustrait aux regards étrangers, un intérieur qui se recueille sur son propre secret ; inversement la maison japonaise offre un extérieur indifférent et neutre, qui préserve l’anonymat de ses habitants, tandis que c’est l’intérieur qui cette fois s’ouvre sur l’extérieur, par les fenêtres qui donnent sur la mer ou la montagne, la porte qui donne sur la rue et les petits manèges des voisins. Chacun de ces ajours pratique une trouée de lumière dans l’enclos sombre de la maison de bois. Ozu en joue parfois, Kore-eda, son élève le plus doué, encore trop peu connu en France, sait utiliser merveilleusement ces percées éclatantes sur l’ailleurs. Ainsi, le Vide est présent dans la maison par les ouvertures qu’elle aménage, et la maison est présente dans le Vide par son inscription harmonieuse dans la chorégraphie du paysage.
Il y a pourtant des moments où l’harmonie de cette cohabitation est rompue : l’immensité de l’espace, qui est aussi le puits du temps, s’introduit alors à l’improviste dans l’espace protégé de la maison, et les habitants fuient leur refuge éventré et s’en vont errant sur un sentier perdu, ou le long de la plage (Kore-eda, Maboroshi, 1995) ; chez Ozu, dont le théâtre se situe le plus souvent au cœur des grandes villes, ils se dirigent plus simplement vers le bar d’à côté, et noient tristement leur chagrin dans le goût du saké. Ces ruptures, dont on ne peut dire qu’elles soient vraiment dramatiques, et qui s’opposent par là au renversement dont Aristote fait le pivot de l’action tragique, résultent simplement du cours ordinaire de l’existence : le départ d’un fils ou d’une fille qui se marie, la venue inopinée d’un visiteur, la mort d’un père, d’une mère, d’un enfant, d’un ami. Ces pauses interrompent un instant la petite ritournelle de la vie quotidienne (on reconnaît dès le générique un film d’Ozu à sa musique, vaguement américaine mais en aucun cas japonaise, musique légère qui fait un fond sonore et insignifiant, sinon insipide, aux épisodes eux-mêmes insignifiants, mais bouleversants pourtant pour ceux qui les vivent, de ce cérémonial du familier) et troublent la quiétude du monde fini par l’irruption de l’univers infini, qui est le « Rien ».
Il faudrait pour finir évoquer deux films, à mes yeux les deux chefs-d’œuvre d’Ozu, Printemps tardif de 1949 et Le Voyage à Tokyo de 1953.
Printemps tardif (1949)
Dans le premier, Printemps tardif, un père veuf (Chishū Ryū) qui vit avec sa fille (Setsuko Hara) voit avec appréhension son départ prochain. Malgré la tristesse que lui inspire cette séparation, il réussit, un peu malgré elle, à la convaincre de se marier. Le soir de la cérémonie, il rentre seul chez lui, contemple tristement l’escalier désert qui conduit à la chambre de la jeune fille, où le miroir qu’illuminait son regard, désormais terni, ne réfléchit plus que l’ombre dense. La maison se transforme en une sorte de tombe, hantée par le fantôme de l’Absente. Le père, las, s’assoit, prend une pomme qu’il pèle en en déroulant la peau, à la façon de ces citrons à moitié pelés et dont l’écorce tombe comme un ressort détendu, qu’on voit sur les natures mortes hollandaises du Siècle d’Or. En tournant le fruit entre ses doigts, le père semble tourner la sphère du temps, et sombre bientôt dans le sommeil. Il y a dans ce film une scène extraordinaire : le père et la fille font ensemble un dernier voyage, à Kyoto, avant la séparation du mariage, une sorte de voyage de noces qui dissone avec le théâtre si policé et si pudique de la vie japonaise. Dans l’auberge qui les loge, ils dorment, ce qui est presque inconcevable, dans la même chambre (on imagine que son père, un universitaire dont on aperçoit un instant, parmi les livres qu’il emporte dans son voyage, qu’il lit Ainsi parlait Zarathoustra, a les idées larges et méprise les convenances). La fille, qui n’a aucune envie de se marier et qui éprouve pour son père, un homme doux et attentif, un attachement extraordinaire, veut lui en faire l’aveu, alors que tous deux sont étendus sous leurs couettes parallèles. Mais le père s’est endormi – à moins qu’il ne feigne le sommeil – et la phrase commencée expire sur les lèvres de la jeune fille. Suit alors un plan extraordinaire, que tous les amoureux d’Ozu connaissent bien et qui a donné lieu à un grand nombre de commentaires : devant le panneau coulissant qui ferme la chambre, et la fenêtre illuminée par la clarté de la lune – écran sur lequel les bambous oscillant dans la brise projettent leur ombre chinoise – sur le tokonoma, petite alcôve surélevée dans laquelle on expose des objets d’art – bouquets (ikebana), estampes ou calligraphies – se dresse un vase magnifique qui repose en silence. C’est sur cette scène, qui correspond à ce qu’en occident, ou du moins en français, on appelle une « nature morte », que vient se fixer le regard rêveur de la jeune fille. Il paraît que les Européens voient dans ce « plan vide » qui se prolonge quelques secondes la forme parfaite du vase, tandis que les Japonais voient plutôt la fenêtre qui s’ouvre sur la lumière lunaire qui baigne l’extérieur. Peu importe, puisque la vacuité du dehors et la forme du dedans se conjuguent parfaitement. Un vase, qui n’est en Orient aucunement utilitaire (à l’inverse par exemple des vases grecs, dont chaque forme est adaptée à son usage), est une pure œuvre d’art qu’il faut considérer comme une métaphore de l’âme. Cet appareil à contenir du vide ne se ménage un intérieur qu’à la condition de s’ouvrir sur un extérieur : la corolle est la bouche qui s’ouvre pour l’inspiration, le col est la gorge qui déglutit pour ingérer le souffle et la panse, où s’emmagasinent pensées et désirs, est l’alambic qui rumine et distille les idées qui viennent à l’esprit (15). Dans Printemps tardif, le vase médite dans la pénombre tamisée de la chambre : la courbe de ses flancs fait songer à ce qu’on veut dire d’une belle femme – Setsuko Hara est une belle femme – quand on dit qu’elle est « bien balancée » ; mais c’est surtout la corolle qui attire l’attention : haute et large, elle se dilate pour absorber la lumière magique de cette nuit de pleine lune, pour boire le silence en lequel flotte l’ombre des bambous. Comme si le théâtre d'ombres qui tremble sous la lune venait religieusement se déverser, par l'ouverture de son col extravasé, de sa bouche altérée, dans le vase pansu, pour s'y recueillir et se mettre en dépôt. Ainsi la jeune fille digère dans la nuit l’aveu retenu de son amour incestueux, elle savoure secrètement l’enchantement suspendu d’un intense présent.
.png)
Printemps tardif (1949), Le vase sur le tokonoma
Elle sera plus explicite le matin venu, déclarant à son père la force du lien qui la retient à lui ainsi que son peu d’appétence pour le mariage. Cette sincérité lui vaudra un sermon paternel qui se résume à peu de choses : la vie des hommes est exposée, irrémédiablement, à ces déchirures qui ouvrent une brèche par laquelle s’engouffre l’infini dans le petit monde trop ordonné de nos habitudes, de notre habitat. La douleur que nous ressentons alors, comme après toute rupture d’un lien puissant, est la douleur du temps et de la mort, car, contrairement à ce qu’enseigne un moment Montaigne, quitte à se réfuter aussitôt – que nous ne pouvons faire l’expérience de la mort, puisque nous ne sommes plus là quand elle est venue (16) – c’est bien le sentiment de la mort qui, à chaque rupture, saisit le vif. Dans le vertige de l’abandon, il nous est donné de vivre notre mort. Le monde clos, endogamique, de la famille ozuienne, s’évase alors sur le Vide ou le Rien, non parce qu’il est survenu une extraordinaire et tragique catastrophe, mais plus simplement parce qu’à l’occasion de l’événement, nous nous ressouvenons que nous sommes mortels.
Le Voyage à Tokyo (1953)
Quatre ans plus tard, Le Voyage à Tokyo (en japonais : Tokyo monogatari, c'est-à-dire un conte, un récit sur Tokyo) raconte une autre histoire, qui est au fond la même histoire : un couple de grands-parents, maintenant à la retraite (Chishū Ryū est le grand père), vivent à Onomichi, une jolie petite ville côtière sur la mer intérieure. Ils décident de rendre visite à leurs enfants, qui sont installés à Tokyo, le fils exerçant la médecine, la fille tenant un salon de coiffure. Après des vues plongeantes sur Onomichi, au cours desquelles on entend le bruit depuis la mer des bateaux à moteur dont le teuf-teuf évoque le tic-tac d’une montre, où l’on voit filer les trains comme passe le temps, on entre dans la maison et on assiste aux préparatifs du voyage. Chez Ozu comme ailleurs, tout voyage est un départ, et partir c’est toujours mourir un peu. Quand le vieux couple arrive, fatigués par le voyage en train, dans la capitale, c’est pour constater que leurs enfants, débordés par leur travail, n’ont guère le temps de les recevoir, moins encore de s’occuper d’eux, tandis que le petit fils se désintéresse de ces vieillards étrangers à son monde. Seule Noriko (Setsuko Hara), leur bru devenue veuve, prend sur son temps de travail et se consacre à ses beaux parents, avec générosité et bonne humeur, par réelle affection mais aussi en mémoire de son époux mort il y a huit ans à la guerre. Tous trois font un tour dans la capitale, ballottés dans un bus de tourisme comme ils le sont chaque jour par les heurts imperceptibles qui estompent lentement nos plus chers souvenirs, mais heureux d'un moment de grâce qui naît de la concorde des âmes. C’est alors que, pour se débarrasser de leurs parents encombrants, les enfants décident de les envoyer dans une station balnéaire, Atami, surtout fréquentée par les jeunes gens. Les vieux parents, un peu étonnés de se retrouver là, où ils ne souhaitaient nullement aller, dérangés par le vacarme que font de jeunes fêtards dans l’auberge, ne ferment pas l’œil de la nuit. Au matin, dans une séquence sublime, ils s’assoient tous deux sur le bord de mer et demeurent là, à contempler en silence la mer scintillante, comme flamboyante de soleil : béatitude de cette méditation sur le grand Vide en lequel vibre la durée et se conçoivent tous les possibles. Pensée de l’éternité, qui est la mer allée avec le soleil. « Temple du Temps, qu'un seul soupir résume... »
.jpg)
Le voyage à Tokyo (1953), Méditation devant la mer
Comme au seuil de l’autre monde, la grand-mère a, devant la mer, le pressentiment de sa propre mort : un malaise passager la saisit, qui se révèlera par la suite être le premier symptôme d’un mal incurable. Mais la contemplation leur porte conseil puisque, prenant conscience de l’indifférence regrettable de leurs enfants, ils décident de s’en retourner chez eux, où ils seront du moins confortablement installés. Sur le chemin du retour, le malaise ressenti par la grand-mère à Atima se révèle prophétique : la vieille femme tombe sérieusement malade, et finit par mourir après une longue et silencieuse agonie, chez elle, de retour à Onomichi, et alors que les enfants, ennuyés d’interrompre leurs activités, doivent à leur tour faire le voyage. Seules Noriko, et Kyoko, leur fille qui vit encore avec ses parents à Onomichi, partagent véritablement la douleur du vieil homme, désormais veuf. Le matin de la mort de la grand-mère, le grand père s’avance, le visage presque toujours souriant et comme étonné de ce qui survient sans qu’on puisse le comprendre, sur une terrasse qui domine la mer. On aperçoit non loin les stèles d’un cimetière marin. Le temps est au beau fixe, l’azur est impeccable. Noriko, la bru au cœur d’or, vient le rejoindre pour lui annoncer qu’un autre de ses fils, retardé, est sur le point d’arriver. Le vieillard, qui joue le rôle d’un père pour la jeune femme (elle l’appelle « Père ! » en se dirigeant vers lui pour le tirer de sa rêverie), de même que la bru est pour le vieux couple comme l’enfant qu’ils auraient aimé avoir, semble ne pas entendre la nouvelle qu’il reçoit. Avec un étrange sourire qui illumine son visage, le regard tourné vers l’horizon, perdu dans la contemplation des lointains lumineux, le regard parallèle à celui de Noriko, debout comme lui, et tournée aussi vers le matin commençant, le vieillard prononce alors ces mots à la fois insolites et banals : « Ah ! C’était un bien beau lever de soleil… Ça va encore chauffer aujourd’hui… » La jeune fille et le vieillard sont alors comme deux orants qui célèbrent la venue de la lumière, soit ce qui demeure de ce monde quand on l’a débarrassé de tous les objets qui l’encombrent. Ils sont à l’écoute du champ magnétique qui vibre dans l’univers, le bruit de fond qui est la Mère de toutes choses. C’est ainsi que la méditation sur le Vide, la lumière qui palpite en lui, le tremblement de la durée dans la profondeur, est une incompréhensible source de joie, un remède à la mélancolie et un baume pour la douleur du deuil.
Grâce à Ozu, grand maître d’un néoréalisme oriental, nous savons qu’il existe aussi un nihilisme heureux.
.jpg)
Le voyage à Tokyo (1953), Prière devant le soleil levant
*****
NOTES
1- C’est ce que dit Rocco lui-même, dans un moment de nostalgie, lors de la fête qui célèbre sa victoire après un match important, et alors que les frères sont rassemblés autour de la mamma, à l’exception toutefois de Simone l’assassin, qui viendra briser, dès le dernier mot prononcé par Rocco, le cercle de famille : « Un jour viendra, dit Rocco, mais c’est encore loin, où je retournerai au pays. Et si ce n’est pas moi, un de nous pourra y retourner. Peut-être toi Luca, dit-il en s’adressant à son plus jeune frère. Souviens-toi : notre pays est celui des olives, des coups de lune et des arcs-en-ciel. Tu te souviens, Vincenzo ? Le contremaître qui construit une maison, il jette une pierre sur l’ombre du premier qui passe. » « Pourquoi ? » demande Luca. « En sacrifice. Pour que la maison soit solide. » La pierre jetée en sacrifice, c’est Rocco lui-même, qui se destine à la carrière d’un champion de boxe, non de bon gré, mais pour payer les dettes de son frère. Et la maison qu’il faut construire solide, c’est cette famille, dont le père est absent et dont l’âme est la mère, la famille Parondi qui se désagrège loin de sa Lucanie ancestrale, perdue dans la grande ville du nord.
2- Dans son bel article, « Présence de Vittorio De Sica », Henri Agel évoque les critiques alors adressées au metteur en scène : « Les griefs que l’opinion formulait à l’endroit de Vittorio De Sica, Jean Tulard les rappelle dans son Dictionnaire : “Sensiblerie, exploitation abusive des enfants, misérabilisme, absence d’esprit révolutionnaire”. Et nombreux étaient ceux qui créditaient le seul Zavattini, coéquipier dès les premiers jours, des mérites qu’on pouvait attribuer aux films de 1946 à 1956 » (CinémAction, Le Néoréalisme italien, n° 70, janvier 1994, p. 139)
3- Michel Foucault, Les mots et les choses. Une archéologie des sciences humaines, Gallimard, 1966, p. 398.
4- « Fragments de l’automne 1885 à l’automne 1886 », in Fragments posthumes, automne 85 – automne 87, Œuvres philosophiques complètes, textes établis et annotés par Giorgio Colli et Mazzino Montinari, tome XII, Gallimard, 1978, p. 129 (fragment n° 2 [127]).
5- Généalogie de la morale, III, 26 ; in Œuvres philosophiques complètes, textes établis par Giorgio Colli et Mazzino Montinari, tome VII, Galllimard, 1971, p. 342.
6- Lettre à Louise Colet du 16 janvier 1852 ; dans Flaubert, Correspondance, édition établie par Jean Bruneau, « Bibliothèque de la Pléiade », tome II, juillet 1851-décembre 1858, Gallimard, 1980, p. 31. Voici la citation dans son contexte : « Je t’ai dit que l’Éducation avait été un essai. Saint Antoine en est un autre. Prenant un sujet où j’étais entièrement libre comme lyrisme, mouvements, désordonnements, je me trouvais alors bien dans ma nature et je n’avais qu’à aller. Jamais je ne retrouverai des éperdûments de style comme je m’en suis donné là pendant dix-huit grands mois. Comme je taillais avec cœur les perles de mon collier ! Je n’y ai oublié qu’une chose, c’est le fil. Seconde tentative et pis encore que la première. Maintenant j’en suis à ma troisième. Il est pourtant temps de réussir ou de se jeter par la fenêtre. Ce qui me semble beau, ce que je voudrais faire, c’est un livre sur rien, un livre sans attache extérieure, qui se tiendrait de lui-même par la force interne de son style, comme la terre sans être soutenue se tient en l’air, un livre qui n’aurait presque pas de sujet ou du moins où le sujet serait presque invisible, si cela se peut. Les œuvres les plus belles sont celles où il y a le moins de matière ; plus l’expression se rapproche de la pensée, plus le mot colle dessus et disparaît, plus c’est beau. Je crois que l’avenir de l’Art est dans ces voies. Je le vois, à mesure qu’il grandit, s’éthérisant tant qu’il peut, depuis les pylônes égyptiens jusqu’aux lancettes gothiques, et depuis les poèmes de vingt mille vers des indiens jusqu’aux jets de Byron. La forme, en devenant habile, s’atténue ; elle quitte toute liturgie, toute règle, toute mesure ; elle abandonne l’épique pour le roman, le vers pour la prose ; elle ne se connaît plus d’orthodoxie et est libre comme chaque volonté qui la produit. Cet affranchissement de la matérialité se retrouve en tout et les gouvernements l’ont suivi, depuis les despotismes orientaux jusqu’aux socialismes futurs. C’est pour cela qu’il n’y a ni beaux ni vilains sujets et qu’on pourrait presque établir comme axiome, en se posant au point de vue de l’Art pur, qu’il n’y en a aucun, le style étant à lui tout seul une manière absolue de voir les choses. »
7- Le shamisen est un instrument de musique japonais, une sorte de luth traditionnel muni de trois cordes.
8- « Il s’agit d’un des films les plus révolutionnaires et les plus courageux non seulement du cinéma italien, mais de la production européenne de ces deux dernières années, d’un pur chef-d’œuvre que l’histoire du cinéma consacrera à coup sûr » (« Une grande œuvre : Umberto D. », France-Observateur, octobre 1952 ; repris dans André Bazin, Qu’est-ce que le cinéma ?, Cerf, 2002, p. 331). Je confesse partager cette appréciation.
9- Quand il demande à être hospitalisé, Umberto donne son adresse aux infirmiers qui doivent le conduire en ambulance : 14 rue San Martino della Battaglia, 3ème étage. La rue San Martino se trouve à l’est du centre, entre la gare Termini et la bibliothèque nationale. Le cinéma Iride, qui fut l’un des tout premiers cinémas de Rome, se trouvait au contraire en plein centre, à l’angle de la via del Corso et de la via Pietra, non loin du temple d’Hadrien devant lequel Umberto laisse à son chien la honte de faire l’aumône, et à côté du Panthéon, devant lequel il rencontre ses anciens collègues du ministère du travail. Pourtant, quand Umberto sort de chez lui, il se trouve immédiatement devant le cinéma Iride. Le télescopage de ces deux lieux est donc prémédité par De Sica, souhaitant ainsi rendre hommage, contre les exigences de la topologie, à ce qui fut l’un des temples romains du cinéma muet.
10- Le Peintre de la vie moderne (1863), « III- L’artiste, homme du monde, homme des foules et enfant », in Charles Baudelaire, Œuvres complètes, « Bibliothèque de la Pléiade », Gallimard, 1961, p. 1159.
11- Claudel, Le poète et le shamisen, in Œuvres en prose, « Bibliothèque de la Pléiade », Gallimard, 1965, p. 824.
12- Claudel, Le poète et le vase d’encens, in Œuvres en prose, « Bibliothèque de la Pléiade », Gallimard, 1965, p. 845 : « Le vase d’encens. – Lao Tzeu a dit : “Tous les hommes ont leur sphère d’action, moi seul je suis incapable. Et ainsi, je suis différent des autres hommes, mais la chose que j’apprécie est la Mère”. Le poète. – “Qu’appelle-t-il la Mère ?” Le vase d’encens. – “Le Tao naturellement”. Le poète. – “Qu’est-ce que le Tao ?” Le vase d’encens. – “Essaye de te débrouiller dans la bouffée que je t’envoie”. Le poète. – “Au-dessous de toutes les formes, ce qui n’a pas de forme, ce qui voit sans yeux, ce qui guide sans savoir, l’ignorance qui est la suprême connaissance. Serait-il erroné d’appeler la Mère ce suc, cette saveur secrète des choses, ce goût de Cause, ce frisson d’authenticité, ce lait qui instruit de la source ?” »
13- Roland Barthes, L’Empire des signes, « Champs », Flammarion, 1980 [1970], p. 60 : « Par sa perfection même, cette enveloppe, souvent répétée (on n’en finit pas de défaire le paquet), recule la découverte de l’objet qu’elle renferme – et qui est souvent insignifiant, car c’est précisément une spécialité du paquet japonais, que la futilité de la chose soit disproportionnée au luxe de l’enveloppe. »
14- Claudel, Le poète et le shamisen, in Œuvres en prose, « Bibliothèque de la Pléiade », Gallimard, 1965, p. 831.
15- Claudel exprime admirablement cela dans Aegri somnia (1937) : « [Le vase chinois] ne ressemble à rien de ce que nous rencontrons dans la nature ou du moins il ne s’y rattache qu’à la manière de l’idée avec le désir. Et d’autre part, il est dégagé de tout service profane, tandis que le vase grec, par exemple, est fait pour l’usage, pour puiser, pour contenir, pour répandre quelque chose. L’essence du vase chinois est d’être vide […] L’importance du vide, c’est toute la philosophie, c’est tout l’art chinois. Le vide en tout être, c’est le chemin mystique, c’est le tao, c’est l’âme, c’est la tendance, c’est l’aspiration mesurée, à quoi le vase donne la forme la plus parfaite, réalisant la thèse d’Aristote que l’âme est la forme du corps. Considérons-le dans son gabarit le plus typique. Le vase comporte trois parties : le récipient ou panse, le col plus ou moins allongé, qui représente l’aspiration, et la corolle plus ou moins épanouie qui est l’expansion vers l’invisible, le débouché ou, si vous aimez mieux, l’abouchement avec l’esprit. – Le tout fait de cette lumière solidifiée, de cette argile spirituelle qu’on appelle porcelaine. – Fragile comme un rêve, indestructible comme une idée. – Le rapport de ces trois parties que vous dites donne naissance à une variété de types aussi infinie que ceux de l’humanité : chez l’un prédomine la corolle, chez l’autre le rétrécissement comme quelqu'un qui avale, chez le troisième le magasin intérieur. – Ce vase, sorti de la main des Sages, n’a donc rien d’une idole. Ce n’est pas un être humain, grossièrement solidifié sous sa forme schématique. C’est l’âme en silence qui célèbre son opération. C’est le souffle en acte, la poitrine à pleins poumons qui s’approprie l’esprit, l’être délicieusement élastique qui se tend et s’épanouit en Dieu. Voici dans sa robe pure l’officiant sacré au milieu de notre sanctuaire domestique. Tout cela est un mouvement, tout cela n’est que mouvement, et cependant quand nous mettons la main sur cette froide paroi, nous ne touchons à rien qui soit susceptible de changement. C’est rond comme une définition parfaite. L’éternel est inclus dans le passager. Quelqu'un à la fois évident et occulte. Un être mystique créé par l’art, à la fois symbole et stylisation » (Claudel, Œuvres en prose, « Bibliothèque de la Pléiade », Gallimard, 1965, p. 892-894).
16- Essais, II, 6 : « De l’exercitation » : « Mais à mourir, qui est la plus grande besogne que nous ayons à faire, l’exercitation ne peut nous y aider. On se peut, par usage et par expérience, fortifier contre les douleurs, la honte, l’indigence et tels autres accidents ; mais, quant à la mort, nous ne la pouvons essayer qu’une fois ; nous y sommes tous apprentis quand nous y venons. »
Pour lire la suite, cliquer ICI
|
|
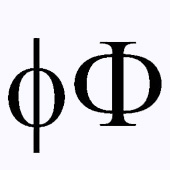
.png)
.jpg)
.jpg)