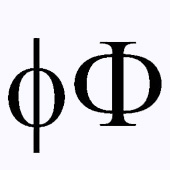|
PETIT ECHANGE AVEC CHATGPT
APHORISMES
ETRE ET EXISTER
ENSEIGNER LA PHILOSOPHIE
ESTHETIQUE DE L'ABSTRACTION
PRINCIPES DE PHILOSOPHIE ESTHETIQUE
LA PEINTURE HOLLANDAISE AU SIECLE D'OR
LES FANTOMES DE L'OPERA
ON DEVRAIT DIRE...
QU'EST-CE QUE LE NEOREALISME ?
1- Le néoréalisme italien
2- Le néoréalisme dans le monde
3- Le destin du couple
4- Personnages en quête d'auteur
5- Commediante...
6- Le cinéma dans le cinéma
LA STAR, LA VIVANTE ET LE SANS POURQUOI
ESTHETIQUE DU PARADIS TERRESTRE (1)
LE REALISME SELON CEZANNE
NOTE SUR WITTGENSTEIN
ENTRETIEN
CEZANNE ET LA FORCE DES CHOSES
MANTEGNA : ANCIENS ET MODERNES
LE TABLEAU ET LE MIROIR
LE JARDIN A LA FRANCAISE
REMBRANDT, BETHSABEE
PHILOSOPHIE ET RHETORIQUE
LES RELIGIONS DU LIVRE
DU CARACTERE A LA CARICATURE
QUELLE VANITE QUE LA PEINTURE...
LES GROTESQUES
LE ROSSIGNOL ET LA DIVA
LA STATUE AMOUREUSE
L'INTERPRETATION DE L'OEUVRE D'ART
DE L'IDEE DU BEAU A L'ESTHETIQUE
CARAVAGE ET L'OPERA
|
QU'EST-CE QUE LE NEOREALISME ?
REFLEXIONS SUR LE CINEMA
(1945-1960)
3- Le destin du couple
Au lendemain de la guerre, parmi les ruines de l’Europe dévastée, après l’effondrement des grands mythes qui avaient soulevé les peuples, pour le pire plus souvent que pour le meilleur, le couple peut apparaître comme ce qu’on nomme en Bourse « une valeur refuge ». Le couple (hétérosexuel, bien entendu : nous sommes dans l’archéologie de l’âge contemporain pour lequel Un homme, une femme reste encore le mythe dominant) devient après guerre un sujet sérieux, un objet de méditation. On peut dire que s’installer en couple – ce qui se nomme encore, dans les années immédiates de l’après-guerre, « se marier »… – prend une dimension nouvelle : il ne s’agit plus simplement d’une étape dans la vie, mais d’un pari existentiel dont on attend qu’il redonne à l’existence un sens qui désormais lui manque. Avant guerre, les films qui ont pour thème principal la vie du couple sont plutôt d’inspiration comique – non toutefois le magnifique comique de l’absurde d’un Feydeau, mais une tendresse souriante et amusée, preuve que l’on prend le sujet avec un certain détachement : ainsi La Huitième femme de Barbe-Bleue d’Ernst Lubtisch (1938) ou, pendant la guerre, Ma femme est une sorcière de René Clair (1942) ; ou bien la vie du couple est niée, sinon dépassée, dans le romantisme de l’amour fou, dont on sait, au moins depuis le Tristan de Wagner (créé en 1865), qu’il n’est pas de ce monde, et qu’il conduit ses victimes fascinées droit vers la mort (Henry Hattaway, Peter Ibbetson,1935, aimé d’André Breton ; Marcel Carné, Quai des brumes, 1938 ; ou bien Jean Delannoy, L'éternel retour, 1943). L’amour passion, thème éternel du roman comme du cinéma populaires, ne conduit nullement à la légitimation de la vie conjugale, mais condamne au contraire le confort du mariage, qui refoule le vertige de l’amour dans la routine de la vie quotidienne. Le couple n’est pas la passion, mais la tentative périlleuse d’inscrire la passion dans la durée, de donner poids et constance à l’éphémère des sentiments comme à l’intermittence des cœurs. Il faut peut-être attendre 1945, c'est-à-dire l’aube de l’après-guerre, avec le charmant et mélancolique film de David Lean, Brief Encounter (Brève rencontre), pour qu’un metteur en scène montre les fragilités de l’union maritale, rencontre clandestine d’Elle et de Lui au tournant de la quarantaine, attraction irrésistible qui ne sera jamais consommée, et retour au domicile conjugal de l’épouse éperdue et désormais résignée à l’absurde. Sinistre conclusion qui, paraissant justifier le mariage (« Thanks for coming back to me » déclare sentencieusement le mari au retour de son épouse prodigue), le condamne sans appel. Ce qui est neuf dans ce film, c’est peut-être l’accent, sa gravité, le sentiment nouveau que la crise vécue par les protagonistes est une crise essentielle, où se joue le sens même de notre vie, une sorte de révélation passagère, sans doute bientôt refoulée, d’un non-sens originel. La précarité de la vie de couple devient le révélateur d’une indépassable solitude enracinée dans la condition de l’homme, non un accident de parcours de la vie affective, mais la découverte effarée d’un ennui en lequel sombrent et meurent les individus, chacun de son côté, sans l’espérance d’un secours ni d’une communion. « On mourra seul » notait Pascal en marge de l’une des feuilles qui portent, griffonnées en tous sens, quelques-unes des « pensées ». La croix était pour Pascal le lieu de cette expérience des limites, à la croisée de l’infini et du rien. Après la deuxième guerre mondiale, c’est la vie de couple qui devient la situation privilégiée où s’accomplit cette expérience métaphysique.
Les grands élans communautaires qui rassemblaient les peuples, ce qu’on nommait alors de façon bien péjorative « les masses », ayant conduit le monde, occidental comme oriental, à la catastrophe, il reste, pour échapper à la solitude et à la mort, au néant de notre condition comme à la passion qui nous le fait éprouver : l’ennui, la joie de la fusion amoureuse, qui se met alors à ressembler à l’étreinte de deux naufragés inutilement agrippés l’un à l’autre pour se sauver de la noyade. On ne peut ignorer qu’il est bien hasardeux de miser sur un tel salut : l’amour porte toujours sur le singulier – chacun sait combien ceux qui proclament leur amour pour l’humanité en général sont aussi ceux qui sont incapables de supporter leur voisin – et le singulier est par définition impartageable, ou pour le dire d’un mot qui sera en vogue dans les années d’après-guerre, incommunicable… L’amour, qui toujours s’attache à la connaissance du singulier, se charge donc lui-même de rendre impossible le rêve de toute étreinte : de deux, ne faire qu’un. La parfaite fusion suppose la parfaite homogénéité des deux substances appelées à se confondre. Or, il se révèle que chaque individu est hétérogène à chacun de tous les autres. Toute fusion est donc passagère et illusoire, et finit fatalement par se résoudre en dissociation, ou divorce. La raison en est que chaque individu est défini par son passé, et qu’il n’existe pas deux passés rigoureusement identiques. Ce qui fait qu’un passé est un passé, ce n’est pas qu’il est passé, mais plutôt qu’il contient un secret qui ne passe précisément pas, qui résiste à sa liquidation dans l’oubli. C’est ce secret qui fait que chacun est unique, ce secret que chacun porte en lui, indéchiffrable à ses propres yeux comme à ceux d’autrui. Et c’est paradoxalement ce secret qui fait naître en autrui l’amour, dont l’inconnaissable singulier est l’objet propre. Ce pourquoi le destin du couple, en tant qu’il devient après la guerre le thème d’élection d’un cinéma spéculatif – en ce sens qu’il se propose de sonder le secret de l’humaine condition, et non plus de raconter une histoire – donne lieu à ce que Deleuze nomme « l’image-temps » : il s’agit de plonger dans les abîmes de la mémoire pour tenter de nous retrouver par-delà l’irrémédiable solitude qui fait de nous des êtres distincts. Quelque chose manque au cœur de l’union en laquelle nous mettons notre salut, un vide central menace notre tentative de triompher de la solitude et de la mort, et c’est cette absence radicale – objet paradoxal, puisque toujours occulté, de notre mélancolie – qui rend vaine toute action et convertit les personnages à la réflexion, au travail du souvenir, à la répétition lancinante d’une scène primitive. Ce qui, dans l’écriture du scénario, peut emprunter deux formes : l’enquête du détective qui fait retour sur le passé pour identifier le coupable : Ossessione avait montré, dès 1942, que la malédiction qui pèse sur les amants leur vient d’un crime ancien, que l’enquête policière finira bien un jour par arracher à la mémoire, faisant remonter à la surface du fleuve ce qui dormait dans les profondeurs. Dans Hiroshima mon amour (1959), c’est le Japonais qui joue le rôle du détective, et qui réussit, dans la scène fondamentale qui se joue au Café du fleuve, à faire apparaître l’assassiné de Nevers ; dans L’Avventura (1960) c’est la police maritime qui est convoquée pour mener une enquête qui demeure inaboutie – c’est peut-être bien là son destin inéluctable – sur la disparition soudaine d’Anna ; et déjà, dans le magnifique Chronique d’un amour (1950) qui pose les principes fondamentaux de l’art d’Antonioni, le détective engagé par le mari (« Non, dit-il, ce n’est pas l’histoire habituelle » : telle est la première phrase qui ouvre le film) trouvera un crime qui n’en est pas vraiment un (une jeune femme tombe accidentellement dans la cage de l’ascenseur, sans y avoir été précipitée, mais sans avoir été retenue non plus), et une mort qui n’est pas un assassinat (le mari meurt par accident, juste avant de tomber dans le traquenard que lui tendaient les amants). Ce détective qui fait retour dans la nuit des temps en descendant dans le puits, dans la cage d’ascenseur du passé, peut aussi bien être le psychanalyste, dont nous attendons qu’il déchiffre le secret qui nous rend impropres à la fusion amoureuse. La mode de la psychanalyse dans les années 50-70 répond à ce désir de transparence : se purifier de son passé pour se rendre apte à l’étreinte. Illusion de nous rendre ainsi transparents l’un à l’autre, qui est comme l’image en miroir de cette autre illusion, celle du transfert, qui me persuade que je peux me retrouver en un autre. La longue scène au Café du fleuve, tandis que tourne sur le juke-box la valse ritournelle de Georges Delerue, est une séance de psychanalyse, le Japonais, vivant à Hiroshima, transférant sur lui-même la fixation névrotique de la jeune fille sur l’Allemand, mort à Nevers : « Quand tu es dans la cave, lui dit-il, je suis mort ? », s’identifiant ainsi au cadavre qui reste dans le placard ; transfert qu’elle accepte aussitôt, et comme allant de soi : « Tu es mort, et comment accepter une telle douleur ? ».
Mais il semble que le destin du couple soit scellé avec une rigueur plus grande encore. Car il ne faut pas seulement dire que le secret qui fait de chacun d’entre nous un être unique, donc digne d’amour, est aussi ce qui fait obstacle à la fusion amoureuse, c'est-à-dire au seul salut en lequel nous mettons désormais notre espérance. Il faut penser plus radicalement que la clôture du secret sur lui-même, loin d’être un obstacle extérieur à l’amour, est plutôt son effet, son fruit et comme sa créature : c’est l’amour qui révèle aux amants l’effroi, ou plutôt le vertige du vide béant qui s’ouvre soudain en plein cœur de l’amour-propre, de ce « Moi » dont chacun fait parade pour séduire les autres. Comme le formulait en une sentence, cinq mois avant son suicide à Turin, Cesare Pavese, témoin capital du désenchantement de l’Italie d’après-guerre, un écrivain qui fut en communauté d’inspiration avec le cinéma d’Antonioni : « On ne se tue pas par amour pour une femme. On se tue parce qu’un amour, n’importe quel amour, nous révèle dans notre nudité, dans notre misère, dans notre état désarmé, dans notre néant » (1). Ce n’est pas notre néant qui fait obstacle à l’amour, c’est l’amour qui nous révèle notre néant. Si bien qu’il appartient au destin de l’amour de créer lui-même la condition de son impossibilité : seule la demande d’amour sait me révéler à moi-même le gouffre que je suis pour moi-même comme pour les autres. C’est seulement parce que je me sais élu, et aimé, que je m’éprouve moi-même comme individu, c'est-à-dire détenteur d’un secret. Ce par quoi je me rends étranger à moi-même, qui désire être aimé, et incommensurable à l’autre, qui me demande l’amour. Ce qui conduisait Kierkegaard à affirmer qu’il n’y avait d’amour que de la transcendance puisque c’est l’amour même qui fait des deux témoins de la rencontre deux êtres transcendants l’un à l’autre. On pose alors en Dieu la source infinie de la demande d’amour (Dieu est en effet dans la fragilité de la demande, et non dans la force inflexible), qui lie par la promesse, c'est-à-dire par l’engagement inconditionnel, au-delà de la morale comme au-delà du langage, et qui fait de l’Elu un individu digne de ce nom, responsable de la promesse d’amour, rendu unique par le secret dont il est maintenant le dépositaire. Ainsi Abraham, le chevalier de la foi, devenu lui-même par le baptême de l’amour fou qui le porte à sacrifier en silence, car l’engagement est au-delà du langage, son fils unique et bien aimé au dieu d’amour qui le lui demande (Crainte et tremblement, 1843). Il est vrai qu’au dernier moment Dieu flanche, et substitue à l’enfant, le bélier. Il reste que seul un Dieu peut oser l’amour infini, donc l’amour même, car l’amour ne saurait se résigner à être fini sans se renier lui-même (ce qui définit à peu près le mariage, qui est en ce sens une position de repli, en aucun cas un salut véritable). Dans les ruines de l’Europe d’après-guerre, Dieu semble sinon mort, du moins étrangement absent. L’âge contemporain ne peut donc compter que sur les hommes, qui sont faillibles, pour instituer la demande d’amour, qui exige l’absolu. La contradiction est insurmontable, et les amours humaines semblent fatalement vouées à l’échec. Jusqu’à la fin des années soixante, et sans doute au-delà, l’écran cinématographique sera le miroir en lequel les survivants réfléchissent et se représentent l’impasse amoureuse.
Deux films contemporains sont sans doute ici fondateurs de l’expérience du couple envisagée comme expérience métaphysique, suprême solution à l’équation de l’existence, à l’ennui de la solitude comme à l’angoisse de la mort : Voyage en Italie de Rossellini et Chronique d’un amour d’Antonioni, tous deux sortis en 1950. Le premier, celui de Rossellini, trouve une issue heureuse, le couple qui s’est longuement ignoré, sinon franchement détesté, tout au long du film, se reconstituant miraculeusement dans les dernières minutes : miraculeusement est le mot, puisque c’est au moment d’un miracle provoqué par la procession des reliques de saint Janvier dans les rues de Naples qu’Alexander et Katherine Joyce (George Sanders et Ingrid Bergman) tombent dans les bras l’un de l’autre. Outre que cette résurrection ne soit pas au-delà de tout soupçon (ce n’est peut-être qu’une illusion passagère provoquée par l’enthousiasme de la foule, on est même porté à le croire tant le divorce, tout au long du film, semblait profond), elle nous est donnée à voir comme l’effet d’une intervention miraculeuse, ce qui, ou bien la discrédite aux yeux de l’époque contemporaine, ou bien ancre le salut dans la manifestation du divin et non dans l’union rédemptrice de deux solitudes, humaines et trop humaines. Il y aurait certainement beaucoup à dire sur le mystère de la conversion dans le cinéma de Rossellini (on a même consacré à ce sujet un ouvrage entier : Patrick Verly, Roberto Rossellini, une poétique de la conversion, au Cerf), mais cette direction nous éloignerait de notre sujet. Il reste Antonioni, dont tout l’œuvre n’est qu’une longue variation sur le thème du couple, de l’histoire déchirante de la rupture (Il Grido, 1957) à l’expérience de la légèreté de l’être, nullement insoutenable, du moins pendant l’éclipse provisoire des sentiments et la liberté d’indifférence du non-engagement (L’Eclisse, 1962). Mais tout commence avec Chronique d’un amour (1950), qui est l’histoire d’un amour exposé au mal chronique du Temps, histoire dont l’issue, à l’inverse du film de Rossellini, est malheureuse, les amants étant étrangement conduits à la rupture alors même qu’aucun obstacle ne s’oppose plus à leur union. On ne saurait cependant limiter au seul Antonioni cette analyse cinématographique du salut par le couple : Hiroshima mon amour (1959) demeure, au moins pour toute une génération, un film paradigmatique qui a profondément modifié notre réception de l’image cinématographique, et qui a donné à l’image-temps, magistralement définie par Deleuze, ses lettres de noblesse (même si Deleuze juge que l’effort de fusion mémorielle entre les deux amants échoue, le Japonais gardant pour lui seul le secret de l’horreur atomique – « Non, tu n’as rien vu à Hiroshima » – et se dissimulant lui-même sous le premier amour de la jeune femme, qu’il conduit à réminiscence) (2). Il nous reste donc à suivre Antonioni dans son labyrinthe des sentiments, carte du Tendre de l’époque contemporaine, puis à conclure avec les amants d’Hiroshima, dont le double monologue, qui tend à se confondre dans l’unité et la continuité d’un dialogue intérieur, conserve aujourd’hui l’intégrité de son pouvoir d’incantation.
Antonioni n’a jamais pensé rompre avec l’inspiration néoréaliste. Non seulement il aimait à rappeler qu’il tournait à la fin de l’année 1942 son premier film, un court métrage sur la vie des riverains le long du fleuve Pô (Gente del Po), au moment même où, dans la même région et non loin de là, Visconti tournait ce qu’on convient de reconnaître comme le premier film néoréaliste, Ossessione (Les amants diaboliques) ; mais encore il se réclame lui-même du néoréalisme, un néoréalisme cependant inédit qu’il définit lui-même comme un néoréalisme « sans bicyclette » : la misère profonde de l’Italie au lendemain de la guerre permettait de cristalliser tout le drame humain dans le vol d’une bicyclette ; mais avec le boom économique qui transforme en profondeur la société italienne à partir des années 50, l’alibi de la bicyclette n’est plus tenable, et il faut s’intéresser au travail du deuil que doit accomplir pour lui-même une sensibilité frappée d’une rupture plus essentielle, plus intérieure : « Aujourd’hui que nous avons éliminé le problème de la bicyclette – je parle par métaphore, essayez de me comprendre au-delà de mes paroles – il est important de voir ce qu’il y a dans l’esprit et le cœur de cet homme à qui on a volé sa bicyclette, comment il s’est adapté, ce qu’il est resté en lui de toutes ses expériences passées de la guerre, de l’après-guerre, de tout ce qui est arrivé dans notre pays, un pays justement qui, comme tant d’autres, est sorti d’une aventure si importante et si grave » (3). Ce qui signifie qu’Antonioni accepte de continuer le cinéma néoréaliste à la condition d’en renverser l’orientation : au néoréalisme objectif, de situation, de l’après-guerre, il substitue un néoréalisme subjectif, ou intérieur, selon une formule qu’André Bazin inventa pour qualifier le regard du Rossellini d'Europe 51 (tourné en 1951, sorti en 1952) et que Patrice Hovald reprit en 1959 précisément à propos du cinéma d’Antonioni (4). André Bazin parle encore d’un « néoréalisme des âmes », tandis que Claude Mauriac fait d’Antonioni « le cinéaste de la vie intérieure ». C’est pourquoi la caméra d’Antonioni est toujours attachée à serrer au plus près les acteurs, comme pour scruter leurs jeux de physionomie, être à l ’écoute de leur vie intérieure : dès son premier long métrage, Chronique d’un amour (1950), Antonioni éprouva le besoin de monter la caméra sur un chariot mobile (une dolly dans le jargon du métier), de façon à coller aux acteurs, à les accompagner en de longs travellings, et même à surprendre malgré eux leur inquiétude la plus intime en continuant de les filmer après qu’ils aient dit leur texte : « J’avais besoin de voir les personnages, même dans leurs gestes les plus simples, après que tout eût été dit, après que les répliques eussent été épuisées et qu’il ne restât plus que les conséquences de ce qui s’est passé dans l’âme de chacun » (5). Néoréalisme intérieur, ou de l’intériorité : cela signifie qu’il s’agit de transposer sur la scène de la vie intérieure le même désenchantement dont le premier néoréalisme s’est voulu le témoin dès l’immédiate après-guerre. C’est ainsi qu’en s’intériorisant, le néoréalisme se fait aveu de la solitude, une solitude essentielle et non conjoncturelle en laquelle se résume la détresse de se savoir dans le temps, et promis à la mort. On pressentait déjà, dans Le Voleur de bicyclettes, combien l’errance d’Antonio Ricci dans la Rome désertée le dimanche à l’occasion d’un match de football était en vérité errance dans le labyrinthe intérieur d’une âme désorientée. Nous retrouverons chez Antonioni ces errances métaphysiques, marches sans but dans des villes que leur modernité impersonnelle rend inhumaines (Jeanne Moreau dans La Notte, fuyant le cocktail mondain donné en l’honneur de son écrivain de mari, et partant en quête d’un faubourg maintenant désaffecté de Milan qui conserve le souvenir des premiers temps de leur amour). Elles sont à l’image des divagations de l’âme qui se perd en elle-même, prenant ainsi la mesure de sa solitude et arpentant le secret intérieur qui la rend impénétrable.
Le premier long métrage d’Antonioni, Chronique d’un amour (dont nous avons déjà précisé qu’il ne consiste pas dans le récit d’un amour, mais plutôt dans l’expérimentation qui consiste à plonger l’amour dans l’élément du Temps, Chronos, pour observer les diverses dissociations qui s’opèrent alors en lui), sorti en 1950, se résume ainsi : Paola et Guido, la trentaine passé, se sont aimés autrefois, alors que Guido était fiancé à la jeune Giovanna. Celle-ci est morte en tombant dans la cage d’un ascenseur. Plus encore que la vive, la morte fait obstacle à l’union des amants. Elle fait peser sur eux le poids d’une culpabilité, au moins par omission, non qu’ils aient précipité la jeune fille dans le vide, mais parce qu’ils n’ont pas eu un geste pour la retenir, peut-être satisfaits de voir disparaître le tiers qui leur faisait obstacle. Ce puits de mémoire creuse entre Paolo et Guido un abîme qui leur interdit de se rejoindre. Ils se retrouvent pourtant, par une sorte de retour du refoulé, quand le mari de Paola, Enrico Fontana, une des plus grosses fortunes de Milan, décide, par jalousie, d’engager un détective privé pour une enquête sur la jeunesse, dont il ne sait rien, de son épouse. Il ne se serait sans doute pas décidé à le faire s’il n’avait pas eu le soupçon d’un secret qu’on lui cache. C’est cette enquête qui fait revivre le passé, réactualise la culpabilité ancienne et fait de la trépassée une revenante, qui vient hanter la mémoire des amants. Un crime obscur mine le passé et rend impossible l’union de ceux qui s’aiment. Nous ne sommes pas loin de la situation des « amants diaboliques » d’Ossessione, et le scénario s’en approche davantage en progressant : Paola et Guido, de plus en plus possédés par leur ancienne passion (à la vérité, Paola plus que Guido : c’est elle qui mène la danse, tandis que son amant, meurtri par la vie et ne croyant guère qu’il soit possible de revenir en arrière, ne fait que céder à la demande impérieuse et ardente de la jeune femme), décident de supprimer le mari, qui fait obstacle au retour désiré du temps perdu. Ils montent un traquenard qui permet à Guido, sur un point stratégique de la route empruntée chaque soir par Enrico Fontana, rentrant en voiture de son usine à son domicile, de l’assassiner d’une balle de revolver. Mais ce soir-là Enrico, désespéré par le nouveau rapport que le détective qu’il a lui-même engagé vient de lui remettre, et par lequel il apprend que Paola a renoué avec Guido, son premier amour, conduit trop vite la Maserati qu’il vient d’acquérir et se tue à quelques centaines de mètres du lieu prévu pour son assassinat. Une seconde fois les deux amants sont coupables d’une mort qu’ils ont souhaitée, mais qu’ils n’ont pourtant pas donnée. Un crime se répète dans le puits du passé, dans le lieu de mémoire où se retrouvent les amants un mourant fait échec à leur étreinte. Lucia Bosé est, dans ce film, éblouissante, fastueusement vêtue de robes magnifiques qui font d’elle une sorte d’animal de race, ardente et vigilante, toujours inquiète de l’enquête, ou de la mort qui la traque, sentinelle fiévreuse d’un désir infini qui tarde à s’accomplir. Elle incarne à merveille le rêve baudelairien de la beauté : « J’ai trouvé la définition du Beau, – de mon Beau. C’est quelque chose d’ardent et de triste, quelque chose d’un peu vague, laissant carrière à la conjecture » (6). Le noir et blanc est contrasté, jouant avec des effets parfois presque expressionnistes qui donnent à ce film un air de famille avec le film noir américain (ou avec l’Ossessione de Visconti), même si les gris s’adoucissent pour les rencontres amoureuses. Deux scènes, magnifiques, méritent d’être évoquées : dans la première, Paola et Guido se retrouvent après une longue séparation sur les rives de l’Idroscalo de Milan, un lac artificiel devenu parc de loisir, désert en cette fin d’automne qui donne son climat au retour d’un passé tourmenté. Tandis que Guido prévient Paola de l’enquête dont elle est l’objet, les deux amants, assis sur les gradins du stade nautique, regardent le lac. Ils contemplent le vide, le néant du temps passé qui se réfléchit par le scintillement de la lumière de l’arrière-saison sur le plan d’eau, comme sur une eau morte. Ils pensent l’abîme qui les sépare comme les sépare la cage d’escalier, béante, en laquelle tombe éternellement la jeune Giovanna.

Antonioni, Chronique d'un amour (1950)
La seconde scène fait écho à la première : c’est cette fois Paola qui donne rendez-vous à Guido (pour lui annoncer que son époux renonce à poursuivre l’enquête), et les amants se retrouvent, sans l’avoir prémédité, dans une large cage d’escalier où vont et viennent des inconnus empressés, où un vieil ascenseur, dont la porte, en s’ouvrant comme en se fermant, fait un bruit métallique qui résonne violemment dans le puits, accompagne de son vacarme les phrases brèves, lourdes de sous-entendus, des deux complices. Il faudrait faire une phénoménologie de la cage d’escalier – ici filmée dans un long plan en contreplongée, qui creuse sur l’écran la mise en abîme de la perspective – dans la cinématographie de l’angoisse amoureuse.

Antonioni, Chronique d'un amour (1950)
Comment ne pas penser à l’escalier du clocher de la mission espagnole, éloigné d’une centaine de kilomètres de San Francisco, dans le chef d’œuvre d’Alfred Hitchcock, Vertigo (Sueurs froides), 1958 ? Au sommet de cette tour, on assassine une femme, tandis que le détective Scottie (James Stewart), pris de vertige, sous le charme fallacieux du sosie qui l’entraîne dans les hauteurs, échoue à empêcher le crime. Le clocher de Vertigo n’est que l’image inversée en hauteur de l’abîme que creuse en profondeur la cage d’escalier de Chronique d’un amour, qui précède de huit ans le film d’Hitchcock. C’est ce gouffre de l’irréversible qui sépare les amants et fait de l’étreinte un fiasco. Après la mort du mari, Paola et Guido ne pourront renouer leur ancienne liaison, à jamais séparés par une culpabilité connue d’eux seuls. « Néoréalisme de l’intériorité », certes, mais à condition de préciser que cet intérieur est hanté par le vide, qu’il bée sur le néant, et que c’est en tombant dans cet abîme – ce qu’on nomme proprement une « dépression » – que la caméra se donne les moyens d’explorer le secret des âmes amoureuses. C’est en ce sens qu’Aldo Tassone peut écrire : « Chronique d’un amour est le premier grand film du postnéoréalisme. Nous sommes tout à fait de l’avis d’André Bazin qui écrivait en 1951 : “Chronique d’un amour est un peu comme Les Dames du Bois de Boulogne du néoréalisme” » (7). Ainsi sont traqués les amants par une Némésis invincible qui leur vient du passé.
Le second épisode de cette longue odyssée des malheurs de l’amour viendra, chez Antonioni, sept années après Cronaca di un amore, avec Il Grido, Le Cri (1957). La lamentation sur la mort de l’amour prend alors l’accent d’une plainte funèbre, le romantisme désespéré faisant de ce film magnifique la plus exemplaire illustration de la chronique des pauvres amants. On y retrouve la tour vertigineuse où sont précipitées les amours défuntes : il s’agit cette fois de la haute cheminée de l’usine sucrière, dans la vallée du Pô (Antonioni revient au pays qui le hante depuis son enfance, ces rives désolés et dépeuplées qu’il avait filmée en 1942 dans son premier court métrage), usine dans laquelle travaille Aldo, que la caméra, tout au long du film, ne quittera pas d’un pas. Le film s’ouvre sur la rupture : Irma en aime un autre, qu’on ne verra jamais, et veut vivre sa vie. Aldo, répudié, erre en compagnie de sa fille, évoquant une sorte de Charlot qui ne fait plus rire et que suit le Kid, sur les pauvres routes de l’Emilie-Romagne, cherchant sans jamais la trouver une présence qui aurait le pouvoir de combler le vide que la rupture creuse au plus profond de lui-même. Son vagabondage suit les rives du Pô, dans un paysage désolé sur lequel règne un hiver perpétuel : c’est l’hiver quand Aldo s’éloigne de l’usine et du village où demeure l’unique femme qui peut lui donner l’amour ; et c’est toujours l’hiver, ça n'a jamais cessé d'être l'hiver, quand il y revient un an plus tard, après avoir échoué dans sa tentative d’évasion, et alors qu’Irma vient de donner naissance à un enfant qui n’est pas le sien. L’hiver toujours était à ses côtés tout au long de sa route. Le temps s’arrête chez Antonioni, éternisé par l’ennui ou par l’absence du sens. Road movie circulaire, comme prisonnier du cadran de l’horloge, qui effectue un voyage sur place, puisqu’il n’y a pas d’ailleurs. Dans ce film qui joue superbement avec toutes les teintes du gris, ciel nuageux, brume sur la terre, routes sous la pluie qui sont des chemins qui ne mènent nulle part, c’est le fleuve Pô qui joue le rôle de l’horloge, l’écoulement de son eau, le passage lent des chalands. Paysage d’une mémoire dévastée, dévorée par l’ennui et possédée par le Temps. Ici, Antonioni réussit admirablement son pari d’un « néoréalisme sans bicyclette » : le deuil qui accable Aldo est celui d’une irrémédiable disparition, d’une inguérissable solitude. C’est ainsi que les hommes vivent, dissociés de leurs baisers qui, au loin, les suivent, hantés par le désir d’une union qui n’est pas de ce monde. Le vol de l’objet seul capable de combler le manque n’est pas un accident malheureux, mais la nécessité d’un destin imparable qui vient s’inscrire dans la condition même de l’homme. Privé de l’amour d’Irma, Aldo est comme privé de lui-même, homme sans qualité, sans identité, errant dans le labyrinthe du Temps, qui est une ligne droite qui se poursuit dans l’indéfini, sans jamais trouver le repos, et qui revient paradoxalement sur elle-même. Une fois accompli son parcours circulaire, comme les damnés sur les cercles de l’enfer de Dante, Aldo retourne au point de sa nostalgie : c’est alors qu’il aperçoit, de l’autre côté de la fenêtre, dans l’intimité de l’intérieur, Irma donnant à son bébé des soins affectueux. L’image est forte : un autre cinéaste aurait choisi de faire Aldo témoin d’une autre scène, un baiser échangé entre son rival et Irma. Mais Aldo est trop désespéré pour être jaloux, et ce n’est plus au tiers qui l’exclut qu’il souhaiterait s’identifier, mais à cet enfant qui vient de naître, amoureusement caressé par sa mère. Nostalgie de la mère, plus encore que de l’amante. Dominique Fernandez, dans un remarquable article sur L’Avventura (1960), commentant la scène finale de ce film, évoque le matriarcat en lequel se cristallise la rêverie amoureuse du mâle italien. La crise du couple contemporain, désorienté par la remise en question des rôles traditionnels de la virilité et de la féminité, provoque le désir d’une régression infantile dans la jouissance du maternage : « Si le rapport homme-femme est impossible aujourd’hui, faute d’homme et faute de femme, du moins reste-t-il le rapport mère-fils. La femme sera la mère, non l’égale, de son amant. Ce matriarcat sans enfant (jamais d’enfants dans les films d’Antonioni) retrouve ainsi, dans la compassion accordée à de médiocres mâles, sa vocation maternelle » (8). Il est vrai qu’à la fin de L’Avventura Claudia console son médiocre amant Sandro en lui caressant les cheveux, geste d’affection maternelle qui mime les soins caressants que donne à son enfant Irma derrière la vitre. C’est cette paroi qui, par sa transparence même, exclut Aldo de l’amour d’Irma. Hébété, comme un somnambule, Aldo monte la tour du haut fourneau de l’usine de betteraves à laquelle il a donné son congé au début du film, et vacillant au sommet comme une girouette dans le vent, tombe et se tue. Le cri, ce n’est pas celui d’Aldo qui se laisse aller à la mort comme pierre qui roule, Aldo le taciturne dont la marche forcée réhabilite la poésie du cinéma muet, mais celui d’Irma qui accourt éperdue et voit, dans le vide au sein duquel s’élève la spirale de l’escalier de fer, non l’abîme où se perd son amour passé, mais celui où se perdra son amour présent. Sur la dernière image du film, Irma agenouillée, penchée sur le cadavre d’Aldo plaqué sur la terre les bras en croix, compose une moderne Pietà.
Nous venons d’évoquer L’Avventura (1960), cette œuvre charnière – on ne filme plus après L’Avventura comme on filmait avant – qui fut sifflée à Cannes pour son maniérisme et, disait-on, son snobisme, à laquelle ses partisans les plus enthousiastes (il y en avait de nombreux parmi les critiques) prédisaient un échec commercial, et qui fut en vérité la première reconnaissance publique d’un grand art demeuré jusque là confidentiel. L’Avventura obéit toujours au même schéma, il est vrai cette fois plus pur, plus énigmatique qu’il n’a jamais été : il faut qu’entre les amants s’ouvre un abîme au fond duquel repose un cadavre, et qu’ainsi la fusion de l’union amoureuse soit rendue impossible par cette fêlure sans remède, ce gouffre macabre qui réduit à néant le bonheur désiré. Lors d’une croisière dans les îles éoliennes, l’imprévisible Anna toujours vibre de la colère contenue que lui inspire le trop peu d’amour de son amant, Sandro, architecte aisé et médiocre, qui a renoncé à son art pour se mettre au service d’un promoteur immobilier que seul intéresse le succès de ses opérations financières. Lors d’une étape sur une île, un rocher ingrat et pratiquement inhabité, surgi, on ne sait pourquoi ni comment (9), d’une mer sombre, houleuse et menaçante, Anna disparaît. Les compagnons de cette nef des fous parcourent en tous sens l’île en criant le nom de la disparue, sans que personne ne réponde. Chacun revenant bientôt aux manies qui peuplent sa solitude, on oublie bientôt celle qui n’est plus là. Mais le vide laissée par son absence – les rochers tombant à pic sur des anses où cognent les vagues, scrutées avec attention à la recherche du cadavre – demeure dans les mémoires, comme demeure, dans la mémoire de Scottie, le détective de Vertigo, l’escalier périlleux qui conduit au sommet du clocher où se cache un assassin, dans les mémoires de Guido et Paola, la porte ouverte sur la cage béante de l’ascenseur, dans les mémoires d’Aldo et d’Irma, l’escalier de la tour du haut de laquelle s’est précipité le désespéré. Anna disparue, entre en scène Claudia, jusque là effacée par son amie, maintenant rayonnante et solaire, véritable invention – au sens où l’on parle de « l’invention » de la Sainte Croix – de Monica Vitti, temps fort de l’histoire du cinéma, amoureuse et glorieuse, souveraine, et misant tout son amour sur Sandro (Gabriele Ferzetti), don juan de magazine qui a choisi de trahir sa jeunesse – devenir un grand architecte – pour faire de l’argent. Le couple part à la recherche d’Anna sur les routes d’une Sicile grise et nuageuse, pour une enquête sur une mort supposée qui se transforme vite en escapade amoureuse. L’enchantement, qui se révèlera bientôt illusoire, opère au sein d’un paysage austère, une terre ingrate et inhabitée, que hante curieusement l’absence de l’homme, et qui prolonge l’étrangeté de l’île volcanique où s’est effacée la présence d’Anna. Le couple s’attarde un moment dans un village désert, tout juste construit et pourtant déjà abandonné, témoin des douteuses opérations immobilières auxquelles se livre sur l’île la mafia, une architecture métaphysique qui donne à voir la figure insolite du monde quand nul n’est là pour le regarder. Egarés dans ce labyrinthe, Sandro et Claudia sont un instant les témoins de leur propre disparition, hypnotisés, et nous avec eux, par ce décor urbain qui ne semble pas destiné à l’habitation. Et quand le couple remonte dans la voiture et s’éloigne de ce lieu hanté, la caméra demeure prisonnière de ces édifices de songe, et continue d’enregistrer leur image, comme si l’opérateur avait par mégarde oublié de fermer le moteur. Après une station dans cette merveille architecturale qu’est au sud de la Sicile la ville de Noto – qui offre à Sandro, architecte manqué, l’occasion amère de mesurer l’ampleur de son renoncement – le couple finit par échouer dans une réception mondaine qui a lieu dans le prestigieux palace San Domenico de Taormina, où se retrouve le gratin des bourgeoisies sicilienne, napolitaine et romaine. Antonioni excelle à saisir le léger vertige du papotage mondain, réduit ici à quelques bribes de conversations cueillies au passage, qui semblent plutôt des fragments de monologues qui ne s’ajustent pas entre eux, et qui renvoient chacune de ces ombres parlantes à son indépassable solitude. Au petit matin, Claudia se réveille seule. Inquiète, elle part aussitôt à la recherche de Sandro qu’elle découvre dans les bras d’une courtisane de luxe. Epouvantée par la fatalité de cette inconstance, qui dissipe le mirage de la fusion amoureuse, Claudia s’enfuit sur la terrasse de l’hôtel, qui donne sur la majesté de l’Etna illuminé par le soleil levant. Sandro rejoint Claudia, s’assoit sur un banc, et pleure. Debout derrière lui, comme une infirmière derrière la chaise roulante d’un grand malade, elle caresse lentement ses cheveux. L’amour n’est jamais digne de la promesse de bonheur que fait pourtant espérer la joie sexuelle. Les hommes sont malades d’Eros, incapables de s’élever à la hauteur où les emporte le dieu. Telle est bien la conclusion d’Antonioni lui-même : « … Que croyez-vous qu’il soit, cet érotisme qui a envahi la littérature et le spectacle ? C’est un symptôme, le plus facile à saisir peut-être, de la maladie dont souffrent les sentiments. Nous ne serions pas érotiques, c'est-à-dire malades d’Eros, si Eros était en bonne santé. Et, en disant en bonne santé, je veux dire juste adéquat à la mesure et à la condition de l’homme. Il y a donc un malaise. Et comme il lui arrive toujours quand il y a un malaise, l’homme réagit. Mais il réagit mal et il en est malheureux. Dans L’Avventura la catastrophe est une impulsion érotique de ce genre : bon marché, inutile, malheureuse. Et il ne suffit pas de savoir que c’est comme ça. Car le héros (quel mot ridicule !) de mon film se rend parfaitement compte de la nature grossière de l’impulsion érotique qui s’empare de lui, de son inutilité. Mais ça ne suffit pas. Voilà un autre mythe qui tombe, cette illusion qu’il suffit de se connaître, de s’analyser minutieusement dans les plis les plus cachés de l’âme. Non, cela ne suffit pas. Chaque journée on vit “L’Avventura”, que ce soit une aventure sentimentale, morale ou idéologique » (10).
Triste verdict. Triste parce que dérisoire. On a l’habitude de considérer L’Avventura (1960) comme le premier volet d’un triptyque, ou le premier acte d’une trilogie, dont les deux suivants seraient La Notte (1961) et L’Eclisse (1962), trois films pour trois années successives en lesquelles nombreux sont ceux qui reconnaissent le sommet de cet art. Il est vrai qu’avec Il Deserto rosso (1964) s’ouvre une nouvelle période, marquée par l’avènement de la couleur. Il semble qu’avec ce film nous passons du néoréalisme intérieur qui sonde les abîmes des âmes amoureuses, plongée mémorielle où défilent les images mentales auxquelles le gris, plutôt que le noir et blanc, convient mieux que la couleur, à un réalisme du réel, dans son incompréhensible présence, qui apparaissait déjà dans l’île rocailleuse de L’Avventura comme dans le village désert que fuyaient bien vite les amants en vadrouille, ou bien encore dans les paysages désolés et trempés de pluie que traversait l’errance d’Aldo. C’est à cette hypnose du réel, admirablement rendue par les prestiges de la couleur, que succombe Giuliana, bien davantage qu’à l’échec de son mariage, et c’est cette même fascination de la présence qu’affrontent le photographe de Blow up (1966), l’usurpateur d’identité de Profession reporter (1975) et même les amants d’une brève rencontre dans la Vallée de la Mort de Zabriskie Point (1970). Le vertige ne donne plus sur le gouffre des sentiments, mais sur le vide de l’existence pure et simple. Nous nous éloignerions de notre sujet en portant l’analyse jusque là. En revanche, il est vrai que La Notte et L’Eclisse prolongent L’Avventura, non pourtant qu’il faille à tout prix discerner en cet ensemble une trilogie, puisque la leçon commence dès Chronique d’un amour et se poursuit splendidement avec Il Grido. Ainsi semble-t-il que La Notte commence là où L’Avventura finit : Claudia et Sandro finissent malgré tout par choisir de vivre ensemble, et nous les retrouvons, quelques années plus tard, sous les traits des époux Pontano, Giovanni, écrivain (Marcello Mastroianni), qui pense à se vendre à un riche industriel, Gherardini, qui se pique de culture (comme Sandro au trafic juteux des opérations immobilières) et Lidia (Jeanne Moreau), son épouse qui refuse de se résigner au trop peu d’amour. Le couple de L’avventura finit par consentir, par pitié plutôt que par amour, à la vie commune. Mais c’est déjà Claudia qui est reine, Sandro n’est qu’un comparse sans envergure. Cette royauté de la femme, d’abord grande prêtresse des mystères de l’amour, grande consolatrice des âmes blessées, mère et amante, vierge et courtisane, mais peu à peu juge sévère de la médiocrité des hommes, désirant vivre et ne se résolvant jamais à simplement survivre, Antonioni n’a jamais cessé d’en rechercher le visage (Identification d’une femme, 1982). Il s’affirme de plus en plus, au cours des œuvres successives, et si Claudia accorde à Sandro son pardon, Lidia est bien résolue à demander des comptes à son bel indifférent de mari. C’est toujours le destin du couple qui se trouve au cœur de cette méditation filmée, et la cage d’escalier en laquelle sombre et disparaît l’illusion amoureuse est ici le périmètre d’une piscine dans laquelle, au cours d’une nuit mémorable qui met en scène tous les rituels du cérémonial de l’ennui dans le parc des Gherardini – version, plus effrayante encore que celle de Fellini, de la dolce vita à l’italienne – des somnambules décervelés tombent dans l’eau sans y penser, tandis que se déchaîne l’orage sur ce bal des fantômes. A l’aube blême, le couple, ou plutôt ce qu’il en reste, tente de recomposer le puzzle dispersé de sa vie, et malgré les dénégations de l’époux, on comprend que l’épouse n’est plus prête à se satisfaire de faux-semblants, et que les jours sont comptés qui conduisent à la rupture. Jeanne Moreau incarne ainsi une figure de femme plus libre, davantage prête à l’indépendance que ses devancières. Au début du film, abandonnant son époux aux délices mortels d’un cocktail littéraire, Lidia erre seule dans Milan désert, écrasée par les immenses blocs d’une architecture de béton, de métal et de verre, que son impersonnalité agressive rend inhumaine. Sans se laisser leurrer par le mensonge de son couple, Lidia ose affronter seule la force des choses et le poids du réel. Elle se risque à être libre. De Chronique d’un amour (1950) jusqu’à L’Eclipse (1962), les films d’Antonioni racontent l’histoire d’une libération, celle de la femme abandonnant l’homme à son ressassement morose et solitaire. C’est dans ce dernier film que la Vitti fait son come-back, plus souveraine, plus radieuse que jamais. Ce n’est pas un hasard si elle porte maintenant le nom de Vittoria, et ce n’est pas un hasard non plus si le film s’ouvre sur la rupture vers laquelle s’acheminait Jeanne Moreau à la fin de La Notte : Ricardo (Francisco Rabal), dernier avatar de la figure masculine, après Guido, Aldo, Sandro et Giovanni, tassé sur son siège, que son inertie paralyse, regarde se mouvoir, comme une danse de mort autour de lui, Vittoria qui prend seule l’initiative de la rupture. En 1961, Antonioni s’était rendu à Florence pour observer une éclipse de soleil qui l’avait beaucoup impressionné : « Dans cette obscurité, dans ce froid glacial, dans ce silence si différent de tout autre silence […] je me suis demandé si, pendant une éclipse, même nos sentiments sont arrêtés » (11). L’éclipse au cours de laquelle Vittoria, délivrée du lien qui l’oppressait, devient elle-même en découvrant la liberté d’indifférence, l’innocence de la pure disponibilité, est une éclipse des sentiments, la convalescence de l’âme malade d’Eros dont les films précédents avait fait le portrait. Vittoria la bien nommée, pour avoir triomphé de ces tourments, se trouve pour la première fois comme en état d’apesanteur, flottant dans la très supportable et même bienheureuse légèreté de l’être, accueillant sans a priori le monde tel qu’il se présente. A la solitude accablée de l’être-pour-la-mort, emporté dans le fleuve Temps, succède une solitude enchantée, sensible aux sollicitations de l’instant, jetant un regard étonné et toujours attentive au hasard de la rencontre. Il y a dans ce film un moment de grâce : un vol dans un petit avion à hélices, de Milan à Vérone, emporte Vittoria au septième ciel, ravie parmi les nuages, jouissant d’avoir vaincu l’attraction qui fait ramper les hommes sur la terre (12). Vittoria se sent pousser des ailes et, par une conversion quasi miraculeuse, éprouve l’absence du sens, qui plongeait autrefois la solitude dans un silence accablant, comme une ouverture qui libère désormais le champ des possibles. Escale heureuse dans le petit aéroport de Vérone où se retrouvent en silence les amoureux du vol à voile, communiant dans une même ivresse du détachement, ou du décollage. Non que pourtant soit comblé le néant qui se creuse au cœur de notre condition : nous le retrouvons cette fois sous une métaphore nouvelle, la corbeille de la Bourse, comme un cercle magique autour duquel vocifèrent les agents de change, où se démène Piero (Alain Delon), créature mercurielle qui semble avoir du vif-argent dans les veines : « Vous remuez tout le temps, lui dit-elle – Pourquoi pas ? répond-il. » Pourquoi pas en effet puisque dans un monde délivré de l’esprit de sérieux, tout est jeu sans conséquence. La Bourse est une image saisissante de l’inanité de l’agitation des hommes. Dans le bar après le krach, les deux jeunes gens échangent ces mots : « – Ces milliards qui se perdent, où ça va ? demande Vittoria. – Nulle part, répond Piero. – Ceux qui gagnent touchent de l’argent ? – Oui. – De ceux qui perdent ? – Ce n’est pas si simple. – Mais, l’argent perdu, où il va ? » Piero fait un geste pour laisser entendre qu’il n’en sait rien, et qu’il s’en moque. La Bourse est un gouffre où les hommes engloutissent joyeusement, et comme par jeu, leurs destins. Dans l’appartement des parents de Piero, appartement dont le luxe, pense le jeune homme, éblouira sa nouvelle conquête, le dialogue, si l’on peut employer ce terme, reprend : « Tu n’aimes pas la Bourse ? demande-t-il – Je ne sais pas. C’est un bureau, un marché, ou un ring ? Est-ce tellement nécessaire ? – Il faut y venir pour comprendre. Dès qu’on y touche, on est mordu (passionato). – Mordu par quoi, Piero ? (Se passiona per cosa, Piero ?) ». Long silence de Piero, qui est incapable de répondre à la question. On ne le voit pas, la caméra filmant alors le visage grave de Vittoria, qui finit par s’amuser de l’inconscience de son partenaire, et joue bientôt avec une fenêtre, l’invitant à l’embrasser de l’autre côté de la vitre. On ne s’aime pas, on joue à l’amour, comme on joue sa vie à la Bourse. N’importe, semble penser Piero, si du moins il pense, Piero aux yeux duquel rien, pas même la mort, ne semble avoir d’importance : un ivrogne a volé sa voiture, petit bolide qui convient au séducteur qu’il prétend être ; on la retrouve le lendemain au fond du lac, le cadavre du voleur agrippé au volant. Vittoria est impressionnée, mais Piero ne l’est guère qui s’inquiète seulement de l’état de la carrosserie. La jeune femme s’en trouble un moment, mais un moment seulement : nous les retrouvons bientôt qui jouent comme des enfants avec un jet d’eau dans le jardin. La Bourse fait du néant de l’existence le terrain d’un exercice ludique, et la vie tout entière nous offre l’espace d’un jeu. A l’intellectuel tourmenté qu’elle vient de quitter, Vittoria décidément, résolue à faire l’apprentissage de sa liberté, préfère l’insouciance véloce de son compagnon d’un jour. Elle ne demande pas à l’amour de la sauver de l’ennui – maladie qui ne semble plus guère l’affecter – mais plus simplement de lui apprendre à jouir de l’instant qui passe. Elle ne lui demande en vérité plus grand-chose, trop occupée d’arpenter le royaume, nouveau pour elle, de sa disponibilité. Au rendez-vous que se donnent ces amants éphémères, personne ne se rend, malgré leurs promesses, jugeant au fond d’eux-mêmes que le jeu n’en vaut pas la chandelle, et la caméra s’attarde dans une séquence finale de sept minutes, composée d’une cinquantaine de plans montrant sous divers angles le lieu désert du rendez-vous, près d’un fût percé dont l’eau s’écoule comme l’eau d’une clepsydre, carrefour où filent de rares voitures, que traversent quelques passants, pour certains déposés à l’arrêt tout proche du bus. Extraordinaire séquence qui réactualise le rêve ancien, qui n’est peut-être que le rêve du voyeurisme, qui consiste à regarder le monde comme il est quand nul n’est là pour le voir. A l’inverse du village inhabité, décor métaphysique de l’absence, où s’arrêtent un moment les amants de L’Avventura, le carrefour de L’Eclipse est dépouillé de tout drame, comme de toute signification, et pas même celle de l’absence de toute signification, simple espace de jeu où se croisent, se suivent, s’approchent ou s’éloignent les parcours aléatoires des vivants sur la terre. La nuit tombe, accentuant les noirs et désaccordant la gamme musicale des gris subtils que tout le film, magistralement, n’a cessé de nuancer. L’Eclipse se déroule pourtant pendant le jour de la liberté retrouvée, et non pendant la nuit des amants désunis. La nuit qui tombe est habitée par la blancheur du jour. Les lampadaires s’allument dans l’avenue déserte, la caméra zoome sur la grosse ampoule incandescente, et le dernier plan est tout illuminé par la lumière blanche du néon, comme une page vide sur laquelle il appartient désormais à Vittoria de dessiner elle-même la figure de son destin.
Parmi les passagers qui descendent du bus, il en est un qui s’avance en lisant un journal grand ouvert, L’Espresso, un journal qui s’adresse alors plutôt aux intellectuels (Piero, quant à lui, lit le Paese Sera, où ne figurent que les potins et les faits divers). Quand le lecteur passe devant la caméra, nous déchiffrons les gros titres de L’Espresso. Ils font allusion à la crise des missiles de Cuba, à l’opposition frontale de Khrouchtchev et de Kennedy qui voit un moment vaciller l’équilibre de la terreur. L’Eclipse occupe le temps mort, comme en suspens, d’une triple crise : crise des sentiments au lendemain d’une rupture amoureuse, crise financière d’un mini krach qui accompagne l’affolement des bourses pendant le boom économique de l’Italie d’après-guerre, et crise stratégique qui met en péril la paix mondiale assurée par la dissuasion nucléaire. La séquence finale se situe non seulement dans un carrefour de l’espace, mais aussi au carrefour des temps. Le temps est en suspens, l’histoire – non seulement celle avec un grand H qui est supposée témoigner pour l’évolution de l’humanité, mais aussi l’histoire qui compose la trame du scénario de ce film – retient son souffle. La grâce de Vittoria vient de ce qu’elle vit encore dans l’indétermination de son avenir. Parmi les titres qui figurent à la une de l’Espresso, on distingue encore un encart publicitaire pour un livre qui vient de paraître : Camilla Cederna – une sorte de Simone de Beauvoir italienne, célèbre alors pour sa rubrique dans ce journal – publie un reportage sur Marienbad, qu’elle a intitulé Où des couloirs interminables…, reportage donc sur le palace dans lequel Alain Resnais a situé son film, auquel Camilla Cederna fait allusion par le titre de son enquête, qui en est une citation tronquée, ce qui est une amusante façon d’interpréter le titre du film : quand L’Eclipse sort sur les écrans (1962), c’est en effet « l’année dernière », donc en 1961, qu’est sorti le film de Resnais : L’Année dernière à Marienbad. Antonioni semble ainsi désireux de marquer sa dette envers l’autre grand cinéaste du couple, Alain Resnais, qui vient récemment d’accéder à la célébrité, non seulement par Marienbad, mais d’abord par un film qui avait produit un effet de sidération, et qui n’a rien perdu aujourd’hui de son incantation hypnotique : Hiroshima mon amour, sorti en 1959.
De même qu’il n’y a pas de meilleure introduction à l’art d’Antonioni que le court métrage qu’il tourne en 1942, Gente del Po, qui contient en germe tous les éléments de sa poétique, de même il n’y a pas de meilleure introduction au grand cinéma de l’amour passion disséqué par l’analyste Resnais que l’un de ses premiers courts métrages, le très remarquable Toute la mémoire du monde, sorti en 1956. En apparence, mais il faut se méfier des apparences avec Resnais le malicieux qui toujours cache son jeu, en apparence donc Toute la mémoire du monde est un court métrage d’une vingtaine de minutes consacré à la Bibliothèque Nationale de la rue de Richelieu, avec vues sur les salles de consultation, plongée dans le dédale des magasins (la voix off comparant le lieu au Nautilus du capitaine Nemo), descente dans la cité souterraine et description très exacte des processus d’enregistrement des ouvrages nouveaux : établissement de la notice, définition de sa cote, enfin localisation de l’étagère qui lui correspond et sur laquelle le livre est destiné à sommeiller jusqu’au jour où un visiteur l’appellera en salle de lecture. Il y a en effet tout cela dans Toute la mémoire du monde. Pourtant le film dit tout autre chose : il raconte l’histoire d’un amour passion. Il nous prépare à Hiroshima mon amour. Pour mieux rendre compte des étapes successives de l’enregistrement d’un livre, Resnais, animé par un désir qui semble de simple pédagogie, prend un exemplaire témoin dont il va suivre méticuleusement le parcours. Or, il se trouve que ce livre n’existe pas, ou du moins qu’il n’a d’autre existence que dans l’imagination du metteur en scène. On distingue péniblement la couverture ainsi que les premières pages de cet ouvrage, qui passe furtivement d’image en image, mais il n’est pourtant pas impossible à un regard attentif d’en scruter le contenu. Sur la couverture on découvre un magnifique portrait de Lucia Bosé, l’inquiète et ardente beauté qui régnait sur les deux premiers films d’Antonioni, tous deux ayant également frappés Resnais qui avait été ébloui par cette double démonstration : Chronique d’un amour de 1950, et La Dame sans camélia de 1953. Le jeune Resnais – il a vingt-huit ans en 1950 – encore obscur – il n’est alors que l’auteur de quelques courts métrages, dont deux au moins ne sont pas négligeables : sur Van Gogh en 1947 et sur Guernica en 1950 – reconnaît immédiatement le grand talent d’Antonioni – il n’est pas rare que de grands artistes se retrouvent alors même que le public n’a pas su encore les identifier. Cette première admiration ne sera pas sans rapport avec l’orientation que prendra par la suite son regard. La première de couverture est encore ornée d’un chat, dessinée par Remo Forlani qui est également l’auteur du texte lu par une voix off pendant le court métrage. Elle porte enfin un titre, Mars, ce qui est cohérent avec le fait que l’ouvrage sera catalogué par la bibliothécaire sous la rubrique : « Mars (planète). Astrophysique ». La fiche technique nous apprend encore qu’il s’agit d’un titre qui figure dans la collection « Petite planète », alors bien connue de tous les voyageurs, merveilleuse collection dirigée par Chris Marker, grand ami d’Alain Resnais, et mentionné en outre de façon cryptée dans le générique du court métrage sous le nom « Chris and Magic Marker ». Sans entrer dans le détail des multiples indications mentionnées au passage des plans, qui nous mettent comme au défi de reconstituer un jeu de piste, contentons-nous d’en formuler la signification générale : le livre qui porte l’image de l’idole sur laquelle a cristallisé la rêverie amoureuse d’un passionné de cinéma, tel le coup de foudre de la rencontre amoureuse, est enregistré dans l’immense bibliothèque, que le commentaire compare un moment à un gigantesque cerveau (« cette salle des catalogues qui est le cerveau de la bibliothèque nationale »), comme s’il était assimilé, digéré par le travail de mémoire, peu à peu intégré à l’identité du monstre cérébral, enfin enseveli dans l’oubli, qui est ici la poussière qui recouvre imperceptiblement les ouvrages sommeillant sur les étagères. Puis, le jour de la réminiscence, il est soudain tiré de l’ombre par le magasinier et remonté à la surface, sous la lumière d’une lampe, ouvert au regard d’une conscience attentive et chercheuse. Ainsi l’amour marque le souvenir et ressuscite le jour de la rencontre, qui réactualise les vieilles blessures, et fait remonter à la surface du fleuve le visage des noyées. Toute la mémoire du monde est un film sur l’amour fou, dont l’inspiration n’est par ailleurs pas étrangère au surréalisme que le jeune Resnais appréciait, un film sur l’amour fou dont Lucia Bosé (dont le prénom fait allusion à la lumière) est l’égérie. Il raconte comment le souvenir douloureux d’une rencontre éblouissante est peu à peu classé par la mémoire, et comment il revient parfois à l’esprit, constituant alors un fragment dans un puzzle infini sur lequel se compose l’image problématique de notre bonheur. Tel est le sens de la dernière phrase, pourtant bien mystérieuse : « Ici se préfigure un temps où toutes les énigmes seront résolues, un temps où cet univers – et quelques autres – nous livreront leur clef. Et cela seulement parce que ces lecteurs assis devant leurs morceaux de mémoire universelle auront mis bout à bout, les fragments d’un même secret, qui a peut-être un très beau nom, qui s’appelle le bonheur ». Reste à percer l’énigme du titre de l’ouvrage : pourquoi Mars, et non Vénus, traditionnellement responsable de l’obsession amoureuse ? Je risquerai cette explication : Lucia Bosé est encore la beauté qui figure sur la couverture de l’un des titres les plus séduisants de cette très séduisante collection « Petite Planète » (il s'agit du volume consacré à L'Italie, et rédigé par Paul Lechat, auquel fait peut-être allusion le chat ici dessiné par Remo Forlani), dont fait aussi partie l’ouvrage imaginaire né de la fantaisie de Resnais. Or c’est par l’Italie, par le biais de l’amour courtois passé sous influence arabe et de retour dans la péninsule via la Sicile de Frédéric II de Hohenstaufen, que la poétique de « l’amour à mort », chère à Resnais et thème constant de sa cinématographie, vient à nous. Guido Cavalcanti, poète contemporain de Dante, plaçait l’amour non sous le signe de la féminité vénusienne, mais sous celui de la virilité guerrière de Mars, dont le thème funeste est dominé par la violence et par la mort. Pour Resnais comme pour Cavalcanti, l’amour est la maladie à mort, la mortelle fascination qui conduit ses victimes, dominée par l’idole qui les vampirise, à l’affaiblissement, puis à l’extinction de toutes les forces vitales. L’assimilation de ce poison divin, transmué par le travail de mémoire, permet à l’intelligence qui consulte les archives du passé de reconstituer patiemment le visage de la bien aimée. Toute la mémoire du monde est une fable néoromantique, l’analyse méticuleuse des mécanismes de l’amour passion.
Transportons-nous maintenant de la rue de Richelieu à Paris sur la place de la paix à Hiroshima. Il s’agit ici, une fois encore, d’une histoire de résurrection, de la vie du temps retrouvé par le miracle de la rencontre amoureuse. Le générique s’ouvre sur la danse lente de corps nus enlacés – le film passait pour audacieux à sa sortie, malgré ce qui nous paraît aujourd’hui son extrême pudeur – que recouvre en silence une pluie de cendres scintillantes : ainsi la peau déchiquetée des grands brûlés d’Hiroshima le jour de la bombe (le 6 août 1945 à 8 h. 16 du matin), ainsi encore les corps pétrifiés à Pompéi par la lave du Vésuve, tel ce couple enlacé et minéralisé qu’on exhume, sous les yeux d’Alexander et Katherine dans le Voyage en Italie de Rossellini (1954), fossile en lequel ce couple sur le point de se dénouer contemple l’image de sa propre mort. Soudain, les peaux redeviennent lisses, et les cendres brûlantes se transforment en gouttes de sueurs qui perlent les corps après la tension de l’étreinte (13). La voix des amants recouvre progressivement la ritournelle lancinante de Giovanni Fusco. Les miraculés, rescapés de la mort même, se parlent. Nous ne saurons jamais leurs noms. Ils parlent pour tous les amants du monde, et il faut se résigner à nommer la Française « Elle » et le Japonais « Lui ». Chacun d’eux porte en lui le vide central autour duquel Antonioni tisse la trame de ses films : pour Lui, natif d’Hiroshima, c’est l’explosion de mille soleils un matin d’août sur la place dite aujourd’hui « de la Paix », éclair fulgurant qui a anéanti en un millième de seconde toute sa famille, l’épargnant parce que, soldat, il avait été consigné loin de là ; pour Elle, native de Nevers-en-France, c’est la blessure de ce qu’elle avouera en criant, à la fin du film, avoir été son premier amour, une liaison passionnée sous l’Occupation avec un soldat allemand quand elle avait vingt ans, son amant assassiné le jour de la Libération par un tireur embusqué. Les deux gouffres, autour desquels se sont difficilement reconstruites des identités à jamais problématiques, comme est à jamais problématique l’image du corps des grands brûlés, se font écho l’un à l’autre : la mémoire de la jeune femme est dévastée par l’explosion du coup de foudre, refoulée mais non surmontée, étouffée par le choix raisonnable du mariage, et l’amour porté aux deux enfants qui en sont issus ; la mémoire du Japonais, architecte, c'est-à-dire se consacrant à la reconstruction des villes anéanties, est saccagée par l’explosion de la première bombe nucléaire expérimentée sur nos semblables, sans qu’aucune justification stratégique ne semble pouvoir être avancée pour justifier un tel acte (on s’accorde à reconnaître aujourd’hui que la bombe d’Hiroshima visait davantage à impressionner les Soviétiques qu’à soumettre les Japonais). Certes, le parallèle, sur lequel repose toute la poétique du film, paraîtra téméraire, tant il nous semble inconcevable qu’on ose comparer l’Hiroshima sentimental d’une rencontre amoureuse vécue par une jeune provinciale à l’événement le plus marquant qui clôt la deuxième guerre mondiale, et nous fait entrer tragiquement dans l’âge du contemporain (14). Ne dit-Elle pas elle-même, mais il est vrai en pleurant, qu’il ne s’agissait après tout que d’une « histoire de quatre sous » (15) ? Chez Antonioni la cage d’escalier en laquelle sont précipités les morts qui lestent nos mémoires est creusée par un drame affectif et personnel, même s’il existe aussi chez cet artiste une réflexion sociologique sur l’évolution du couple, par l’émancipation de la condition féminine, par l’enrichissement de l’après guerre, par la tentative dérisoire de combler par la frénésie de la consommation le néant qui nous voue à l’ennui. Chez Resnais, le vide qui mine nos âmes peut être nommé plus précisément, non par lui-même, destiné peut-être à demeurer dans l’innommable, mais par les noms que l’Histoire a fortuitement associé à ces catastrophes originaires. L’œuvre de Resnais les nomme précisément : Auschwitz (Nuit et brouillard, 1956) et Hiroshima (Hiroshima mon amour, 1959), deux événements qui défient l’intelligence, mais que nous sommes pourtant condamnés à expier tant que nous ne saurons pas lucidement en rendre compte. L’âge contemporain, semble énoncer ce grand poète, est malade de ne pas savoir penser le double événement qui se trouve à son fondement, scènes primitives qui ouvrent dans nos mémoires une fissure mortelle que les mots ne savent pas colmater. Ce qui nous conduit à reconnaître, une fois encore, l’incommensurabilité du chagrin d’amour de la Nivernaise avec l’horreur d’Hiroshima. Aussi n’entrera-t-ELLE pas dans la mémoire du Japonais, à jamais celée par l’indicible : « ELLE (bas) — Ecoute... Je sais... Je sais tout. Ça a continué. LUI — Rien. Tu ne sais rien. » (16) Tous ses efforts pour comprendre l’absence qui creuse en l’Autre la figure d’une énigme seront vains : « ELLE — J’ai tout vu… Tout. LUI — Non, tu n’as rien vu à Hiroshima. » (17) En revanche, si le secret de l’âme du Japonais ne peut être déverrouillé, celui de la jeune femme sera méthodiquement déchiffré par le rescapé d’Hiroshima. La scène clé du film se situe au Café du fleuve (18), en fait un « Tea Room », comme il est écrit, dans la langue du vainqueur, à l’entrée, sur le bord de la rivière Ota dont le delta à sept branches se jette, non loin d’Hiroshima, dans l’océan pacifique (« place de la paix », « océan pacifique », paquet de cigarettes « Peace » : jamais la paix n’a autant été invoquée que dans la proximité du lieu où la guerre a fait exploser sa plus inhumaine sauvagerie). La rivière Ota et la Loire, qui coule à Nevers, « sans navigation aucune », sans autre justification que la beauté de sa lumière (19), se répondent. Le film est tout entier placé sous le signe de l’eau, son écoulement lent, son inlassable patience, comme il est placé sous le signe du Temps, de la mémoire et de l’oubli. Nevers n’a-t-il pas été choisi comme nom de baptême pour la ville destinée à incarner l’irréversible : never, « jamais », à la façon du corbeau d’Edgar Poe qui répond toujours, aux questions inquiètes de l’amant de la défunte Lénore, Nevermore, « jamais plus ». La pierre et l’eau, ce qui veut demeurer et ce qui dissout, sont partout mêlés à Hiroshima comme à Nevers, comme dans les pierres friables, suant l’eau de la Loire et encroutées de salpêtre, de la cave où se trouve incarcérée la jeune fille tondue par les Résistants de la onzième heure pour avoir aimé un Boche. L’eau coule de toutes parts dans le Casablanca – boîte de nuit en laquelle vient échouer la jeune femme, ne sachant comment « tuer le temps » avant le départ de son avion pour la France (20), clin d’œil au film de Michael Curtiz (1942 ; le thème musical du film, Play as time goes by…, toujours réclamé au pianiste – « Play it again, Sam » – conviendrait fort bien au film de Resnais) – dans un décor aquatique qui se donne un petit air hollywoodien (Resnais prend un soin malicieux à gommer tout pittoresque exotique dans les épisodes japonais). C’est ainsi au bord de la rivière Ota, dans le Café du fleuve, et tandis que le coassement des grenouilles se mêle à la valse-ritournelle de Georges Delerue, que la jeune femme se rappellera ce qu’elle avait toujours tu depuis le mort de Nevers, et formulera devant le Japonais le secret qu’elle n’avait jamais avoué à son mari (21). Par la puissance d’appel que prend pour elle la parole du Japonais, et, à travers cette parole, l’indicible horreur d’Hiroshima, la réminiscence se fera hallucination, et la Française revivra, comme une possédée, le deuil de son premier amour (22).
A la modernité anonyme, impersonnelle, au style international d’Hiroshima reconstruit – comme si la ville voulait gommer toute trace du passé, oblitérer ce qu’on ne peut pas dire – s’oppose la vieille Nevers, avec ses demeures du XVIIIe siècle, ses murailles délabrées, ses rues qui portent le poids des années ; de même, à la mémoire close, prisonnière de l’innommable, du Japonais, s’oppose la mémoire amoureuse, ouverte de la Française qui cède à l’invitation de la réminiscence. L’un et l’autre se ressemblent, et Lui s’attache à Elle, réfléchissant dans sa souffrance, comme dans un miroir, l’image à jamais muette de sa propre souffrance. Seul le miracle de la rencontre peut ainsi nouer un lien entre les antipodes, et faire se correspondre deux lointains que rien ne destinait à s’unir : « Comment me serais-je douté, dit-Elle, que cette ville était faite à la taille de l’amour ? » (23) La jeune femme retournera-t-elle en France, délivrée de son passé, redevenue ce qu’elle était avant la tragédie de Nevers ? Ou restera-t-elle avec le Japonais, à jamais aliénée à cet autre qui a su la rendre à elle-même, le transfert s’effectuant par la correspondance des souffrances communes ? Je crois qu’il faut espérer que, libérée de ses hantises, elle abandonne Hiroshima derrière elle, et avec Hiroshima Nevers, désormais libre pour tous les lieux de la terre (24). Seul le Japonais demeure à Hiroshima jusqu’à la fin des temps, avec son indicible secret. Alain Resnais laisse en suspens cette fin, les deux amants se retrouvant dans la chambre de l’Hôtel New Hiroshima, et se baptisant réciproquement dans une réciproque reconnaissance : « ELLE : – Hi-ro-shi-ma. C’est ton nom. LUI : – C’est mon nom. Oui. Ton nom à toi est Nevers. Ne-vers-en-Fran-ce. » (25)
NOTES
1- Le métier de vivre (25 mars 1950), dans Cesare Pavese, Œuvres, « Quarto », Gallimard, 2008, p. 1795.
2- Dans Hiroshima mon amour, explique Deleuze, « Il y a deux personnages, mais chacun a sa propre mémoire étrangère à l’autre. Il n’y a plus rien de commun. C’est comme deux régions de passé incommensurables, Hiroshima, Nevers. Et tandis que le Japonais refuse que la femme entre dans sa propre région (“– J’ai tout vu… tout… – Tu n’as rien vu à Hiroshima, rien…”), la femme attire dans la sienne le Japonais volontaire et consentant, jusqu’à un certain point. N’est-ce pas pour chacun une manière d’oublier sa propre mémoire, et de se faire une mémoire à deux, comme si la mémoire maintenant devenait monde et se détachait de leurs personnes ? » (Gilles Deleuze, Cinéma 2 – L’image-temps, Minuit, 1985, p. 154). Remarquons pourtant qu’une fois accomplie la réminiscence du mort resté à Nevers, il semble bien difficile aux deux protagonistes d’accepter leur séparation, ce qui laisse entendre qu’ils sont peut-être devenus moins « étrangers » l’un à l’autre, et qu’ils ont désormais quelque chose en « commun ».
3- Voici la citation complète : « Il n’est pas vrai que le néoréalisme est fini, il évolue, car un mouvement, un courant ne finissent pas tant qu’ils ne sont pas remplacés par un développement postérieur. Il n’y a pas de solution de continuité. Le néoréalisme d’après-guerre, lorsque la réalité était si cuisante et immédiate, attirait l’attention sur le rapport existant entre le personnage et la réalité. C’est ce rapport justement qui était important et qui créait un cinéma de situation. Maintenant au contraire que la réalité s’est normalisée tant bien que mal, il me semble plus intéressant d’examiner ce qu’il est resté dans les personnages de leurs expériences passées. C’est pourquoi il ne me semble plus important aujourd’hui de faire un film sur un homme à qui on a volé sa bicyclette. C'est-à-dire sur un personnage dont l’importance provient du fait qu’on lui a volé sa bicyclette (surtout et exclusivement). On ne cherche pas à savoir s’il est timide, s’il aime sa femme, s’il est jaloux, etc. (On ne s’intéresse pas à cet aspect du personnage parce que seule importe cette mésaventure du [122] vol de la bicyclette qui l’empêche de travailler et nous devons suivre cet homme dans sa recherche. Aujourd’hui que nous avons éliminé le problème de la bicyclette –je parle par métaphore, essayez de me comprendre au-delà de mes paroles), il est important de voir ce qu’il y a dans l’esprit et le cœur de cet homme à qui on a volé sa bicyclette, comment il s’est adapté, ce qu’il est resté en lui de toutes ses expériences passées de la guerre, de l’après-guerre, de tout ce qui est arrivé dans notre pays, un pays justement qui, comme tant d’autres, est sorti d’une aventure si importante et si grave » (« Colloque », Cinéma, septembre-octobre 1958).
4- André Bazin « Le réalisme cinématographique et l’école italienne de la Libération » (Esprit, janvier 1948) ; et Hovald (Patrice G.), Le néoréalisme italien et ses créateurs, Cerf, 1959.
5- Antonioni, cité par Pierre Leprohon, Michelangelo Antonioni, présentation et choix de textes, « Cinéma d’aujourd’hui », Seghers, 1969, p. 28.
6- Fusées, X ; in Charles Baudelaire, Œuvres complètes, « Bibliothèque de la Pléiade », Gallimard, 1961, p. 1255.
7- Aldo Tassone, Antonioni, « Champs Art », Flammarion, 2007 [1985], p. 162.
8- Dominique Fernandez, « Antonioni, poète du matriarcat », NRF, 1er novembre 1960 ; cité par Pierre Leprohon, Michelangelo Antonioni, présentation et choix de textes, « Cinéma d’aujourd’hui », Seghers, 1969 [1961], p. 166.
9- « Comme plus tard le désert dans Profession : reporter, l’île volcanique de Lisca Bianca confère aux personnages une part de son étrangeté et de son mystère. Dans ce paysage lunaire à la Max Ernst, pétrifié et comme gelé et suprêmement indifférent, les sauveteurs errent sans conviction et finissent par se perdre tandis que leur entreprise se dissout. Louis Seguin relève aussi chez Antonioni la volonté de pétrifier le paysage. Ni mère, ni marâtre, la nature n’est pas en harmonie avec le drame intérieur des personnages, ne se lie avec personne et ne reflète rien : elle est tout simplement là » (Aldo Tassone, Antonioni, « Champs Art », Flammarion, 2007 [1985], p. 219).
10- Les Lettres françaises, 26 mai 1960, cité dans Cinéma 60, octobre 1960 ; et Pierre Leprohon, Michelangelo Antonioni, présentation et choix de textes, « Cinéma d’aujourd’hui », Seghers, 1969 [1961], p. 134-135.
11- Michelangelo Antonioni, Quel bowling sul Tevere, Turin, 1983, p. 196. Voir aussi Seymour Chatman, Antonioni, or The Surface of the World, Berkeley, Los Angeles et Londres, University of California, 1985, p. 72-73.
12- Ce bonheur du décollage est à mettre en rapport avec la joie de Lidia qui, au cours de son escapade dans La Notte, se réjouit de voir de jeunes amateurs lancer dans un faubourg de Milan des fusées qui s’élancent d’un coup vers le ciel.
13- Marguerite Duras, Hiroshima mon amour, « Folio », Gallimard, 1960, p. 9-10 : « Ce couple de fortune, on ne le voit pas au début du film. Ni elle. Ni lui. On voit en leur lieu et place des corps mutilés – à hauteur de tête et des hanches – remuants – en proie soit à l’amour, soit à l’agonie – et recouverts successivement des cendres, des rosées, de la mort atomique – et des sueurs de l’amour accompli. Ce n’est que peu à peu que, de ces corps informes, anonymes, sortiront leurs corps à eux. »
14- Marguerite Duras, op. cit. ., p. 10 : « Ce début, ce défilé des horreurs déjà célébrées de Hiroshima, évoqué dans un lit d’hôtel, cette évocation sacrilège, est volontaire. On peut parler de Hiroshima partout, même dans un lit d’hôtel, au cours des amours de rencontres, d’amours adultères. Les deux corps des héros, réellement épris, nous le rappelleront. Ce qui est vraiment sacrilège, si sacrilège il y a, c’est Hiroshima même. Ce n’est pas la peine d’être hypocrite et de déplacer la question. »
15- Marguerite Duras, op. cit., p. 118 : « Petite fille de Nevers / Petite coureuse de Nevers. / Un jour dans ses mains et elle croit au malheur d’aimer. / Petite fille de rien. / Morte d’amour à Nevers. / Petite tondue de Nevers je te donne à l’oubli ce soir. / Histoire de quatre sous. »
16- Marguerite Duras, op. cit., p. 30.
17- Marguerite Duras, op. cit., p. 22-23.
18- Marguerite Duras, op. cit., p. 14 : « Ils iront dans un café, sur le fleuve, “pour tuer le temps avant son départ”. La nuit déjà. » Duras décrit ainsi ce café : « Le fleuve se vide, se remplit suivant les heures, les marées. Des gens regardent parfois la lente montée de la marée le long des berges boueuses. Un café est en face de ce fleuve. C’est un café moderne, américanisé avec une grande baie. Lorsqu’on est assis dans le fond du café, on ne voit plus les rives du fleuve, mais seulement le fleuve lui-même. C’est dans cette imprécision que se dessine l’embouchure du fleuve. C’est là que finit Hiroshima et que commence le Pacifique » (ibid. p. 85).
19- Marguerite Duras, op. cit., p. 87 : « LUI : Et la Loire ? ELLE : C’est un fleuve sans navigation aucune, toujours vide, à cause de son cours irrégulier et de ses bancs de sable. En France, la Loire passe pour un fleuve très beau, à cause surtout de sa lumière… tellement douce, si tu savais. »
20- Marguerite Duras, op. cit., p. 83 : « LUI : Il ne nous reste plus maintenant qu’à tuer le temps qui nous sépare de ton départ. Encore seize heures pour ton avion. »
21- Marguerite Duras, op. cit., p. 103 : « LUI : Ton mari, il sait cette histoire ? ELLE : Non. LUI : Il n’y a que moi, alors ? ELLE : Oui. LUI : Il n’y a que moi qui sache. Moi seulement. »
22- Marguerite Duras, op. cit., p. 89 : « Ils se regardent à peine quand elle parle. Ils regardent Nevers. Ils sont, tous deux, un peu comme des possédés de Nevers. »
23- Marguerite Duras, op. cit., p. 35 : « ELLE : Qui es-tu ? / Tu me tues. / Tu me fais du bien. / Comment me serais-je douté que cette ville était faite à la taille de l’amour ? / Comment me serais-je douté que tu étais fait à la taille de mon corps même ? / Tu me plais. Quel événement. Tu me plais. / Quelle lenteur tout à coup. / Quelle douceur » ; et p. 114-115 : « ELLE : Je te rencontre. / Je me souviens de toi. / Cette ville était faite à la taille de l’amour. / Tu étais fait à la taille de mon corps même. / Qui es-tu ? / Tu me tues. »
24- Marguerite Duras, op. cit., p. 16, note : « Certains spectateurs du film ont cru qu’elle “finissait” par rester à Hiroshima. C’est possible. Je n’ai pas d’avis. L’ayant amenée à la limite de son refus de rester à Hiroshima, nous ne nous sommes pas préoccupés de savoir si – le film fini – elle arrivait à transgresser son refus. »
25- Marguerite Duras, op. cit., p. 124.
Pour lire la suite, cliquer ICI
|
|