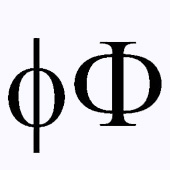|
PETIT ECHANGE AVEC CHATGPT
APHORISMES
ETRE ET EXISTER
ENSEIGNER LA PHILOSOPHIE
ESTHETIQUE DE L'ABSTRACTION
PRINCIPES DE PHILOSOPHIE ESTHETIQUE
LA PEINTURE HOLLANDAISE AU SIECLE D'OR
LES FANTOMES DE L'OPERA
ON DEVRAIT DIRE...
QU'EST-CE QUE LE NEOREALISME ?
1- Le néoréalisme italien
2- Le néoréalisme dans le monde
3- Le destin du couple
4- Personnages en quête d'auteur
5- Commediante...
6- Le cinéma dans le cinéma
LA STAR, LA VIVANTE ET LE SANS POURQUOI
ESTHETIQUE DU PARADIS TERRESTRE (1)
LE REALISME SELON CEZANNE
NOTE SUR WITTGENSTEIN
ENTRETIEN
CEZANNE ET LA FORCE DES CHOSES
MANTEGNA : ANCIENS ET MODERNES
LE TABLEAU ET LE MIROIR
LE JARDIN A LA FRANCAISE
REMBRANDT, BETHSABEE
PHILOSOPHIE ET RHETORIQUE
LES RELIGIONS DU LIVRE
DU CARACTERE A LA CARICATURE
QUELLE VANITE QUE LA PEINTURE...
LES GROTESQUES
LE ROSSIGNOL ET LA DIVA
LA STATUE AMOUREUSE
L'INTERPRETATION DE L'OEUVRE D'ART
DE L'IDEE DU BEAU A L'ESTHETIQUE
CARAVAGE ET L'OPERA
|
QU'EST-CE QUE LE NEOREALISME ?
REFLEXIONS SUR LE CINEMA
(1945-1960)
5- Commediante, Tragediante…
Pendant l’automne 1808, Napoléon rencontra à Erfurt le tsar de Russie Alexandre 1er. Il eut également à cette occasion une entrevue avec Goethe. L’entretien de l’Empereur avec le poète porta sur la tragédie, un genre vers lequel penchait alors le néoclassicisme de l’époque, en ce sens qu’on ne concevait pas de tragédie qui ne soit pas une transposition chez les Modernes de la tragédie de la Grèce ancienne. Selon Napoléon, « la tragédie appartient à une époque moins éclairée que la nôtre. Que nous importe aujourd’hui le destin ? C’est la politique qui est le destin » (1). L’Empereur entendait par là critiquer l’idée d’une renaissance de la tragédie chez les Modernes, l’antique destin, qui soumettait les mortels à la volonté des dieux, ayant laissé la place à la libre volonté des hommes, qui se dirigent par eux-mêmes, selon les règles de l’art politique, et font leur Histoire. Hegel se souvient de la formule de Napoléon, telle que Goethe nous l’a transmise, et choisit de la mettre en tête du chapitre consacré au « monde romain » dans son cours sur La Philosophie de l’histoire : « Napoléon dit à Goethe que ce qui ferait l’intérêt de la tragédie, ce serait le destin ; et que, chez nous, comme nous n’aurions plus ce fatum des Anciens, la politique pourrait prendre sa place. C’est à l’irrésistible violence de ces deux circonstances, au but de l’Etat et à son autorité – c’est à cet élément irrésistible que doivent nécessairement succomber les simples particularités, les individualités ; et ce qui vient à leur place, c’est la politique en tant que pouvoir, qui ne peut pas laisser faire les individus, mais doit les sacrifier. Tel est l’acte de l’Empire romain : le pouvoir comme universalité simplement abstraite, par lequel le destin, l’universel abstrait, fait son entrée dans l’Histoire » (2). En plaçant cette citation en ouverture du « monde romain », Hegel entendait lui signifier sa place au sein d’une Histoire qui accomplit la phénoménologie de la Raison. Entre le « monde grec », qui réalise l’unité organique de la cité-mère en laquelle tous ne font qu’un et par laquelle chacun trouve le caractère qui est le sien, et le « monde germanique », c'est-à-dire l’Empire chrétien fondé par Charlemagne en lequel l’individu ne se connaît lui-même que comme conscience malheureuse, sur cette terre en exil de sa vraie patrie, mais pourtant justement soumis aux lois des royaumes qui sont de ce monde, le « monde romain » est la médiation nécessaire qui doit former durement la libre individualité grecque – celle de la cité, qui est un tout indivisible, et non celle de la conscience malheureuse – à la loi inflexible de l’universel abstrait.
La pensée hégélienne de l’Histoire donne ainsi une signification grandiose au déclin de la tragédie, déclin que le philosophe, en accord avec l’Empereur, juge irréversible : il faut la puissance du pouvoir politique, dans la mesure où il incarne, comme le fait Napoléon à l’époque de l’Entrevue d’Erfurt, l’esprit qui gouverne le monde (3), pour soumettre les aspirations individuelles et anarchiques libérées par la révolution française à l’indépassable contrainte de l’Etat moderne, dont Napoléon est précisément l’initiateur le plus déterminant. Cette lecture, qui inscrit l’effacement du tragique dans le devenir rationnel de l’humanité, ne manque pas de grandeur. Mais elle occulte peut-être une autre lecture, plus prosaïque, qui interpréterait la dépréciation chez les Modernes de l’antique destin, non comme le signe annonciateur de la manifestation de la rationalité, mais comme le triomphe de la comédie, résultant nécessairement du déclin de la tragédie. Loin d’être pure rationalité, la modernité serait au contraire pénétrée du sentiment que tout est farce, et que le sublime tragique se résout aujourd’hui, nécessairement et en fin de compte, dans le dérisoire et le bouffon. N’est-il pas vrai que la figure de l’Empereur, telle qu’on la retrouve, assimilée et vulgarisée, dans la tradition populaire de la légende napoléonienne, se rapproche davantage de la caricature de la marionnette que du sublime de la majesté ? C’est ainsi que l’Histoire enfanterait une autre phénoménologie, théâtrale cette fois et non plus philosophique, qui ferait apparaître la comédie comme la vérité dissimulée par le masque solennel de la tragédie. Un beau texte d’Alfred de Vigny, qu’on lit dans Servitude et grandeur militaires (1835), approfondit cette intuition en la rapportant, comme il se doit, au génie italien qui s’y entend à railler l’esprit de sérieux et excelle dans l’art de la double lecture, tragicomique ou comico-tragique. Vigny imagine le récit, que lui aurait rapporté un capitaine de la Garde à la veille des Trois Glorieuses, de l’entrevue de Pie VII avec Napoléon, telle qu’elle aurait eu lieu à Fontainebleau le 28 novembre 1804, jour de l’arrivée du pape à Paris. Le Narrateur, alors aide de camp de l’Empereur, prétend avoir tout entendu, dissimulé sous une tenture. Bonaparte, intarissable, se lance dans un grand discours dans le but de détourner le pape de son siège romain, et de le convaincre d’installer à Paris le trône pontifical. Cette longue tirade, à la fois tyrannique et séductrice, ne vaut à l’Empereur, pour toute réponse, que ce mot : Commediante ! Entrant alors en fureur d’avoir été pris pour un simple histrion, l’Empereur rappelle au Vicaire du Christ, en des termes cinglants, que si le monde est une comédie, alors c’est à lui seul qu’il revient d’en écrire le scénario (4). La menace fait sourire le Saint Père qui, à nouveau ne prononce qu’un mot : Tragediante ! Accablé par la vérité de ce verdict, Napoléon, soudain mélancolique, reconnaît alors : « C’est vrai ! Tragédien ou Comédien. – Tout est rôle, tout est costume pour moi depuis longtemps et pour toujours. Quelle fatigue ! Quelle petitesse ! Poser ! Toujours poser ! De face pour ce parti, de profil pour celui-là, selon leur idée » (5).
Vigny sait attribuer dans ce texte, à Luigi Chiaramonti, un Emilien, une sagesse populaire enracinée dans le génie italien, mélange improbable de miséricorde et de raillerie. Ce que le pape dit ici à Napoléon, par ces deux seuls mots donnés en réponse au flot oratoire de l’auguste Empereur, vaut en général pour toute la littérature italienne, et en particulier pour le cinéma néoréaliste de l’immédiat après-guerre, comme pour celui qui a suivi, selon l’extension que nous avons donnée aux « années néoréalistes ». Nous avons jusqu’à présent surtout souligné la dimension tragique, ou du moins dramatique, du néoréalisme. Mais il est aisé de constater qu’elle se laisse volontiers retourner dans le registre comique. Après tout, l’Absurde est à la fois le destin accablant qui condamne Sisyphe à toujours pousser devant lui le rocher qui finira par l’écraser, et le coq à l’âne hilarant dont la mécanique provoque le rire. L’anti-héros de l’Absurde, si dramatique soit son destin, si pathétique soit sa demande, est toujours accompagné de son double secret, le clown Auguste qui toujours échoue en ses entreprises. On connaît le mot de Jean Anouilh sur la plus célèbre des pièces de Beckett, En attendant Godot (composée en 1948, jouée en 1952) : « Les Pensées de Pascal jouées par les Fratellini », mot par ailleurs tout à fait conforme à l’esprit de l’auteur qui écrivait à Roger Blin : « La signification de la pièce, pour autant qu’elle en ait une, c’est que rien n’est plus grotesque que le tragique » (9 janvier 1953). Vladimir – nom pompeux – et Estragon – nom ridicule – sont les deux clowns qui font la paire, bredouillant par leurs deux surnoms, Gogo et Didi, le nom de cet improbable Godot qui ne viendra jamais. Le quatuor des Vitelloni (1953) composait déjà un numéro de clowns, et Alberto, travesti en femme et dansant seul jusqu’au petit matin avec une grosse tête de carnaval, faisait dans la bande figure de clown triste. Où faut-il situer ce film : tragediante ? commediante ? Ce n’est pas ici le lieu de développer l’importance du rôle de l’Auguste dans les films de Fellini, de La Strada (1954) jusqu’aux Clowns (1971), et bien au-delà. Il suffit de montrer comment les thèmes les plus dramatiques du néoréalisme se laissent traduire dans le langage, sinon de la comédie, du moins de la satire ou dans celui de la parodie. C’est ainsi que l’absence de Dieu, son silence de mort qui tourmente tant le chevalier errant Antonius Block dans Le Septième sceau de Bergman (1957), peut très bien donner lieu à des scènes burlesques ou satiriques, au comique grinçant, dans le cinéma italien des années soixante. Dans La Dolce Vita (1960), le crucifix n’est plus qu’un gadget monumental, réplique du Christ Rédempteur au sommet du Pain-de-Sucre de Rio de Janeiro, et transporté par hélicoptère pour une consécration qui fera l’objet d’une retransmission télévisée. C’est encore la télévision qui est omniprésente dans la longue scène de l’Arbre du Miracle, un arbre des environs de Rome dans le feuillage duquel deux gamins sournois et retors, Maria et son frère Dario, prétendent avoir vu leur apparaître la Vierge, provoquant ainsi un invraisemblable cirque du fétichisme dévot. La famille prend pour les photographes des poses grotesques inspirées de l’iconographie chrétienne. La pluie provoque l’éclatement des projecteurs au gaz argon (son nom brille dans la nuit en lettres lumineuses, comme le dieu moderne des mises en scène télévisées) et achève en déroute ce qui avait commencé par la célébration du miracle. Au petit matin, un prêtre, celui-là même qui avait confié à Marcello que « les miracles se produisent dans le recueillement, et non dans cette foire (in questa confusione) », bénit le cadavre d’un infirme transporté là dans l’espoir de sa guérison, et abandonné sur sa civière. Et dans Fellini Roma (1972), un hallucinant défilé de mode ecclésiastique a lieu dans le palais fantomatique de la princesse Domitilla. D’immenses portraits d’anciens dignitaires de l’Eglise, vaguement inspirés du Greco ou de Goya, veillent comme des revenants sur ce défilé des spectres. Fellini avec Buñuel. Tandis que deux religieuses jouent à l’orgue un air guilleret à la Nino Rota, défilent des nonnes aux cornettes oscillantes avec le rythme de la musique, des curés de campagne sur patins à roulettes, des évêques dont les étoles scintillent comme des juke-boxes, un fantôme blanc masqué, inspiré du théâtre des sépulcres baroques, nous tend les bras, comme s’il voulait nous adresser une supplication d’outre-tombe. Enfin, comme pour conclure cette pavane funèbre, le Char de la Mort, avec ses squelettes chancelants, passe devant nous, précédant l’ultime et suprême numéro de cette catholique revue de cirque : un pape ostensoir, dont le visage fait penser à Pie XII, apparaît majestueusement au centre d’un immense disque lumineux, dans une mise en scène baroque rafraîchie par Hollywood. Nous voilà bien loin de l’austère rencontre, en noir et blanc, du chevalier avec la Mort, sur la plage, tous deux penchés sur l’échiquier.
Nous avions déjà eu l’occasion de constater que cette même plage, terrain vague et vide pendant la morte-saison, est le lieu métaphysique des errances existentielles, la morne plaine où errent les âmes en peine : les quatre Vitelloni viennent y tuer le temps (Fellini, 1953), Zampano, soudain conscient de la mort de Gelsomina, vient y pleurer toutes les larmes de son corps (La Strada, 1954), les couples aléatoires de Femmes entre elles viennent y mimer l’amour par désœuvrement (Antonioni, 1955), le Croisé Antonius Block y rencontre au petit matin la Mort même (Le Septième Sceau, 1957), et le chroniqueur mondain Marcello dans La Dolce Vita vient y échouer, se réfléchissant dans l’œil d’un monstre marin comme un dément dans un miroir de vanité (1960). Mais il existe encore une autre version, bien connue des Italiens, de la plage, celle de la saison estivale, quand la grande foire touristique bat son plein, et qu’au vide de l’hiver succède l’encombrement de l’été. Cette multitude de corps nus, qui se livrent avec application à des jeux répertoriés – drague et jeux de ballons, bronzage méthodique, ébats marins et trémoussements dansants au rythme du tube de l’été – offre un extravagant spectacle aux mille motifs burlesques. Comique cette fois encore grinçant, puisqu’il étale avec ostentation combien le boom des années cinquante-soixante passe en Italie par l’esbroufe de l’industrie touristique, le luxe tapageur des night-clubs de bord de plage, l’insouciance affectée des loisirs avant la reprise du travail. D’abord occupée par les Allemands après le départ de Mussolini, puis par les Américains à partir du débarquement de Sicile, et, la paix revenue, toujours dépendante des Etats-Unis par le plan Marshall, l’Italie doit encore subir l’invasion humiliante de hordes étrangères qui envahissent ses plages, ses villes et ses campagnes, et transforment progressivement le pays en une immense carte postale qui finit par ressembler à celles que l’on vend aux touristes. Dans le magnifique Fanfaron de Dino Risi, Bruno (Gassman) et Roberto (Trintignant) viennent échouer au beau milieu de la nuit sur la plage déserte de Castiglioncello, et s’endorment sous les étoiles sur des transats. Vers dix-onze heures du matin, Bruno se réveille, frappé par un ballon qu’ont lancé des enfants : la plage fourmille de monde, une sorte de bain turc à la Ingres multiplié à l’infini ! Le fanfaron est un peu perdu dans cette foule compacte, mais réussit tout de même à attirer l’attention grâce à quelques pitreries de gymnaste et à un match de ping-pong qu’il remporte de justesse ; pendant ce temps, Roberto-le-coincé promène son complexe parmi la multitude des déesses à demi nues. Le passage brutal du vide de la nuit au trop-plein du jour met en évidence l’absurdité bouffonne des rites estivaux. C’est sur cette plage que Bruno, père désinvolte et irresponsable, retrouve, pour un moment de sincère confidence, sa fille Lilly, jouée par Catherine Spaak, poupée Barbie grandeur nature qui tenait lieu de symbole du glamour cinématographique dans les années soixante. Elle le plaquera pourtant sans un mot pour une virée dans le yacht de son amant, un homme âgé et fortuné qui lui apporte, à défaut de grand amour, du moins la sécurité que ne lui a jamais donnée son père. La plage dans la belle saison est alors le lieu de toutes les illusions, des amours qui se forment en juillet pour se défaire à la fin août, comme le chantent les tubes diffusés par haut-parleurs. Le Fanfaron est une comédie à l’italienne, il en serait même, selon certains, le chef-d’œuvre. Si comique il y a, il faudrait toutefois parler de « comique noir » (on parle bien « d’humour noir »), comme on parle de « film noir » pour les histoires de gangsters qui conduisent invariablement à la mort violente du protagoniste.
La comédie à l’italienne (commedia all’italiana) démontre la relation d’équivalence, formulée par Beckett, du tragique et du grotesque. C’est le spectacle de l’angoisse, de la maladresse, du désarroi qui déclenche ici le rire. Il faudrait parler d’un comique au second degré, qui a perdu, du fait même de sa distanciation, la spontanéité et l’immédiateté de la franche rigolade. C’est bien ce que laisse entendre l’expression même de « comédie à l’italienne », et non « comédie italienne », comme on parle de la « comédie américaine » qui, précisément, réussit à engendrer une hilarité simple et directe que ne vient gâter aucune inquiétude. La comédie américaine ne prend pas son rire au sérieux, et c’est la raison pour laquelle sa fantaisie débridée est irrésistible ; mais la comédie à l’italienne exprime une risible détresse, un désopilant mal de vivre. « A l’italienne » : il faut comprendre à la manière des Italiens, réputés futiles et séducteurs par les touristes de passage qui s’offrent volontiers une aventure pour l’été. La comédie n’est pas italienne, elle joue avec le cliché de l’italianité, ce cliché que tout Italien a en horreur tant il est pour lui synonyme de renoncement et d’aliénation. La comédie à l’italienne est rongée par un mal secret, tandis que la comédie américaine est d’une désespérante santé, d’une increvable vitalité. L’une est la comédie des vainqueurs, l’autre la comédie des vaincus. Un excellent connaisseur du genre, Enrico Giacovelli, remarquait en ce sens que, dans Il successo (1963), un film peu connu en France de Dino Risi, Gassman se dirige la nuit vers le réfrigérateur pour apaiser son insomnie. Lieu commun des films américains des années 50 et 60, le héros nonchalant ouvrant avec indifférence au milieu de la nuit un immense réfrigérateur qui regorge de victuailles. Mais chez Gassman, dans le réfrigérateur, il n’y a qu’un reste, pas même comestible : « Dans les films américains, maugrée-t-il entre ses dents, il y a toujours une cuisse de poulet ; chez moi, il y a un demi-citron momifié » (6). Combien de verres de whisky à deux sous, de voitures au luxe ostentatoire, de twists de guinguette, de toilettes féminines ne sont-elles pas, dans la comédie à l’italienne, les répliques plus ou moins parodiques de leur modèle américains ? Et Anita Ekberg elle-même, dans La Dolce Vita (1960), habillée autant que déshabillée dans son fourreau noir, n’est-elle pas la caricature, fastueuse et outrancière, de son modèle américain, la somptueuse Rita Hayworth dans le Gilda de Charles Vidor (1946) (7) ? Il y a dans la mémoire italienne, hantée par les occupations et la guerre civile, le désespoir de n’avoir pas su se libérer elle-même, de demeurer assujettie à l’emprise de son vainqueur. L’Italia fara da se était la devise des Carbonari ; mais c’est précisément le drame de l’Italie, champ de bataille des puissances étrangères, de n’avoir jamais réussi à se faire elle-même. Cette dépendance, mi-avouée mi-dissimulée, sous des airs émancipés, par sa mauvaise foi elle-même, entre imbroglio et combinazione, est le douloureux secret du comique à l’italienne. Roberto Rossellini a trouvé les mots justes pour le dire : « Le rire italien ne se déclenche qu’à l’apparition d’une réalité brutale, et qui peut aller jusqu’à l’ignoble. Les Anglais pratiquaient l’humour en demi-teinte, et le sourire qui leur dégèle imperceptiblement la face. En Italie, nous préférons la rigolade, et nous la réservons aux choses qui nous frappent profondément. Est-ce une façon d’exorciser le malheur ? Une forme subtile de désespoir ? Ou peut-être la manifestation d’une secrète dignité ? Allez savoir. Mais vous ne nous ferez pas rire si vous ne dites pas quelque chose de bien cruel » (8). La comédie à l’italienne serait sans doute moins cruelle si, parmi les rôles inscrits à son répertoire, ne figurait celui de la Mort même. Dans l’univers de la comédie, il arrive traditionnellement qu’on reçoive sur le dos des coups de bâton ou des tartes à la crème en pleine figure ; mais le clown, copieusement rossé, se relève avec un grand rire et recommence aussitôt ses pitreries. Ce n’est que dans la tragédie, ou dans le drame, que le personnage court le risque de mourir effectivement. Il faut donc reconnaître que la comédie à l’italienne n’est pas sans affinité avec le monde tragique, puisque la mort y est effective, et qu’il est bien rare qu’on parvienne jusqu’à la fin sans que l’un des protagonistes n’y laisse sa peau : « Ce qui caractérise la comédie à l’italienne, remarque Giacovelli, et la distingue de la comédie traditionnelle, c’est donc, en premier lieu, la présence d’éléments dramatiques. Naturellement, ils ne doivent pas être trop nombreux, sinon il ne s’agirait plus d’une comédie mais bien, précisément, d’une comédie dramatique ; cela dit, il y en a quand même plus que dans une comédie normale. La mort, par exemple, y est souvent présente, alors qu’elle est inconnue de la comédie traditionnelle qui peut se permettre de l’ignorer, voire de la tourner en dérision. » (9) Comme le note José Pigliardini (10), les exemples ne manquent pas : dans Le Pigeon (I soliti ignoti, Monicelli, 1958), le truand Cosimo, à la suite d’un vol à la tire lamentablement raté, se fait écraser par un tram ; dans La Grande Guerre (Monicelli, 1959), outre les innombrables trouffions fauchés lors des assauts, Oreste (Sordi) et Giovanni (Gassman), les deux protagonistes du film, meurent à la fin, fusillés par les Autrichiens ; dans Le Veuf (Il Vedovo, Dino Risi, 1959), Alberto tombe lui-même dans le traquenard qu’il avait manigancé pour se débarrasser de son encombrante épouse ; dans Le Fanfaron (Il Sorpasso, Dino Risi, 1962), Roberto (Jean-Louis Trintignant), au terme d’une course folle, meurt écrasé dans la Lancia que Bruno, son flamboyant et catastrophique comparse, a précipitée, du haut de la route en corniche, sur les rochers du bord de mer. Cela fait tout de même beaucoup de cadavres pour un genre qui, dit-on, n’a d’autre prétention que de susciter le rire. Il arrive même, par un renversement presque extravagant, que le comique à l’italienne tourne au fantastique, et parfois même à l’épouvante. C’est ainsi que dans le film de Petro Germi, Séduite et abandonnée (1954), Don Vincenzo fait un cauchemar épouvantable, imaginant que tout le village, étant au courant du déshonneur de sa fille, le poursuit dans les rues de ses sarcasmes, l’humiliant ainsi cruellement aux yeux de tous (il finira d’ailleurs par en mourir, et l’on inscrira sur sa tombe : Onore e famiglia) ; à la fin du même film, Agnese, qui a succombé au pâle Peppino, doit traverser, accablée de honte, la place du village qui l’insulte et la presse avec une violence proche du lynchage (11). Il est vrai que la scène se situe en Sicile, foyers de tous les archaïsmes rétifs à la modernité, honte des gens du nord et de leurs ligues, qui n’ont que répugnance pour ces attardés. Le commissaire de police, qui assiste à tous les manèges du pater familias pour préserver la réputation de sa famille, maudit ces mœurs arriérées et, contemplant une carte de l’Italie, cache la Sicile de sa main droite et soupire : « Mieux, beaucoup mieux !.. Ou bien, une bombe atomique ! » On ne saurait assez s’étonner de la haine de soi qui tourmente la comédie à l’italienne, et engendre de terrifiants autoportraits : dans son film, Affreux, sales et méchants (Bruti, sporchi e cattivi, 1976), Ettore Scola nous décrit, dans un bidonville à la périphérie de Rome, non loin de Saint-Pierre dont on aperçoit souvent le dôme, une humanité répugnante qui vit de larcin, de prostitution, de trafics en tous genres, un sous-prolétariat hostile à toute solidarité, s’auto-exploitant avec plus de cruauté encore qu’il n’est lui-même exploité. Nous sommes bien loin de Miracle à Milan (1951) ! Dans cette société frappée par le chômage et le marasme, on trouve nombre de brutes et de truands, mais on ne trouve pas de « bon »… Et dans Pain et chocolat de Franco Brusati (1974), Nino, Italien immigré en Suisse dans l’espoir de trouver du travail et de profiter ainsi des miettes du paradis fiscal de l’Europe (la Suisse est le prolongement fortuné de l’Italie du nord, et Lugano, à deux pas de la frontière, est encore, par sa beauté et son architecture, italien) est expulsé pour avoir pissé dans la rue contre un mur, offense impardonnable à la religion helvétique de la propreté. Après diverses mésaventures, il en est réduit à travailler dans une usine à poulets, surexploité pour trucider et déplumer la volaille à tour de bras du matin au soir. Ses misérables compagnons n’ont d’autre divertissement que de guigner avec envie les jeunes dieux qui, dans la villa luxueuse qui jouxte l’usine, s’ébattent avec grâce dans une piscine de rêve. Lorsque Nino, par dérision, imite le caquetage de la poule, il y a presque une volonté de mortification dans cet abaissement à l’animalité qui fait ressortir, par contraste, la supériorité de la race des seigneurs, grands et blonds, qui jouissent à deux pas de la richesse et du loisir (12). Et le sarcasme est d’autant plus cruel que Nino, joué par l’aimable Nino Manfredi, incarne l’Italien type, cheveux noirs et frisés, débonnaire et souriant, la guitare à la main, toujours prêt à donner la sérénade. La caricature est presque invariablement le portrait des autres. Il est rare qu’un autoportrait soit une caricature. C’est pourtant le cas pour l’Italie au miroir de la comédie à l’italienne.
Selon les chronologies, nécessairement arbitraires, proposées par les historiens du cinéma, on date la naissance de la comédie à l’italienne du Pigeon de Mario Monicelli (en italien : I Soliti Ignoti, mot à mot : « les habituels inconnus », comprendre : « la routine des faits divers non encore élucidés ») sorti en 1958. Le film est exemplaire de l’humour grinçant, du masochisme sarcastique du comique à l’italienne. Il s’agit en effet d’une parodie du film noir, sur le modèle, avoué par son auteur, du Rififi chez les hommes (1955) de Jules Dassin, lui-même inspiré de Quand la ville dort (Asphalt Jungle, 1950) de John Huston. En espagnol, le titre du film est en effet Rufufú, équivalent du français Rififi. Monicelli s’amuse à parodier le professionnalisme américain. Aux gangsters virils et aguerris de Huston, il oppose une bande de branquignols qui, munis d’un matériel vétuste et inopérant, entreprennent de braquer le coffre-fort d’un Mont-de-piété, caverne d’Ali-Baba pour les miséreux qui doivent y déposer toutes leurs richesses. Ils s’introduisent dans l’appartement mitoyen, percent le mur qui les sépare du trésor, et se retrouvent dans la cuisine du même appartement, cuisine, comme le remarquera ingénument la chronique des faits divers dans le journal du lendemain, qu’ils auraient pu atteindre sans effort en passant par le couloir ! Il ne leur reste plus, faute de coffre-fort, qu’à dévaliser le réfrigérateur (dont la forme compacte ressemblait à l’époque effectivement à un coffre-fort), et à se partager les pauvres pâtes aux pois chiches qu’ils y trouvent, en accommodant leur pitance de commentaires gastronomiques. Il faudrait comparer terme à terme la bouffonnerie italienne à son modèle américain : le générique, au rythme jazzy du saxo, s’ouvre sur le vol raté d’une voiture, symbole de la richesse en ce début de la reprise économique. Cosimo, le truand, après avoir brisé une vitre, essaie une à une les clés de contact de son trousseau, sans trouver la bonne. Ce qui est suspense dans le film noir américain est ici amateurisme burlesque. Quand les policiers arrivent, prévenus par le déclenchement intempestif du klaxon, Cosimo veut prendre la fuite, mais il est retenu par son imperméable coincé dans la portière. La suite joue sur le même registre : Mario (Renato Salvatori), le voleur bien inoffensif de la bande, à défaut de voler des voitures, vole des landaus. Ces terreurs sont des enfants qui jouent au gendarme et au voleur, et Tiberio (Mastroianni), photographe que la misère a réduit à vendre son appareil, est toujours encombré d’un bébé brailleur, que lui a laissé sur les bras (dont l’un est dans le plâtre) son épouse emprisonnée pour trafic de cigarettes, américaines bien entendu… On trouve même une savoureuse parodie du must du film noir : la poursuite en voiture. Dans une fête foraine, Cosimo retrouve Pepe (Gassman), avec lequel il a un compte à régler, en virée avec Nicoletta sur la piste des autos tamponneuses. D’un ton sans réplique, il hèle un gamin de dix ans puis monte dans son engin : « Eh ! Garçon ! Suis cette voiture ! », dit-il en lui désignant l’auto tamponneuse où se trouve Pepe. Outre qu’il y a quelque chose de ridicule dans le fait de poursuivre une voiture qui se trouve prisonnière de la piste rectangulaire de l’attraction foraine, cette transposition du crime dans le domaine du jeu contribue à l’infantilisation de ces soi-disant durs à cuire. Même dérision quand, quelques instants plus tard, Cosimo menace Pepe, boxeur minable qui se pose en chef de bande, avec un fusil à fléchettes. Ou bien encore, lorsque le même inénarrable Cosimo entreprend de braquer le Mont-de-piété, décidément unique objet de la convoitise des damnés de la terre, avec un flingue que le guichetier, impassible, évalue aussitôt à bas prix. Le hold-up lui-même est une longue farce, Toto, vieux professeur recyclé dans le crime organisé, développant sur un ton doctoral, sur la terrasse d’un immeuble délabré, l’art et la manière de percer les coffres-forts, interrompu avant la fin de son exposé par l’arrivée inopinée des gendarmes. Ce génie italien, et plus proprement romain, de la pasquinade et de la parodie, se retrouve dans le western qu’on dit « spaghetti », comme on dit de la comédie qu’elle est « à l’italienne ». Remarquons à ce propos que le jeu de Clint Eastwood dans les deux films qui ont rendu célèbre Sergio Leone, Pour une poignée de dollars (1964) et Et pour quelques dollars de plus (1965), est directement inspiré du jeu de Pietro Germi, acteur et réalisateur dans un film proche de l’esprit du néoréalisme, Il ferroviere (Le Disque rouge, 1956) ou dans son magnifique Meurtre à l’italienne (Un maledetto imbroglio, 1959) : la façon qu’à l’Américain de mâchouiller son cigarillo et de le faire passer prestement d’un bord à l’autre de ses lèvres, est reprise du jeu imposant de Germi. Avec la transposition du film noir dans les aventures des pieds nickelés, comme de l’épopée du western dans la stylisation caricaturale de sa forme « spaghetti », il y a à la fois de l’admiration et de l’envie, le désir de se rendre semblable à l’idéal et la volonté de le dénigrer méchamment. N’oublions pas que pour les Italiens l’occupation américaine n’a fait que prendre le relais de l’occupation allemande, et qu’elle s’est poursuivie après la guerre, avec la complicité de la démocratie chrétienne, par la colonisation économique du plan Marshall et l’invasion touristique. Tel est bien le sens de la parabole que propose en 1972 Luigi Comencini avec son Argent de la vieille. Ce n’est pas un hasard si la vieille milliardaire, qui vient chaque année défier au jeu de la scopa (le titre italien du film est : Lo Scopone scientifico) les pauvres habitants d’un bidonville romain, est jouée par Bette Davis, accompagnée de son secrétaire et amant George, joué par Joseph Cotten. Bette Davis, illustre star d’Hollywood, s’est fait connaître dans les rôles de garces, par exemple dans le film de King Vidor intitulé précisément, dans sa version française, La Garce (Beyond the Forest, 1949) ; quant à Joseph Cotten (qui est dans La Garce le mari infortuné de Bette Davis), c’est également une grande figure du cinéma américain, puisqu’on le voit, excusez du peu, dans Citizen Kane (1941), La Splendeur des Amberson (1942) et Le troisième homme (1949) ! La roublardise de la milliardaire, certaine de l’emporter puisque, doublant toujours la mise, elle exténue nécessairement par sa richesse la résistance de ses partenaires, prend plaisir à humilier ces crève-la-faim, les contraignant à reconnaître la légitimité de sa fortune, qu’elle doit apparemment à sa seule astuce. Image transparente des emprunts répétés que les Etats-Unis proposent à l’Italie pour sa reconstruction dans la période de l’après-guerre. L’unique moyen d’en sortir, suggère Monicelli, c’est encore celui trouvé par Cléopâtre, la fille de Peppino et Antonia, les victimes que la vieille martyrise, Cléopâtre qui offre à l’Américaine, sur le point de prendre son avion, un magnifique gâteau bourré de mort-aux-rats (13).
Si l’on s’accorde à reconnaître dans Le Pigeon le premier-né de la comédie à l’italienne, c’est aussi en raison de la date de sa sortie : 1958. Nous sommes en effet dans les premières années de l’extraordinaire « boom » (14) (en italien : miracolo economico) que connaît la Péninsule dans les années d’après-guerre, entre 1954 et 1963, une fois passées les années de grande misère, de la capitulation allemande et de la fin de la guerre civile jusqu’à la reprise, ce qui fait tout de même presque une dizaine d’années… Formidable accroissement des richesses (le produit intérieur brut double entre 1951 et 1963 !) qui s’accompagne d’un tout aussi formidable accroissement des inégalités. Les nouveaux riches écrasent de leur mépris les laissés-pour-compte. En quelques années, l’Italie renie ses traditions pour entrer dans la « modernité », l’ancienne sagesse des terroirs, attachée aux dialectes que le néoréalisme avait réhabilités, devient un phénomène archaïque, une mentalité d’arriérés. Rien de plus significatif à ce propos que le jugement porté par les Italiens sur la Sicile, gardienne de très antiques croyances, par les hommes d’affaires milanais qui souhaitent débarrasser la nation de cet appendice primitif, périmé et dispendieux. Tel était, nous l’avons vu, le verdict sommaire du commissaire – il émettait le souhait d’anéantir la Sicile sous un bombardement nucléaire – dans le village sicilien de Séduite et abandonnée (Germi, 1964). La violence de cette rupture est à l’origine de la comédie à l’italienne, le néoréalisme proprement dit demeurant pour sa part attaché à un monde rural, aux traditions populaires, à un passé spécifiquement italien. De ce point de vue, le film de Luigi Zampa, Les années difficiles (1948), qui retrace les compromissions comme les démissions de la période fasciste (le protagoniste lance à la fin du film, à la figure de ses compatriotes : « Tous des lâches ! Nous sommes tous des lâches ! »), s’ouvre sur un portrait idyllique de la Sicile, détentrice de ce qu’il y a de plus authentique dans l’âme italienne. Une voix off évoque avec complaisance le bel paese (expression qui désigne l’Italie en son entier chez Dante comme chez Pétrarque) : « Voici la Sicile. Une terre antique et noble qui, sous un ciel inondé de soleil, a un aspect sévère et plein de mélancolie. Voici ces petites villes qui ont grandi au cours des siècles, dédaignant la froide géométrie des métropoles modernes, mais au contraire chaudes de vie, comme des plantes qui se seraient développées librement autour de la colline où a été lancée la première semence. Le peuple qui habite ces villes, pleines d’escaliers, de cours, de terrasses et de balcons, puise dans les expériences millénaires, dans les efforts incessants et dans ses malheurs, ce génie élémentaire et profond qu’on nomme le bon sens. » C’est pourtant cette même Sicile qui, quinze ans plus tard (Pietro Germi, Divorce à l’italienne, 1961, et Séduite et abandonnée, 1964), est devenue la terre de toutes les superstitions comme de tous les anachronismes. Que s’est-il passé ? Les petits villages pittoresques de la vieille Sicile ont laissé la place aux grands ensembles qu’on construit dans la périphérie des villes, où vient s’entasser un exode paysan issu pour sa plus grande partie du Mezzogiorno. Le passage de la tradition au modernisme, de l’héritage des anciens au choc du futur, s’est fait en Italie, plus qu’en aucun autre pays, en quelques années, provoquant un syndrome de dépaysement et d’inadaptation, dramatique en ce qu’il est pourvoyeur de délinquance et de criminalité, mais aussi comique dans la mesure où la figure de l’arriéré fait partie du répertoire de la comédie. Le bouffon est en fin de compte un inadapté égaré dans un monde qu’il ne comprend pas mais dont il est capable, du fait même de son exil, de son regard distancié, de formuler la vérité. On retrouve sans doute dans les comédies à l’italienne du cinéma des années soixante les masques traditionnels de la commedia dell’arte : c’est ainsi qu’Alberto Sordi, qui incarne l’Italien moyen, pusillanime et mesquin, couard et incorrigiblement égoïste, n’est pas sans faire songer à Arlequin ; le flamboyant Gassman ressuscite les figures de Matamore, Capitan ou Rodomont ; Ugo Tognazzi retrouve les accents du docteur Pantaleone, libertin et incorrigible séducteur, profiteur et calculateur ; Nino Manfredi endosse le costume des zanni, valets ingénus et amoureux, toujours à la recherche de leur Colombine ; seul peut-être Mastroianni échappe à la fixité du masque, s’adaptant avec élégance et toujours avec séduction, et comme sans y penser, à tous les rôles qu’on lui propose, du naïf Tiberio du Pigeon au cynique Féfé de Meurtre à l’italienne, de l’obsédé hétérosexuel, se rêvant en maître de son harem, de Huit et demi, à l’homosexuel attentionné d’Une Journée particulière. Tous ces masques, quelles que soient leurs singularités, ont cependant ceci de commun qu’ils se trouvent toujours en décalage dans la situation qui est la leur. C’est de cette discordance que naît le comique, de l’incapacité de la marionnette à se désempêtrer du quiproquo dont elle est elle-même la cause, et la seule responsable. Et c’est pourquoi leur détresse est tragicomique, non simplement bouffonne. La crise morale que connaît l’Italie pendant les années du boom se reconnaît parfaitement dans cette pantomime des égarés, en situation d’exil intérieur, devenant des étrangers dans leur propre pays. C’est ainsi que la vie du couple, que l’art d’Antonioni a su élever à la dignité d’une expérience métaphysique, est tout aussi bien un thème comique : le mâle italien se trouve complètement déphasé par l’émancipation de la femme qu’il croyait avoir cloîtrée dans son statut d’épouse, et qui prétend maintenant à la place dominante, tel Alberto Sordi, affairiste malchanceux et incapable, écrasé par Elvira, une féroce femme d’affaire, self made woman qui s’est construit une grande fortune. Pour se débarrasser de cette accablante marâtre, Sordi en est réduit à tramer un assassinat, destiné bien entendu à échouer, comme toutes les opérations que tente le pauvre homme (Il Vedovo, Dino Risi, 1959) (15). C’est en ce sens que l’on peut dire, en effet, que le personnage central autour duquel la comédie à l’italienne élabore son intrigue est toujours un « monstre », dans la mesure où le monstre est un vestige, attardé dans les temps modernes, d’un passé révolu. C’est cette monstruosité du gagman italien qui se trouve déclinée, comme autant d’espèces animales, dans les divers sketches des Monstres (Dino Risi, 1963), renouvelée et exacerbée quatorze ans ans plus tard dans Les nouveaux monstres (Monicelli, Risi et Scola, 1977). On sait comment le gouvernement italien, par la voix de Giulio Andreotti, s’était plaint de la noirceur du cinéma néoréaliste, qui donnait à l’étranger une image calamiteuse de la nation. Le dirigeant de la démocratie chrétienne n’avait pas apprécié le désespoir d’Umberto D., le chef d’œuvre de De Sica (1952) : « Si, à travers le monde, on finit par croire, bien à tort, que l’Italie d’Umberto D. est celle du milieu du XXe siècle, De Sica aura rendu un très mauvais service à sa patrie… Nous demandons à De Sica de ne jamais perdre de vue le fait qu’il doit, au minimum, viser un optimisme sain et constructif susceptible d’aider l’humanité à progresser » (16). Le gouvernement, plus soucieux de normalité que d’art, appelait de ses vœux une comédie à l’italienne qui substitue le rire aux larmes. Il se trouve que ce vœu a été exaucé, mais pas du tout dans le sens espéré par la Démocratie chrétienne. Et l’on peut se demander aujourd’hui, qui, des deux, dressait de son propre pays le constat le plus cruel, du drame néoréaliste ou de la comédie à l’italienne ?
Penchons-nous, pour terminer, sur deux grands films, à juste titre considérés comme des chefs-d’œuvre du genre, presque contemporains et tous deux du réalisateur Dino Risi : Une vie difficile (1961) et Le Fanfaron (1962). Le premier est une évocation, acerbe et goguenarde, de l’histoire de l’Italie dans le troisième quart du vingtième siècle, depuis la résistance contre l’occupation allemande jusqu’à la fin des années cinquante, alors que le pays connait un extraordinaire développement économique. Alberto Sordi est le clown triste, mais non dénué de grandeur, de cette odyssée catastrophique de la modernité. Le second est un remarquable portrait de l’Inadapté, à la fois témoin et martyr, pétulant et pathétique, dans l’interprétation éblouissante qu’en donne Vittorio Gassman. Commençons par Le Fanfaron, looser dissimulé sous le travesti du winner, et terminons par Une vie difficile, film dans lequel Sordi incarne le looser qui se reconnaît pour tel, et choisit en fin de compte d’assumer pleinement son rôle.
Le titre original du Fanfaron est Il Sorpasso, le dépassement. Ce dépassement, c’est bien sûr celui qu’effectue avec la plus grande imprudence Bruno, conducteur fou, sur la route des vacances. Mais le dépassement, c’est aussi celui auquel le miracolo economico contraint les Italiens, qui doivent chaque jour se réinventer pour s’adapter à la révolution perpétuelle du capitalisme triomphant. Le fanfaron est l’homme qui vit dans le constant surpassement de lui-même, exorbité par la frénésie consommatrice qui vient combler le vide qu’avaient ouvert les années de misère de l’immédiat après-guerre. Mais l’on comprendra bien vite que ce surpassement est en vérité un surplace, que l’exubérance du fanfaron n’est que le masque de sa pénurie, et que le luxe tapageur qu’il revendique n’est que l’écran de fumée qui dissimule une misère réelle, tant matérielle que spirituelle. Le personnage central, en ce sens qu’il détermine à lui seul le déroulement des événements – si l’on peut parler ainsi, car il s’agit plutôt en fait de tourner en rond – est un agité pathologique, apparemment débordant de vitalité, incapable de rester en place, et ayant pour cette raison élu domicile dans sa voiture, une « Lancia Aurelia Sport super compressée » et décapotable, dans laquelle il fait obstinément de la route, non pour aller quelque part, puisqu’il n’a nulle part où aller, mais pour ne pas rester au même endroit plus de quelques minutes, préférant toujours fuir plutôt que de se trouver dans la désagréable obligation d’assumer la situation qui est la sienne. La voiture est le triomphe de l’individualisme arrogant, et les transports collectifs sont faits pour les moutons. Ce que Bruno résume d’un mot fameux : « Oui, les bus sont pleins de gens honnêtes ! » Bruno Cortona (Gassman) veut être l’homme de l’hypermodernité, changeant de peau et de métier selon les modes et les opportunités (« un jour je vends des voitures, l’autre des réfrigérateurs, je saisis les opportunités »). Un quinze août (ferragosto) écrasé de chaleur, un de ces jours dont les Romains disent que seuls les chats et les touristes sont dehors à l’heure de la sieste, Bruno conduit avec panache sa Lancia (une superbe voiture, mais dont l’aile avant droite, qui vient d’être refaite par le carrossier, n’a pas encore été repeinte) dans les quartiers déserts de la périphérie de Rome, circulant entre les immeubles réguliers et monotones de la reconstruction. Il est à la recherche d’un paquet de cigarettes, américaines sans aucun doute. Avec le culot qui le caractérise, il s’introduit chez le jeune Roberto Mariani (Trintignant), studieusement enfermé chez lui pour réviser son prochain examen de droit. Bruno et Roberto, deux façons de répondre au défi du boom, deux interprétations de l’impératif absolu de l’époque : réussir à tout prix, soit par l’esbroufe et le brio (Bruno), soit par les études (Roberto). L’un et l’autre forment un bon duo de clowns, l’un extraverti, l’autre introverti, l’un d’un aplomb que rien n’entame, l’autre timide et réservé. La Lancia de Bruno est à l’image de son propriétaire : un carton « Camera Deputati » est placé en évidence sur le pare-brise (Bruno est persuadé qu’il suffit de cet appui pour éviter les ennuis, ce qui en dit long sur la réputation de corruption qui est alors celle de la classe politique italienne, mais qui s’avèrera illusoire quand un motard dressera contre Bruno un procès-verbal pour excès de vitesse), le klaxon tonitruant à quatre tons censé écarter tous les gêneurs de la route du fanfaron, les démarrages foudroyants qui laissent sur place les ploucs qui se laissent dépasser. Au fond, l’ébullition permanente de Bruno, en crise maniaco-maniaque chronique, n’est guère différente de la névrose qui traque la Giuliana du Désert rouge (Antonioni, 1964) : deux réactions, qui ne sont opposées qu’en apparence, à l’irréalité d’un monde qui semble avoir perdu toute humanité. Le fanfaron, si ignare soit-il, n’est pourtant pas dépourvu d’une certaine finesse, et parle avec sentiment de la belle chanson de Domenico Medugno, L’uomo in frack, alors à la mode, qui évoque un homme qui erre dans la nuit, haut-de-forme, gardénia à la boutonnière et canne avec pommeau de cristal, se dirige vers un pont et dit adieu au monde avant de se précipiter dans le fleuve. Ce qui nous vaut ceci : « Il y a tout là-dedans. L’incommunicabilité, la solitude. Et ce machin à la mode… L’aliénation, comme chez Antonioni. Tu as vu L’Eclipse ? J’ai roupillé. Quel metteur en scène, cet Antonioni ! » A la fin du film, en un ultime « sorpasso », la voiture de Bruno sera précipitée, du haut d’une route escarpée, dans la mer, entraînant Roberto, qui en meurt, mais épargnant l’inconscient qui l’a tué, Bruno éjecté sur le bord de la route. Magnifique visage de Gassman, un filet de sang sur la tempe, éperdu, soudain vrai et nu, dépouillé de tout son panache, rendu à sa solitude par la disparition de l’ami qu’il venait de s’inventer : « C’est un parent à vous ? lui demande le motard arrêté par l’accident – C’est Roberto. Son nom, je ne le sais pas. On s’est connu hier. » Il y avait aussi, dans L’Eclipse, une voiture tombée dans un lac, entraînant dans sa chute la mort de son conducteur, le vagabond ivre qui l’avait volée à son propriétaire, le jeune Piero, flirt sans lendemain de Vittoria. L’analogie est suggérée par les mots même que le scénario place dans la bouche du fanfaron. L’aveu final de la profonde détresse de Bruno, refoulée sous une apparence de faconde, trahit la vérité du personnage : le désarroi que s’efforce de cacher l’orgie consumériste du boom. Ce néant, Bruno, moins aveugle qu’il ne veut le paraître, le discerne avec une plus grande lucidité que le rêveur Roberto, trop tourné vers l’intériorité pour démasquer la vérité du monde extérieur : c’est Bruno qui révélera à Roberto, lors de leur visite, nécessairement de courte durée, dans la maison de campagne où celui-ci passait, enfant, ses vacances, la désolation qui pèse sur la famille : tante Enrica est une femme frustrée qui rêve qu’on la courtise, le fils de tante Lidia est un bâtard dont le père est le jardinier, quant à l’oncle, qui aimait à prendre dans ses bras Roberto enfant, son homosexualité est la vraie cause de cette ancienne affection. Roberto n’avait rien vu, c’est Bruno qui lui ouvre les yeux. Mais la misère sentimentale de cette famille dont Roberto avait conservé un souvenir idyllique ne vaut guère mieux que l’autre misère, plus désabusée et cynique, de la propre famille de Bruno : sa femme l’a depuis longtemps quitté, lassée de jouer les mamans auprès de cet « enfant » perpétuellement « malchanceux », selon ses propres termes ; et sa fille recherche, auprès d’un homme bien plus âgé qu’elle, la sécurité et le confort que son père ne lui a jamais donnés. Le constat d’échec est radical, et la fuite en avant de Bruno ne réussit pas à le surmonter. Le surpassement est illusoire et, s’il peut tuer, il est incapable de nous divertir durablement de notre néant.
Le miracle économique entraîne ainsi dans son tourbillon – vivre à cent à l’heure pourrait être la devise de Bruno – les victimes qui se laissent prendre au piège. Le consommateur, condamné au transformisme toujours recommencé de la mode, ne sait plus qui il est. Cette perte d’identité est aussi une perte de mémoire. C’est sans doute pourquoi la comédie à l’italienne se tourne volontiers vers l’histoire et revient vers le passé que l’impératif du présent conduit à refouler. C’est l’occasion de comprendre que l’on peut rire de tout, y compris et peut-être surtout du pire : dans La vie est belle de Roberto Benigni (1997), on entreprend de nous faire rire avec les malheurs d’un père et de son fils emprisonnés dans un camp de concentration nazi : Guido réussira à faire croire à son fils Josué qu’ils sont en vérité dans une colonie de vacances, participant à un jeu dont le prix est un tank allemand, dont il faut s’emparer… Dans un entretien qu’il donnait à l’occasion de la sortie de son film, Benigni déclarait que le pire est toujours pour la comédie le meilleur, et qu’il reste à réaliser un grand film comique sur le Calvaire, avec Jésus pour protagoniste. N’est-il pas vrai qu’Ernst Lubitsch avait réussi dès 1942 une comédie réjouissante en accordant le premier rôle à Hitler, ou du moins à l’acteur qui l’incarne, ce qui n’aurait sans pas été possible si Hitler, dans ses gesticulations et ses vociférations, n’avait déjà, de lui-même, quelque chose de l’acteur (To Be or Not to Be). La comédie à l’italienne s’efforce ainsi de revenir par le rire sur un passé oublié à force d’avoir été dépassé. C’est ainsi que Les années difficiles (1948), de Luigi Zampa, évoque le conformisme et les compromissions des derniers temps du fascisme. Le ventennio, les presque vingt ans du règne de Mussolini, est en effet, aux yeux des Italiens, plus comique que tragique, tel qu’on le voit évoqué dans Amarcord (Fellini, 1973), bien que le défilé au pas de course des bersaglieri, puis la rage avec laquelle les fascistes entreprennent de détruire le phonographe caché dans le clocher qui égrène les notes de l’Internationale, laissent deviner une violence plus inquiétante, même si elle s’exprime ici de manière plutôt cocasse. Le ton du magnifique Une journée particulière d’Ettore Scola (1977) était certainement plus grave, et Scola s’était essayé, trois ans auparavant, à la remémoration de l’histoire toujours troublée et trop souvent arrangée de l’Italie contemporaine, avec son plus grand succès : Nous nous sommes tant aimés (1977), acerbe chronique de trois maquisards, camarades condamnés à perdre toutes leurs illusions et que la vie se charge de désunir. Bien que ces films ne soient pas étrangers au ton comique, on ne saurait cependant les classer dans le cadre de la comédie à l’italienne. Il n’en va pas de même avec l’autre chef d’œuvre de Dino Risi, Une vie difficile, qui sort en 1961, un an avant Le fanfaron. Le personnage central, superbement incarné par Alberto Sordi, n’est plus ici un Matamore comme l’était Gassman dans Il Sorpasso, mais plutôt une sorte de don Quichotte qui s’oppose pathétiquement à la déferlante de l’histoire, refusant de céder aux sirènes du miracle économique, et prétendant conserver, envers et contre tous, son indépendance d’esprit. Les maîtres du jour lui feront payer cher cette tentative d’émancipation, et, s’il en viendra, après bien des mésaventures, à se plier à leurs caprices, c’est à lui pourtant que sera laissé le mot de la fin avec une gifle retentissante qui, si elle présage le retour de la « vie difficile », n’en est pas moins réjouissante. Silvio Magnozzi (Alberto Sordi), résistant traqué par les Allemands, vient se réfugier aux bords du lac de Côme, caché par la fille de l’aubergiste, Elena (Lea Massari), dont il fait bientôt sa maîtresse. Il s’enfuit pourtant sans laisser d’adresse et revient à Rome, ville ouverte à l’avance de la cinquième armée américaine. Journaliste au quotidien communiste Il Lavoraro, il propose de titrer, lors de l’entrée des Américains, sur cinq colonnes à la une : « Les Américains hors de Rome ! » Le directeur du journal, qui lui donne un salaire de misère, doit calmer sa fougue suicidaire. Après avoir retrouvé Elena lors d’un reportage sur « l’or de Dongo » (l’or emporté par les fascistes pendant l’ultime fuite de Mussolini), et l’avoir emmenée avec lui dans la chambre misérable qu’il occupe à Rome, tous deux décident de vivre en couple, malgré les ambitions d’Elena, qui rêve surtout de confort et d’une belle voiture, symbole alors de la réussite sociale. Lors du référendum de 1946 qui verra l’Italie se prononcer pour la République, les deux jeunes gens affamés, chassés de tous les restaurants où ils ont accumulé des dettes, sont invités par miracle (il s’agissait en fait, comme ils l’apprendront bientôt, d’éviter aux convives de se retrouver treize à table) dans le palais du prince Rustichelli, nid de royalistes nostalgiques de l’ère fasciste. Magnifique cérémonial des spectres attablés pour un repas funèbre en l’honneur de la monarchie défunte. Elena s’efforce d’étouffer la fougue de Silvio, capable de compromettre cette bonne occasion, mais les royalistes, dépités par le résultat du référendum, quittent la table et laissent les deux jeunes gens s’empiffrer à leur guise, tandis qu’un sommelier solennel leur verse du champagne. Ce sera bien l’unique chance de Silvio. Les déboires vont désormais pour lui se succéder : après avoir refusé – malgré les sommes, considérables pour lui, qu’on lui offre – de retirer un article compromettant pour le commendatore véreux qui lui en faisait la proposition, Silvio se voit condamné à plus d’un an avec sursis pour diffamation par voie de presse ; et son sursis se transforme en deux ans ferme lorsqu’il est arrêté pendant les émeutes qui accompagnent la tentative d’assassinat de Togliatti, le fondateur du parti communiste italien, le 14 juillet 1948. Le jour même, il vient d’épouser Elena qui attend un enfant. Pendant ses années de prison, il tente de rédiger le roman de sa vie, et lui donne un titre : Les Années difficiles. A sa sortie de prison, il retrouve sa femme et son fils Paolo, mais aussi la « vie difficile » qui avait été la sienne : il apprend en effet qu’il est viré du journal, le directeur cédant à la prière d’Elena qui souhaite voir son mari occuper enfin un poste plus gratifiant. La mère d’Elena exprime alors explicitement le désir que sa fille n’ose déclarer ouvertement : « Devenez riches, revenez au village dans une belle voiture, pour que tous crèvent d’envie ! » Contraint et forcé, Silvio entreprend donc à contrecœur des études d’architecture, et échoue lamentablement à l’examen kafkaïen qu’il doit subir en fin d’année. Il se réfugie alors dans un night-club des environs de Rome, propriété de son ancien codétenu, un mafieux enrichi dans le trafic de cocaïne. Complètement ivre, il proclame son émancipation définitive de l’aliénation conjugale, et prétend ne se consacrer qu’à son roman. C’est ainsi qu’il s’oppose avec grossièreté à Elena venu le rejoindre en taxi, provoquant une rupture qui semble définitive. Superbe image de Silvio, titubant et déclamant parmi les moutons, un troupeau qui passait par là, symbole probable des foules résignées à se plier aux normes communes, Silvio tel le chevalier à la triste figure prêchant les ovidés comme saint François prêchait les oiseaux. Seul, Silvio ne s’en sortira pas davantage qu’en famille : l’éditeur refuse son livre sur les conseils de son avocat, qui craint d’être condamné pour offense à l’ordre public : « Appel à la désertion, offense à l’armée, critique de la magistrature, du système carcéral, offense à la religion ! » « Que dois-je faire ? » demande Silvio : « Essayez le cinéma… » Ainsi le film de Dino Risi, que nous sommes en train de voir, est celui-là même qui met en scène le roman de Silvio, puisqu’il en porte le titre. Pourtant, Silvio n’aura guère de succès à Cinecittà, alors envahie par le filon du peplum : ni Vittorio Gassman en imperator, ni Silvana Mangano en femme d’affaires pressée et fuyante, ni Alexandre Blasetti, qui s’esquive en invoquant la censure, n’acceptent le roman transformé en scénario. Cinéma dans le cinéma qui permet à Risi d’insinuer que, sans son initiative, nous n’aurions jamais pu voir ce film… Silvio s’enfonçe alors mélancoliquement dans des catacombes de carton pâte, pour les besoins d’un film sur les premiers temps du christianisme. William Wyler a tourné Ben-Hur deux ans plus tôt, en 1959, et La tunique d’Henry Koster ne remonte qu’à 1953. A la suite d’Hollywood, Cinecittà se met donc à la mode du peplum dévot. Là, Silvio retrouve un ancien soupirant d’Elena, travesti pour les besoins du rôle en apôtre, qui lui apprend que sa femme vit avec son fils à Viareggio, qu’elle tient une boutique de mode et qu’apparemment elle ne tient guère à le revoir.
Cut brutal qui nous conduit en vue plongeante vers les plages surpeuplées de Viareggio, que recouvre une forêt de parasols, véritable camp de loisirs forcés où erre Silvio à la recherche de son amour perdu, complet noir et cravate, comiquement seul dans la multitude des corps dénudés. Grande fiesta de la prospérité retrouvée à la fin des années cinquante. Silvio réussit à rencontrer Elena, qui lui accorde, lors d’une entrevue plutôt pénible, l’après-midi avec son fils Paolo, dont il s’était jusqu’alors parfaitement désintéressé. Rare moment de sincérité où Silvio, avec son fils, renonce pour une fois à ses fanfaronnades verbeuses. Apprenant de Paolo qu’Elena passe la soirée avec un Lucquois propriétaire d’une Mercédès blanche (c’est toujours par la voiture, au moins autant que par son propriétaire, qu’Elena se laisse séduire), Silvio retrouve la nuit venue sa femme dansant avec son rival dans un night-club de pacotille. Sur la musique d’Only you, alors à la mode, Silvio est plaqué une seconde foi par son ex, et malgré, ou à cause de la scène grandiose qu’il lui fait aux yeux de tous, se retrouve une fois de plus seul au petit matin, sur une large avenue du bord de mer où circulent les vacanciers. En une séquence magnifique, à la fois drôle et dérisoire, Silvio crache sur les voitures qui passent devant lui, symbole d’une richesse qu’il exècre et d’un essor économique dont il s’est exclu, et insulte leurs passagers. A un car de touristes allemands, qui lui rappelle son combat à l’époque de la résistance, il s’écrie grotesquement, dans un baragouin vaguement germanique : « Unter… mitte… kein… Unter Hitler… Vous êtes touristes ? Que venez-vous faire ici ? Il n’y a rien à voir. Tout est pourri. Ne visitez pas l’Italie. Restez chez vous, ça vaut mieux ! »
Désormais, Silvio, amoureux inconsolable, est décidé à se vendre au plus offrant pour que revienne à lui Elena. Le jour des funérailles, célébrées au village aux bords du lac de Côme, d’Amalia, la mère d’Elena, Silvio surgit sur la place, à la sortie de la messe, devant le cortège funèbre, au volant d’un somptueuse Cadillac blanche, réalisant ainsi le souhait de sa défunte belle-mère : se montrer dans une belle voiture aux yeux de tous les villageois et les faire ainsi tous crever d’envie ! A cet argument, Elena ne résiste pas et se remet en couple avec Silvio.
Dernier acte de cette histoire dramatique et lamentable d’une impossible réinsertion : Elena et Silvio, élégants et mondains, participent à une soirée où se retrouve le gratin du tout-Rome dans la luxueuse villa du commendatore auquel Silvio avait tenté de résister, bien à ses dépens, au début de sa carrière de journaliste. Devenu secrétaire de ce puissant personnage, il fait montre, sous les yeux stupéfaits de son épouse, d’une absolue servilité envers son nouveau patron. Elena comprend alors que c’est à ce prix que l’on peut s’offrir une Cadillac. Quand le commendatore pousse trop loin le jeu de l’humiliation – pour lui montrer comment l’on doit servir l’eau de Seltz, il lui en lâche un jet en pleine figure – Elena, d’un mouvement de paupières, accorde à Silvio l’objet de sa prière muette : le droit de résister. Silvio rejoint alors d’un pas décidé le commendatore, qui se trouve au bord de la piscine, et lui administre une retentissante et réjouissante claque qui le fait tomber à l’eau. Le couple quitte fièrement la villa, sous les regards médusés de l’assemblée, et reprend le chemin de la « vie difficile » : « La voiture, Monsieur ? » demande le portier. « Non, merci, répond Elena, nous rentrons à pieds. – Pour prendre un peu d’air frais », ajoute Silvio.
Ainsi s’achève la chronique désabusée des années difficiles, les mésaventures de l’anti-héros Silvio, mais héros tout de même, clown à la fois émouvant et infantile, sublime et ridicule, qui tente en solitaire de résister au flot montant de la rhinocérite, frère du Bérenger de Ionesco (17).
NOTES
1- Goethe consigna cet entretien dans ses Ecrits autobiographiques, 1789-1815, rédigés seize ans après l’Entrevue d’Erfurt, donc en 1824. Voir la traduction française de ce texte par Jacques Le Rider, chez Bartillat, 2001, p. 516.
2- Hegel, La Philosophie de l’Histoire, édition réalisée sous la direction de Myriam Bienenstock, « La Pochothèque », Le Livre de Poche, 2009, p. 430-431. Egalement la traduction par J. Gibelin des Leçons sur la philosophie de l’Histoire, Vrin, 1967, p. 215.
3- On sait que la veille de la bataille d’Iéna, Hegel écrivit à Niethammer une lettre qui portait en incipit : « Iéna. Le lundi 13 octobre 1806, le jour où Iéna fut occupé par les Français et où l’Empereur Napoléon entra dans ses murs. » C’est dans cette lettre qu’on lit ces lignes célèbres : « J’ai vu l’Empereur – cette âme du monde – sortir de la ville pour aller en reconnaissance ; c’est effectivement une sensation merveilleuse de voir un pareil individu qui, concentré ici sur un point, assis sur un cheval, s’étend sur le monde et le domine » (Hegel, Correspondance, 1785-1812, tome I, Gallimard, 1962, p. 114-115).
4- « Mon théâtre, c’est le monde ; le rôle que j’y joue, c’est celui de maître et d’auteur ; pour comédiens, j’ai vous tous, Pape, Rois, Peuples ! Et le fil par lequel je vous remue, c’est la peur ! » (Alfred de Vigny, Grandeur et Servitude militaires, édition critique établie par Patrick Berthier, « Folio », Gallimard, 1992, p. 186).
5- Alfred de Vigny, ibid., p. 188 ; l’entrevue entière entre le pape et l’Empereur occupe les p. 176 à 192.
6- Enrico Giacovelli, La commedia all’italiana, Gremese, Rome, 1990, p. 153 ; cité par José Pagliardini, Comédie en cinq as. Cinéma et condition masculine à l’italienne, 1954-1964, Presses Universitaires de Provence, Aix-en-Provence, 2014, p. 247-248, note 35.
7- Ce qui confirmerait assez le jugement du fiancé entreprenant qui courtise la sœur binoclarde de Fefe dans le film de Pietro Germi, Divorce à l’italienne (1961) : il déclare en effet pendant la projection de La Dolce Vita, à sa fiancée qui s’inquiète de l’attention qu’il accorde à Anita Ekberg : « Un mammifère de luxe, mais sans âme, selon moi. »
8- Roberto Rossellini, Fragments d’une autobiographie, Ramsay, 1987, p. 54-55 ; cité par Enrico Pagliardini, op. cit., p. 37.
9- Enrico Giacovelli, La commedia all’italiana, Rome, Gremesen 1990, p. 10.
10- José Pagliardini, Comédie en cinq as. Cinéma et condition masculine à l’italienne, 1954-1964, Presses universitaires de Provence, Aix-en-Provence, 2014, p. 30.
11- Charlotte Leclerc-Dafol souligne justement, dans les films de Pietro Germi, la cruauté de la foule, lâchement protégée par son anonymat : « Dans Séduite et abandonnée, la foule est d’autant plus agressive qu’elle est anonyme […] Les gros plans à focale courte déforment des figures déjà inquiétantes et font de la curiosité des “autres” un motif d’angoisse et d’obsession, que l’on retrouve dans les cauchemars d’Agnese et de Vincenzo. La population de Divorce à l’italienne est certes plus discrète et moins violente, mais tout aussi naturellement organisée : après le départ de sa femme, Féfé reçoit des lettres anonymes par centaines. La notion d’anonymat est soulignée avec insistance par le plan sur la boîte aux lettres où l’on ne voit défiler que des mains glissant le long des enveloppes ; car ces “autres” qui exigent que l’on soigne ses apparences et n’acceptent pas que l’on échappe à la norme sont avant tout des lâches qui, au lieu d’essayer de remettre en cause le conformisme général, s’unissent pour dénoncer ceux qui en prennent l’initiative » (Charlotte Leclerc-Dafol, Pietro Germi et la comédie à l’italienne. Cinéma, satire et société, préface de J. Gili, L’Harmattan, 2012, p. 106-107).
12- La même opposition est évoquée dans le film de Monicelli, Larmes de joie (1960), lorsque la Magnani (affublée d’une perruque blonde dans l’espoir de ressembler à l’explosive Anita Ekberg), accompagnée de ses comparses, est invitée, à deux pas de la place du Capitole, dans un luxueux hôtel particulier qui est la propriété de riches Allemands. Ils seront publiquement humiliés pour avoir tenté de dérober quelques objets de valeur et s’être fait prendre la main dans le sac.
13- Il faudrait ajouter au moins un autre chapitre à l’histoire des relations compliquées, entre amour et haine, de l’Italie et des Etats-Unis : celui qui a été composé par Ettore Scola avec Macaroni (1985), un film magnifique, aujourd’hui curieusement oublié, en lequel il revient à Mastroianni, ici Napolitain, d’incarner l’Italie, et à Jack Lemmon, acteur fétiche du grand Billy Wilder, d’incarner les Etats-Unis.
14- Le mot est évidemment d’origine américaine : il désignait d’abord une réclame bruyante qui provoque la soudaine hausse, toute spéculative, d’une valeur en Bourse.
15- Antonioni lui-même reconnaissait que cette « maladie d’Eros » qui afflige l’humanité contemporaine provenait aussi de son inadaptation à un monde radicalement nouveau, en lequel elle ne parvient pas à se retrouver : « Pour moi, je tiens à le dire, cette sorte de névrose qu’on voit dans Deserto rosso est surtout une question d’adaptation. Il y a des gens qui s’adaptent, et d’autres qui ne l’ont pas encore fait, car ils sont trop liés à des structures, ou des rythmes de vie qui sont maintenant dépassés. C’est le cas de Giuliana. La violence de l’écart, du décalage entre sa sensibilité, son intelligence, sa psychologie, et la cadence qui lui est imposée, provoque la crise du personnage. C’est une crise qui ne concerne pas seulement ses rapports épidermiques avec le monde, sa perception des bruits, des couleurs, des personnages froids qui l’entourent, mais aussi son système de valeurs (éducation, morale, foi), qui ne sont plus valables et ne la soutiennent plus. Elle se trouve donc dans la nécessité de se renouveler entièrement, en tant que femme. C’est ce que les médecins lui conseillent et qu’elle s’efforce de faire. Le film est, en un certain sens, l’histoire de cet effort » (Pierre Leprohon, Michelangelo Antonioni, présentation et choix de textes, « Cinéma d’aujourd’hui », Seghers, 1969, p. 135-136).
16- Libertas, 24 février 1952 ; cité in CinémAction, Le Néoréalisme italien, n° 70, janvier 1994, p. 71. Egalement José Pagliardini, op. cit., p. 48-49.
17- Rhinocéros d’Eugène Ionesco est créé à Paris en janvier 1960, au moment précis où Dino Risi tourne Une vie difficile, sorti en 1961.
Pour lire la suite, cliquer ICI
|
|