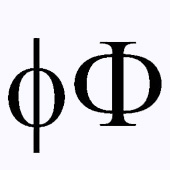|
PETIT ECHANGE AVEC CHATGPT
APHORISMES
ETRE ET EXISTER
ENSEIGNER LA PHILOSOPHIE
ESTHETIQUE DE L'ABSTRACTION
PRINCIPES DE PHILOSOPHIE ESTHETIQUE
LA PEINTURE HOLLANDAISE AU SIECLE D'OR
LES FANTOMES DE L'OPERA
ON DEVRAIT DIRE...
QU'EST-CE QUE LE NEOREALISME ?
1- Le néoréalisme italien
2- Le néoréalisme dans le monde
3- Le destin du couple
4- Personnages en quête d'auteur
5- Commediante...
6- Le cinéma dans le cinéma
LA STAR, LA VIVANTE ET LE SANS POURQUOI
ESTHETIQUE DU PARADIS TERRESTRE (1)
LE REALISME SELON CEZANNE
NOTE SUR WITTGENSTEIN
ENTRETIEN
CEZANNE ET LA FORCE DES CHOSES
MANTEGNA : ANCIENS ET MODERNES
LE TABLEAU ET LE MIROIR
LE JARDIN A LA FRANCAISE
REMBRANDT, BETHSABEE
PHILOSOPHIE ET RHETORIQUE
LES RELIGIONS DU LIVRE
DU CARACTERE A LA CARICATURE
QUELLE VANITE QUE LA PEINTURE...
LES GROTESQUES
LE ROSSIGNOL ET LA DIVA
LA STATUE AMOUREUSE
L'INTERPRETATION DE L'OEUVRE D'ART
DE L'IDEE DU BEAU A L'ESTHETIQUE
CARAVAGE ET L'OPERA
|
QU'EST-CE QUE LE NEOREALISME ?
REFLEXIONS SUR LE CINEMA
(1945-1960)
4- Personnages en quête d'auteur
Pourquoi « néoréalisme », et non simplement « réalisme » ? Quel est le sens du préfixe ? Le réalisme, tel qu’il inspire la littérature européenne dans le dernier quart du XIXe siècle, est essentiellement un réalisme du récit : il s’agit de rapporter les faits, la succession des événements, à la manière d’une observation scientifique, avec objectivité et exactitude. Dans son essai de 1879, Le Roman expérimental, Zola, s’inspirant de Claude Bernard et de son Introduction à la médecine expérimentale, assignait au romancer le rôle neutre et distant de l’observateur qui constate les faits, puis de l’expérimentateur qui les soumet à des lois : « … le romancier est fait d’un observateur et d’un expérimentateur : l’observateur chez lui donne les faits tels qu’il les a observés, pose le point de départ, établit le terrain solide sur lequel vont marcher les personnages et se développer les phénomènes. Puis, l’expérimentateur paraît et institue l’expérience, je veux dire fait mouvoir les personnages dans une histoire particulière, pour y montrer que la succession des faits y sera telle que l’exige le déterminisme des phénomènes mis à l’étude » (1). Une telle prétention fait sourire quand on sait combien l’univers romanesque de Zola, hanté par les fantasmes les plus extravagants, doit sa force de conviction, non à l’objectivité du constat, mais bien au contraire à la violence obsessionnelle du symptôme (2). Ce pourquoi on parle à son sujet avec raison de « naturalisme » plutôt que de « réalisme », le second prenant pour modèle la fidélité de l’empreinte photographique, tandis que le premier exprime toute la force d’une nature vivante et vorace, qui n’enfante ses créatures que pour mieux les engloutir. Il reste vrai cependant que le réalisme veut observer le développement des « phénomènes », c'est-à-dire la succession des faits qui composent la trame de l’action. Le réalisme entreprend de dépouiller le roman du romanesque, mais nullement de renoncer au roman lui-même. Le néoréalisme veut aller plus loin : c’est le récit lui-même qu’il veut mettre entre parenthèses, la suite des actes coordonnés qui constitue depuis Aristote la matière même du drame, ce que l’auteur de La Poétique nomme « le système des actes ». Le néoréalisme pose son regard sur le monde dans le temps du suspens de l’action, en ce sens du moins où Aristote l’entendait, c'est-à-dire un acte originaire et fondateur qui renverse la situation et donne naissance à un monde nouveau. Pour qu’un tel événement se produise, il faut qu’un héros monte sur la scène, et le néoréalisme nous parle précisément d’un monde en lequel les héros – dieux, guides ou pères – ont disparu. Dans un monde sans héros, qui est celui de l’après-guerre, il n’y a plus lieu de raconter des histoires, c'est-à-dire de représenter des actes dignes d’être rappelés à la mémoire des hommes. Le néoréalisme sera donc le réalisme d’un monde en lequel il ne se passe, à proprement parler, rien, en lequel les choses, par le seul acte de leur présence, prennent le pas sur les hommes, que nul destin ne convoque plus sur la scène pour l’accomplissement d’un acte valeureux, c'est-à-dire fondateur de valeurs nouvelles. Le réalisme est un réalisme du récit, le néoréalisme sera un réalisme du réel, une sorte de réalisme au carré, ce que l’art contemporain a fort justement nommé un hyperréalisme. Gilles Deleuze a parfaitement exprimé cela dans le premier chapitre qui ouvre le deuxième tome de son grand ouvrage sur le cinéma : L’Image-temps. Le personnage néoréaliste, ce qu’on nommait autrefois le « héros » de l’histoire – Antonioni a reconnu, dans un entretien, combien ce mot pompeux est devenu dérisoire (3) – n’est plus acteur mais spectateur du monde qui se manifeste à ses yeux. Et le monde lui-même ne définit plus la situation au sein de laquelle l’acte doit s’accomplir, mais la force quasi hypnotique de l’impression sensible, le personnage n’étant là que pour témoigner de l’existence (ce qui est précisément la fonction de la caméra), comme médusé par la seule présence des choses, ce que Heidegger nommait « la réserve de l’Etre », en ce sens où l’on dit d’un taiseux qu’il est « réservé », « renfermé sur lui-même » (4) : « Ce qui a surgi tout à coup, écrit Deleuze, c’est une situation optique pure […] Ce qui définit le néoréalisme, c’est cette montée de situations purement optiques (et sonores, bien que le son synchrone ait manqué aux débuts du néoréalisme), qui se distinguent essentiellement des situations sensori-motrices [Deleuze entend pas là une situation dramatique, qui appelle et motive l’action] de l’image-action de l’ancien réalisme […] Le personnage est devenu une sorte de spectateur. Il a beau bouger, courir, s’agiter, la situation dans laquelle il est déborde de toutes parts ses capacités motrices, et lui fait voir et entendre ce qui n’est plus justiciable en droit d’une réponse ou d’une action » (5).
Pour représenter une telle perception du monde – que nous avons dite proche de l’hypnose, en ce sens où la direction du regard est renversé, comme si ce n’était plus le sujet qui regarde l’objet mais inversement l’objet doué de regard qui fixe le sujet et le met à l’accusatif – la photographie, qui fixe l’empreinte du phénomène, et le cinéma, qui en restitue le mouvement, sont les outils appropriés. Dans une culture dominée par le visuel, la photo comme le film s’imposent – trompeusement, sans doute – comme des documents capables de certifier la vérité, d’authentifier les faits. C’est ainsi que le réalisme, et plus encore cet hyperréalisme qu'est le néoréalisme, conduit paradoxalement à l’hallucination comme au fantastique. Un fantastique, il est vrai, radicalement nouveau, en ce sens qu’il n’ouvre pas une porte pour l’évasion, pour un voyage vers l’ailleurs, il nous enferme plutôt dans la prison de l’ici-maintenant, il nous livre à l’inquiétante étrangeté de notre présent. La littérature réaliste n’est pas exempte de visions, elle ne méconnaît pas la puissance de l’hallucination, mais elle en fera toujours une description clinique, l’observation d’un état pathologique. Ainsi Félicité mourante (Un cœur simple), en proie aux fièvres de l’agonie, voit son perroquet Loulou se métamorphoser fantastiquement dans la colombe du Saint-Esprit (6). Mais le fantastique néoréaliste, qui est un hyperréalisme, évoque davantage le surgissement d’un réel littéral que les fantasmagories de la démence. Flaubert, dont la grandeur excède toute catégorie, a lui-même pressenti cette révélation de la chose même en laquelle se laisse absorber le regard du désespéré, non parce qu’il cède au délire, mais parce qu’il accède à une sorte d’extra-lucidité (7). Si l’hallucination réaliste est névrotique – vision d’une subjectivité en proie au délire – l’hallucination néoréaliste serait, quant à elle, plutôt psychotique, en ce sens qu’elle convoque, sur la scène de la représentation, le monde tel qu’il est quand nul n’est là pour le voir, c'est-à-dire le triomphe des choses sur le regard qui prétend les soumettre à sa perspective. Il s’agit bien là, comme le dit Deleuze, d’une « pure image optique », c'est-à-dire d’une image qui vaut par sa seule qualité de présence, et non parce qu’elle est l’objet d’une attention ou d’une considération. Si la figure de l’Etranger, de l’Exilé, du Vagabond, hante l’écran néoréaliste comme la littérature de l’après-guerre, ce n’est pas seulement en raison des nombreux exodes et migrations engendrés par la deuxième guerre mondiale, mais c’est aussi parce que le regard du banni, plus sensible à l’inquiétante étrangeté d’un monde que l’habitude n’a pas encore eu le temps de d'apprivoiser à ses yeux, aperçoit mieux que les autres cette pure image optique en laquelle se résume la révélation néoréaliste.
C’est ainsi que le Stromboli de Rossellini s’ouvre « in the displaced camp of Farfa, Italy ». Il se trouve que ce lieu a été, pour Rossellini, l’occasion d’une rencontre symbolisant à ses yeux l’expérience de l’exil le plus radical. Dans ce camp étaient concentrées des femmes venues de nombreuses nations d’Europe centrale, chassées de chez elles par la guerre, ayant toutes traversé de grandes épreuves, et attendant là l’autorisation de retourner dans leur pays. S’approchant des barbelés, Rossellini put échanger quelques mots avec l’une d’entre elles, grande et belle, yeux bleus, vêtue de noir, qui lui confia dans un italien rudimentaire qu’elle venait de Lettonie. A travers les barbelés, il lui tendit la main à laquelle elle s’agrippa comme une naufragée à une épave. Hanté par ce souvenir, Rossellini réussit à obtenir quelques jours plus tard un laissez-passer : il apprit que cette femme était partie, après s’être mariée à un soldat italien qui vivait dans les îles Lipari. Le choc de cette rencontre est à l’origine du film qu’il tourna avec Ingrid Bergman, Stromboli (1950) (8). Une jeune et belle lituanienne, reléguée dans le camp de Farfa, réussit à en sortir en épousant un soldat italien qui l’emmène sur sa terre natale, l’île éolienne de Stromboli. Pour Karen, habituée au confort et parlant l’anglais avec aisance, mais ignorant l’italien, le dépaysement est radical. Tout ce qu’elle voit lui est étranger, et lui semble terrible et brutal. Antonio, le mari, utilise une belette apprivoisée pour tuer un lapin : la férocité de la mise à mort épouvante la jeune femme. L’île vit de la pêche, et pratique l’antique technique de la madrague qui consiste à capturer les thons lors de leur migration dans un long filet qu’on remonte ensuite à la surface, asphyxiant ainsi les poissons affolés dans « la chambre de la mort » puis les achevant avec de longs crochets. Karen, qui avait souhaité se rapprocher d’Antonio, assiste, terrifiée, à cette liturgie meurtrière. Entre Karen et les habitants de l’île, l’incompréhension est totale : eux la rejettent pour son arrogance et la liberté de ses manières, elle, de son côté, les trouve frustes et barbares : « Nous sommes très différents, dit-elle à son mari ; j’appartiens à une autre classe; je ne peux pas vivre dans cette saleté ! » Mais la sauvagerie n’est pas seulement, aux yeux de Karen, le fait des hommes, elle est encore celui de la nature : l’île tout entière est un volcan qui s’élève à plus de 900 mètres au-dessus de la mer, toujours en activité. Une éruption ayant effectivement eut lieu pendant le tournage, Rossellini put filmer le cataclysme, les habitants dévalant les pentes sous une pluie de feu, embarquant sur de pauvres barques qui les attendent sur la plage, se regroupant à bonne distance pour réciter des litanies jusqu’à ce que le monstre s’apaise. Karen est épouvantée par sa nouvelle prison, bien pire que le camp qu’elle vient de quitter. Elle prend conscience de l’insurmontable distance qui éloigne les hommes les uns des autres, comme de l’inhumanité de la nature et de son effroyable puissance. Son statut de radicale étrangère lui permet de discerner ce que la coutume refoule : mon semblable comme un inconnu et le monde comme une indéchiffrable énigme. Le Stromboli est plus qu’un volcan : une divinité imprévisible et cruelle qui épargne les uns et anéantit les autres. Cherchant à fuir à tout prix cet enfer, Karen entreprend l’ascension du géant pour rejoindre, de l’autre côté de l’île, le port de Ginostra, où elle espère prendre le large. Suffoquant dans les émanations des gaz, meurtrie par les difficultés de l’escalade, elle parvient au bord du cratère épuisée et sans bagage. Humiliée, couchée à même la terre, prosternée devant le dieu Stromboli, elle semble alors, dans les toutes dernières minutes du film, touchée par la grâce d’une conversion : elle comprend soudain la noblesse des hommes qui se risquent à vivre sur les flancs du titan, elle choisit d’adopter ce lieu qui la rejette, elle gardera l’enfant innocent – my innocent child – le fils d’Antonio qu’elle porte en elle. Tous les films de Rossellini tournent autour du mystère d’une conversion. Karen rencontre le sacré, elle tombe entre les mains du dieu vivant : « Dieu ! Mon Dieu ! Aidez-moi ! Donnez-moi la force, la compréhension (the understanding) et le courage ! Oh ! Mon Dieu ! Dieu de miséricorde ! Dieu ! Dieu ! Dieu ! » Ce sont les derniers mots du film.
Il est permis de douter de cette grâce qui retourne in extremis la situation de l’exilée. Mais on ne peut méconnaître la force du film ni la puissance de son regard. Rossellini invente un thème cinématographique qui ne cessera de s’approfondir au cours les années 50 et 60 : la caméra est un instrument privilégié pour vérifier l’axiome baudelairien selon lequel le beau est toujours bizarre, et l’écran cinématographique est singulièrement apte à réfléchir l’apocalypse de l’inhumain, la révélation brutale de l’inhumanité du monde, de la radicale étrangeté des choses et des êtres. La force du film de Rossellini réside moins dans le miracle de la conversion – on sait depuis Pascal que les miracles ne convertissent que ceux qui le sont déjà – que dans la violence du regard, la mise à nu de l’existence, l’évidence d’une antique misère à laquelle les hommes n’échapperont pas. Alors que l’Europe s’apprête à refouler le désarroi de l’après-guerre en se consacrant corps et âme à l’enrichissement et la consommation, le cinéma franciscain de Rossellini rappelle l’essentielle pauvreté de l’humaine condition, notre indépassable statut d’étranger en ce monde. Cette leçon est universelle. N’était-ce pas déjà cette expérience que faisait le voleur de bicyclette dans les rues d’une Rome dépeuplée par un match de football, ne rencontrant qu’indifférence ou hostilité ? Comme le Stromboli est prodigieusement indifférent aux imprudents qui séjournent sur ses flancs, de même la ville est d’une prodigieuse surdité, d’une prodigieuse absurdité, pour les hommes qui ne font que passer en son sein. Karen croit souffrir parce qu’elle est aliénée à une société primitive à laquelle elle n’est pas adaptée. Mais le mal est plus profond, et demeure dans les lieux de plus haute civilisation. Le néoréalisme découvre l’hyperréalité d’un monde en regard duquel la venue de l’homme n’est qu’une perturbation insignifiante. C’est ainsi que la ville, vivante quand les rues sont animées, n’est plus qu’un décor métaphysique quand elle devient déserte. L’enregistrement mécanique de la caméra peut seul surprendre cette divulgation : « La ville-désert, la ville absente d’elle-même, ne cessera pas de hanter le cinéma, comme si elle détenait un secret » (9). On pense, dans le cinéma de Rossellini, au Berlin dévasté par les bombardements de Germania anno zero (1948) (10). Mais de façon plus encore exemplaire, à l’extraordinaire séquence sur laquelle se termine L’Eclipse d’Antonioni (1962) : une cinquantaine de plans sur un carrefour de Rome que traversent de rares passants, pour quelques-uns que la caméra a croisés en flânant dans les rues en compagnie des protagonistes. Ce carrefour est le lieu du rendez-vous amoureux que se sont donné Vittoria et Piero, rendez-vous auquel, par lassitude ou négligence, ni l’un ni l’autre ne se rendra. La caméra s’attarde plus de sept minutes sur ce lieu sans caractère particulier de l’E.U.R. Il ne s’y passe rien, ou plutôt y passent seuls les passants anonymes descendus du bus qui s’arrête non loin du 10 Viale del Ciclismo, où habite Vittoria. Pendant ces sept minutes, on ne voit que des inconnus, mais non des personnages, et la part belle est faite aux choses, les rues désertes, le jet d’eau, la palissade et l’échafaudage, les immeubles modernes, le fût d’eau dans lequel Piero a jeté une petite boîte d’allumettes, le feuillage des arbres, enfin les réverbères, l’ampoule qui s’allume d’abord en tressautant puis dont l’incandescence blanche finit par envahir la plus grande partie de l’écran, l’autre étant occupée par les quatre lettres du mot FINE. Séquence quasi muette, qu’égrènent seulement quelques rares notes au piano. La violence du volcan, transposée dans la Rome moderne, devient la menace de la guerre atomique qui pèse sur le monde contemporain. A l’arrêt du bus, un passager descend et s’éloigne en lisant L’Espresso : le journal fait allusion au conflit qui conduira la crise des missiles de Cuba et commente la fragilité redoutable de l’équilibre de la terreur (11). Dans la nature sauvage comme dans la Ville Eternelle, l’angoisse est la même.
On a parfois reproché à Antonioni de ressasser toujours le même thème, la crise du couple romantique qui entreprend de pérenniser l’amour fou sur la durée d’une vie entière. Rien de plus faux. Chacun de ses films est une étape dans une longue analyse qui tend à surmonter cette déchirure, et l’on peut dire que le suivant prend la suite du précédent en un propos ininterrompu qui a pour but de guérir la maladie d’Eros qui accable nos contemporains (12). C’est ainsi que le mal d’amour qui possède Aldo depuis sa rupture avec Irma (Le Cri, 1957), qui le conduit à errer le long des rives du Pô puis à revenir au point de son départ pour se précipiter dans le vide, se prolonge avec L’Avventura (1960) : se résignant aux inconstances du sentiment comme aux intermittences du cœur, Claudia pardonne à Sandro et le couple évite la rupture en se réconciliant malgré le désamour. Solution sans doute boiteuse, puisqu’on retrouve ce même couple, devenu plus âgé, dans La Notte (1961), devenu Lydia et Giovanni Pontano, elle, toujours dominante – en amour, c’est toujours la femme qui, chez Antonioni, conduit les affaires – et lui, écrivain à bout de souffle qui se résigne à prostituer son art au profit d’un riche industriel, comme Sandro, l’architecte de L’Avventura, s’était résigné à travailler pour un promoteur immobilier dépourvu de scrupules. La réconciliation, incertaine, a lieu dans un parc désert, dans la lumière de l’aube blême. L’Eclipse (1962), s’ouvre précisément sur la rupture, cette fois définitive, dont Vittoria prend l’initiative devant Riccardo désarmé. Tout le film se déroule dans une atmosphère légère et ensoleillée, l’héroïne se trouvant dans l’état de grâce d’une disponibilité nouvelle, retrouvant l’innocence du jeu dans la pure jouissance de l’instant. Il est vrai qu’à ce jeu l’amour n’est qu’une passade, qui sans doute s’amuse de sa propre frivolité, mais ne saurait être un remède à la solitude, qui pourtant demeure. A la fin du parcours, Piero, qui prend la vie comme on joue à la Bourse, toujours à l’affût de l’instant propice, mais fugace, et Vittoria, qui veut se divertir du sérieux de l’amour par les taquineries du flirt, se retrouvent seuls, chacun de son côté : personne n’est venu au rendez-vous. C’est alors que paraît, dans le silence qui s’élève quand prend fin le divertissement, la permanence des choses comme un théâtre muet sur la scène duquel passent puis s’effacent les vivants. La séquence finale de L’Eclipse annonce le monde névrotique – à la limite de la psychose – en lequel se noie Giuliana dans Le Désert rouge (1964). Le couple n’est plus ici d’aucun secours, le mari n’est qu’un aimable étranger, l’enfant trompe la mère en contrefaisant la maladie (Giuliana est trop éperdue elle-même pour entendre l’appel au secours de l’enfant qui se sent abandonné), la jeune femme cherche vainement un peu de chaleur entre des bras amis qui ne savent pas la retenir. Il semble que l’hostilité du monde soit ici portée à son comble. Impossible d’habiter cette terre en poète. L’homme est en exil sur cette terre. Peut-être est-ce la raison pour laquelle l’université de Bologne a construit ces grandes antennes pour écouter les étoiles. Le paysage industriel des environs de Ravenne, plus cataclysmique encore que le cratère du Stromboli, vomit ses rares habitants : l’eau est gravement polluée, les anguilles qu’on pêche dans le fleuve ont le goût du pétrole, des conduits crachent des vapeurs toxiques, l’air vibre dans le rythme saccadé des machines, dans le souffle haletant de l’usine. On se croirait dans l’enfer de Dante, à la limite des mondes, dans un territoire des confins envahi par le brouillard, duquel émergent, monumentaux et imprévisibles, d’immenses tankers comme des vaisseaux fantômes. Dans les entretiens qu’il a donnés au sujet de ce film, Antonioni prend garde de toujours préciser que son propos n’est pas réactionnaire, qu’il ne condamne nullement le progrès et que l’usine n’est pas sans beauté. Dans le monde des années soixante, le mythe du progrès est tout-puissant, il était imprudent de le dénigrer et les propos hétérodoxes étaient aussitôt excommuniés. Il faut pourtant reconnaître que si beauté il y a, c’est celle du Diable, et que le désert rouge est un enfer. Ici est portée à sa plus haute intensité l’irradiation hostile qui émane de la pure présence des choses, qu’elles soient engendrées par la nature ou faites de mains d’homme (13). La séquence finale de L’Eclipse donne à voir le monde comme un terrain de jeu, une aire de parcours aléatoires où l’homme ne fait que passer. Mais dans Le Désert rouge, le paysage industriel ressemble aux rives du Styx où sont exilés les damnés, et les personnages sont des âmes en peine qui errent dans le royaume des morts. On sait que c’est dans ce film qu’Antonioni, grand maître de toutes les nuances du gris, se résolut à recourir pour la première fois à la couleur. Mais les couleurs du Désert rouge sont des couleurs stridentes, stressantes, fluorescentes. Antonioni avait pour ce film fait peindre des arbres dans le but de fausser leurs couleurs naturelles. La couleur, selon Antonioni, mesure le coefficient d’irradiation de la présence, le rayonnement maléfique qui émane d’un monde dans lequel l’homme est devenu un hôte indésirable. Le monde de la modernité est un « désert », puisqu’il creuse entre les hommes une distance infinie, foule solitaire qui erre dans ce que Baudelaire nommait déjà « le Sahara des grandes villes », et ce désert est « rouge », non seulement parce qu’il est porté à incandescence par le feu des usines, mais surtout parce que le rouge est le signal du danger, et que ce monde constitue par lui-même, par sa seule présence, un danger pour la survie de l’homme. L’exil de Karen sur les flancs du Stromboli résultait d’un choc des cultures ; mais celui de Giuliana dans la banlieue industrielle de Ravenne est bien plus radical. L’héroïne solaire de L’Avventura est devenue cette jeune femme frissonnante et terrorisée, oppressée par la force des choses, incapable de vivre dans un monde qui prend l’humanité en horreur. L’expérience à laquelle le cinéma d’Antonioni soumet la solitude de la condition humaine est ici portée à son comble. Le prochain film marquera une rupture avec l’ensemble des films précédents : Blow up (1966) enseigne la fausseté des images, qui savent mentir en disant la vérité, semblable à ce que Macbeth, enfin lucide et sur le point d’être achevé, reconnaît être « l’équivoque du démon » (14). Giuliana, qui est la proie de l’extériorité, est victime éblouie de son extrême aliénation. Elle est persécutée par les images, qui sont ses propres cauchemars. L’apparence n’est qu’une hallucination tant qu’elle n’est pas soumise au travail de l’analyse et de la critique.
En 1950, avec Stromboli, Rossellini introduisait un thème nouveau, emblématique du cinéma d’après guerre, celui de la confusion des langues d’après Babel. La première séquence montre la vie de promiscuité qui est celle des femmes reléguées dans le camp. Venues de tous les pays d’Europe, les unes parlent l’allemand, d’autres l’italien, d’autres (telle Karen) l’anglais, d’autres le français. Sœurs par l’emprisonnement, elles réussissent, malgré tout, mais approximativement, à se comprendre. Mais quand Karen échange sa prison de barbelés pour une autre prison, l’île qu’une mer sépare du monde, l’obstacle de la langue se fait plus radical. Aucune fraternité ne relie plus Karen aux habitants de l’île, bien au contraire, elle est à leurs yeux l’Etrangère, et par conséquent l’Intruse. En outre, les quelques mots italiens que bredouillent avec difficulté Karen ne lui sont d’aucune utilité : les pêcheurs de Stromboli parlent un dialecte où l’italien se mêle avec le grec, et qui rend cette fois la communication tout à fait impossible. Antonio, le mari, baragouine un anglais approximatif, et Karen se plaindra auprès du prêtre d’être contrainte, par ce jargon, à des échanges enfantins et élémentaires. Lorsque le prêtre accueille les époux à leur arrivée sur l’île, il prévient la jeune femme de l’austérité de la vie qu’on mène ici : « La terra e dura qui » lui dit-il en italien ; et, pour mieux se faire comprendre, il traduit cette formule en anglais, ce qui donne : « The life is very hard ». Incommunicabilité des langues : il n’y a pas de mot anglais pour dire la « terre » que l’on cultive sur les flancs du volcan. Karen, qui parle avec aisance un anglais élégant, se condamne par là même à ne jamais savoir ce que c’est que la terre pour les habitants de Stromboli. Antonio, voulant faire comprendre à sa compagne la grandeur de la vie rude qu’on mène ici, la prend à témoin : « Regarde, la lave descend de la montagne. Maisons et champs détruits… Mais les plus forts demeurent ! Tu comprends ? On reconstruit les maisons. La terra – come se dice in inglese ? – (il prend une poignée de terre, ou plutôt de cendre volcanique) new terra (il veut dire que depuis l’éruption la terre a été renouvelée). On plante à nouveau de l’orge, des vignes… » Il veut l’embrasser. Elle le repousse brutalement : « Please, let me alone ! Peu m’importe votre orge, vos vignes ou vos terres ! Je veux quitter cette île ! Comme tous ceux qui vivaient ici, et sont partis au loin ! » Antonio, la prenant par les épaules, réplique : « Que se passe-t-il ? Ecoute : C’est mon pays. Tu es ma femme. Tu resteras parce que je le veux. » Ce couple aurait besoin d’un traducteur, d’un interprète. Comment expliquer à Karen ce que signifie terra sur l’île de Stromboli ?
Traductrice, tel est précisément le métier de Vittoria dans L’Eclipse : elle traduit pour Ricardo, son amant avec lequel elle rompt en ouverture du film, des articles de l’allemand à l’italien, et quand Piero vient badiner la nuit sous sa fenêtre, elle travaille à une traduction de l’espagnol en italien. Traductrice, c’est encore le métier d’Esther, la sœur d’Anna, dans Le Silence de Bergman (1963). Les deux jeunes femmes, de passage, viennent échouer, en raison d’obscures manœuvres pour une guerre qui semble imminente, dans une ville d’Europe centrale, dont nous savons qu’elle se nomme Timoka, bien que ce nom ne figure sur aucun atlas. Esther, malgré sa science, est incapable de déchiffrer les diverses inscriptions qu’elle rencontre dans ce pays inconnu. Des linguistes se sont penchés sur certaines d’entre elles, et ont reconnu de vagues affinités avec le polonais, le russe, l’estonien et le suédois. Bergman est allé jusqu’à réaliser un journal entier recouvert de titres incompréhensibles : dans un café où elle n’est venue que dans l’espoir de draguer une proie, la belle Anna fait mine de lire ce journal qu’elle ne comprend pourtant pas. Elle ne peut davantage communiquer avec les habitants de cet étrange pays, et si elle connaît l’homme qui répond à son désir, c’est par l’étreinte des corps et non par les mots de la langue. « C’est beaucoup mieux ainsi », glisse-t-elle, entre deux enlacements, à l’oreille de son partenaire qui ne la comprend pas. Esther, l’intellectuelle, veut comprendre, elle s’efforce de traduire les langues étrangères, elle réussit à communiquer avec le vieux maître d’hôtel, dans le palace au luxe désuet en lequel les deux sœurs s’ennuient à mourir, et constitue même un lexique de la langue de Timoka, qu’elle destine à Johann, le fils d’Anna. Esther, pour vivre, a besoin d’un sens ; Anna, pour se sentir vivante, a besoin des sens. Dans un entretien, Bergman disait que l’une est à l’autre comme l’âme est au corps, ce qu’il faut entendre comme une interprétation possible, mais non comme une clé. Bien que parlant toutes deux le suédois, elles ne communiquent guère entre elles, Anna, toute sensuelle, rejetant avec violence l’intellectualité de sa sœur, qui corrompt toute jouissance par le besoin de comprendre. Le grand hôtel de Timoka est le royaume de l’incommunicabilité. Anna, impérieuse, jouit avec une sorte de fureur contenue, d’acharnement triste ; Esther, malade, presque agonisante, meurt de cette immense incompréhension où s’enlise l’échange, où suffoque la demande d’amour. Les mots n’étant plus ici un remède à la solitude, elle recourt à l’alcool et à la masturbation. Le corps et l’âme meurent lentement dans le Temps, étouffés par la solitude. Les deux sœurs ne souffrent peut-être pas de leurs frustrations respectives, mais plutôt de faire deux, et non un, du divorce qui les sépare. Le Silence n’est pas celui de Dieu – ce silence-là était celui du Septième Sceau (1957) – c’est le silence ouaté en lequel tombent et s’ensevelissent les mots que nos lèvres prononcent, c’est le tissu sur lequel nos discours brodent des motifs périssables. C’est dans l’épaisseur de ce « silence », entre Cris et chuchotements (1972), que les hommes, lentement, meurent.
C’est ainsi que l’Emigré, traversant des nations dont il ignore la langue, toujours étranger parmi ses semblables, est une figure cardinale de l’âge contemporain. En ces temps où chacun recherche avec complaisance ses racines et se passionne pour la généalogie, l’homme fait l’expérience d’un essentiel déracinement qui le condamne à l’errance perpétuelle, au voyage sans fin. Si la route est l’image de la vie, ce n’est pas en ce sens qu’elle conduit à la vraie patrie, mais plutôt en cet autre qui fait d’elle un chemin qui ne mène nulle part. Les nomades, traînant derrière eux roulottes et bagages, passant partout et ne s’arrêtant jamais, nous tendent un miroir. C’est ainsi que La Nuit des forains – le film de Bergman qui sort sur les écrans en 1953 – nous fait assister au passage du convoi, celui d’un cirque misérable qui vient de nulle part, s’arrête le temps d’un spectacle dans une petite ville de province, et reprend sa route vers nulle part. Alberti, le directeur du cirque, retrouve la femme qu’il avait abandonnée trois ans plus tôt, et les deux enfants nés de leur union. Agda s’est installée là, apaisée, menant une vie monotone, tranquille, confortable et épargnante. Son intérieur est propret, l’ordre y est impeccable. Entre la vie misérable du forain et la vie douillette de l’enracinée, chacun doit choisir : comme il paraît dans la séquence magnifique de leur rencontre, Alberti a horreur de ce vide confortable, Agda est épouvantée par cette misère aventureuse, mais tous deux fuient un même néant, l’ennui d’une vie sans but ni raison. Agda se réfugie dans l’abrutissement de l’habitude et de la répétition, Alberti dans l’étourdissement de l’aventure, mais ni l’un ni l’autre ne sait où il va. Bergman, homme de spectacle, metteur en scène à l’écran comme sur la scène, prend évidemment le parti d’Alberti. Agda n’est qu’une apparition fugitive, et la caméra s’attarde sur les humiliations des forains : ils quémandent, auprès du directeur du théâtre local, des costumes clinquants pour leur parade, qu’ils obtiendront, mais après avoir essuyé le mépris et la morgue des acteurs, infatués de leur art, et aux yeux desquels les gens du voyage ne sont que des gueux qui sentent l’écurie et la misère ; et quand ils feront leur parade dans les rues, ils seront aussitôt arrêtés par la maréchaussée, leurs chevaux confisqués, et réduits à pousser la carriole dans la boue sous les rires des badauds. La compagne d’Alberti – la provocante Harriet Andersson venue tout droit de Monika ou le désir, qui sort la même année 1953 – est l’aguichante écuyère de la troupe, qui se donnera à l’acteur Franz, un bellâtre, jalouse de ce qu’Alberti veuille la quitter un instant pour revoir son épouse délaissée. Lors de la représentation, Franz humiliera Alberti, et le rossera sous les yeux du public. Le destin d’Agda, qui s’installe pour mieux se dissimuler comme certains animaux s’immobilisent pour échapper à leurs prédateurs, est celle d’une femme respectable et respectée, mais qui s’ennuie horriblement, hantée par le vide de son existence ; le destin des forains, méprisés et humiliés, exposés aux yeux de tous, paie à ce prix le divertissement de la vie nomade et l’imprévu de l’aventure. Le sédentaire cache sa misère, le nomade l’exhibe publiquement. Ce qu’annonce la parabole du clown triste Frost (en suédois : le gel ou le givre), racontée en ouverture du film, en un fantastique flash-back, dans un éclairage expressionniste qui fait de cette réminiscence une véritable hallucination : sous les yeux d’une armée qui s’exerce à la guerre, Alma, l’épouse de Frost, s’exhibe sur la plage et se baigne nue en provoquant les soldats. Frost, costumé en clown blanc, doit aller, sous les éclats de rire de l’escadron, chercher son épouse et la porter comme un condamné sa croix, claudiquant sur le chemin du retour, se blessant sur les cailloux, tombant avec son fardeau sur les épaules. Cauchemar ou réalité ? Quoi qu’il en soit, la scène est emblématique du destin des nomades, gens du voyage ou du spectacle, qui s’offrent désarmés aux regards envieux des résidents. La lumière est surexposée, le contraste du noir et du blanc est accentué. Dans cette séquence presque muette, où le langage se résume à des cris et des vociférations, Bergman retrouve le regard d’un Josef von Sternberg, et le clown Frost comme le directeur Alberti, dont les déchéances sont données en spectacle, sont les enfants du professeur Unrat (c’est le sobriquet dont l’affublent ses élèves, et qui signifie déchet, ou débris) humilié sur scène par Lola-Lola, Marlène Dietrich soi-même en danseuse de cabaret (Josef von Sternberg, L’Ange bleu, 1930).
On retrouve le même thème l’année suivante, dans le beau film de Federico Fellini, La Strada (1954). Plus que jamais, la route ne trace pas la voie d’une initiation, l’itinéraire d’un roman d’apprentissage qui conduirait de l’enfance à la maturité. Elle est au contraire, et une fois encore, un chemin qui ne mène nulle part, c'est-à-dire au néant qui se trouve à la fin du voyage, mais qui précède encore le voyageur, le traquant dès qu’il s’accorde une pause et le contraignant à reprendre la route, sans savoir où il va. L’absolue noirceur du film de Bergman est ici tempérée par le sourire de l’ange, dont le bruissement d’ailes traverse presque toujours les films de Fellini. C’est ici le Fou (« il Matto »), deux ailes de carton accrochées aux omoplates, qui fait un périlleux numéro de funambule et enseigne aux foules ravies l’art de triompher de la pesanteur et du sérieux. Le cirque ne fait-il pas de la vie un jeu, un bal de têtes, une pantalonnade de grotesques ? Mais l’ange, c’est encore Gelsomina, jeune fille un peu simplette achetée pour trois sous par un Hercule de foire, le redoutable Zampano qui n’est que force brutale, se mettant en fureur contre les obstacles qu’il rencontre sur sa route. Gelsomina, sorte de Pierrot femelle, Charlot qui aurait posé sur son visage le masque androgyne d’un clown blanc débonnaire et souriant, joue magnifiquement, comme le font tous les clowns blancs, de la trompette. La sonnerie de la trompette prend, à nos oreilles, l’accent de l’invocation aux morts. Elle est un appel qui s’adresse à l’autre monde, qui communique avec l’au-delà. Pour Zampano, la trompette de Gelsomina n’est qu’un signal pour attirer l’attention des passants, le lever de rideau de son numéro de force, toujours le même (briser une chaîne par la seule force des pectoraux) seul vraiment digne à ses yeux d’être l’objet d’un spectacle. Pourtant, le chant de la trompette poursuit Zampano, bien au-delà de la disparition puis de la mort de Gelsomina, comme un chant venu de l’autre monde, et qui lui rappelle la promesse d’une autre vie. Désormais seul, il vient enfin échouer sur une plage déserte, dans la nuit des forains, et pleure en se souvenant de la mélopée de l’Innocente.
S’il est un chemin qui ne mène nulle part, c’est bien celui que tracent les longues marches au bord de la mer sur le sable des plages. La plage, ce territoire du vide, est le terrain de jeux de la société de loisirs, l’un des rares refuges où il est encore permis de ne rien faire, un asile pour les oisifs. Dans le suspens de l’action qui ouvre l’espace néoréaliste, la plage devient le terrain des errances sans but, à l’inverse du réalisme de la fin du XIXe siècle, qui prenait volontiers le travail, à l’usine ou aux champs, pour objet de son étude. C’est sur la plage que les Vitelloni (Fellini, 1953), ces jeunes désœuvrés de Rimini, la ville natale de Fellini lui-même, incapables de quitter le giron familial et d’accéder à l’indépendance, se baladent pour tuer le temps, se promenant en spectateur dans un monde qui n’est pour eux qu’un décor. Comme le note justement Deleuze, à propos du néoréalisme, « ce qui a remplacé l’action, ou la situation sensori-motrice, c’est la promenade, la balade, et l’aller-retour continuel » (15). La plage où ces jeunes veaux tournent en rond en faisant semblant de vivre est d’autant plus le royaume des disoccupati (les inactifs, les chômeurs en italien) qu’elle met en scène une fête perpétuelle pendant la saison d’été, pour mieux appâter les touristes, et qu’elle se dépeuple avec l’automne, espace nu pour de longues marches en solitaire. La plage est à la fois la fête et son envers, le lustre des paillettes et le néant en coulisses, dans cette alternance du plein et du vide en laquelle excelle l’art de Fellini, qui en fait la mécanique de la désillusion. Ainsi le terrain vague quand le chapiteau du cirque a été démonté. Les Vitelloni s’ouvre sur la dernière fête qui clôt la saison : l’élection de Miss Sirène (une créature pour laquelle Fellini à une prédilection particulière : sur la bâche qui recouvre le fourgon que conduit la moto de Zampano, une petite sirène est peinte, image peut-être allégorique de Gelsomina…). L’orage se lève et gâche la fête, dans un joyeux tohu-bohu. Commence alors la morte-saison, au cours de laquelle les Vitelloni, livrés à eux-mêmes, n’échapperont pas à l’ennui. Seul le carnaval les délivrera provisoirement de leur néant, au cours d’une soirée grotesque qui se termine dans le matin blême, Alberto, assommé par l’ivresse, titubant en rentrant chez lui pour découvrir que sa sœur, qu’il couvait d’un soin jaloux, quitte la famille et abandonne son frère à sa médiocrité. C’est sur cette même plage, lieu de toutes les capitulations et de toutes les hébétudes que Zampano, à la fin de La Strada, brutalement rappelé, par le refrain de Gelsomina, à l’entière inanité de son existence, à la nihilité de l’humaine condition, vient pleurer toutes les larmes de son corps. C’est sur cette même plage encore que, dans un film d’Antonioni de 1955, Femmes entre elles (curieuse traduction du titre original : Le Amiche ; le titre de la nouvelle de Cesare Pavese, tirée du Bel été, est encore différent : Tra donne sole, Entre femmes seules), les couples se font et se défont, en un vain ballet qui met en scène le simulacre du désir, et se leurre lui-même pour tromper son ennui (Antonioni est de Ferrare, où les Este ont construit le très beau palais de Schifanoia, le palais de Trompe-l’Ennui). Magnifique théâtre du trop peu de désir et du jeu des vanités. Enfin, c’est encore sur une plage que vient échouer la grande fresque de La Dolce Vita (1960), les fêtards de la nuit venant au petit matin contempler, hébétés, un poisson monstrueux que les pêcheurs ont hissé sur le sable. Penché sur l’œil globuleux de l’animal fabuleux, Mastroianni, toutes illusions perdues, y réfléchit, comme en un miroir de vanité, l’image de son propre néant. Fasciné par la grosse bête, Marcello ne comprend rien aux signes que lui adresse, sur l’autre rive, un ange dont le profil rappelle les Vierges de Filippo Lippi. Ayant déjà rencontré la jeune fille dans une scène précédente, Marcello avait eu l’occasion d’admirer la grâce de ce visage : « On dirait un de ces angelots des églises ombriennes. » Entre l’ange et la bête, entre la belle et le monstre, Marcello, accablé par la difficulté d’être, a pris son parti, et se détourne de la grâce pour s’abîmer dans la contemplation de la bestialité. La plage est le royaume du Néant où viennent échouer, en bout de course, toutes les âmes en peine qui ont appris de la vie la nullité de toutes choses.
Dans l’immédiate après-guerre, et jusque dans les années soixante, la mélancolie de l’anti-héros porte le poids d’un deuil. Le thème de la mort de Dieu, célébré par Nietzsche avec emphase à la fin du XIXe siècle, revient en force sur le théâtre des idées. Le nihilisme hante les esprits, détresse spirituelle qui menace nos civilisations au même titre que l’équilibre de la terreur et le péril atomique. Peut-être ne faut-il pas prendre à la lettre ce mélodrame pathétique dont la métaphysique serait l’enjeu, et nous savons que l’Orient, et plus exactement la sagesse humble et souriante du Japon, a su élaborer une éthique de l’immanence qui est aussi une autre forme, heureuse, apaisée et d’une ironie dépourvue d’agressivité, de ce que l’occident nomme le nihilisme. Le cinéma d’Ozu nous a enseigné qu’il existe aussi un nihilisme heureux. Ce que nous nommons la mort de Dieu n’est en fait que la crise profonde que traversent les Eglises chrétiennes, et tout particulièrement la plus puissante d’entre elles, le catholicisme romain. Il n’est pas impossible que les causes profondes en soient plus historiques que proprement philosophiques, et que le déclin de cette foi, dont on ne doit pas oublier qu’il a commencé au XVIe siècle, résulte du silence de l’Eglise romaine pendant la deuxième guerre mondiale, péché mortel, en ce sens qu’il voue à une mort certaine, commis par l’unique autorité morale qui régnait alors sur l’Europe en guerre. Laissons l’avenir nous dire ce qu’il faut en penser. Il reste que tout le cinéma de l’après-guerre est comme accablé par le silence de Dieu, désorienté par l’effondrement des grands mythes qui se donnaient pour guides, à la recherche d’une fondation nouvelle pour construire au-dessus des ruines. Mort du père et des repères, mort de Dieu : le cinéma néoréaliste est hanté par ces deuils. Dès 1948, dans Germania anno zero, Rossellini racontait la pitoyable et triste histoire du jeune Edmund qui, trompé par le darwinisme vaguement nazi de son ancien professeur devenu trafiquant – et cette déchéance avait déjà la valeur de la mort d’un père – errant sans but dans un Berlin en ruines, empoisonnait son père dont la maladie pesait sur la famille, la délivrant ainsi d’une bouche inutile et d’une vie nécessairement vouée la mort. Le jeune parricide, comme sidéré par le vide que lui découvre soudain la mort du père, se donnera la mort en se précipitant lui-même dans le vide, du haut d’un édifice dévasté par les bombardements. Mais la même année 1948, dans Le Voleur de bicyclettes sur lequel nous avons ouvert ce cycle de conférences sur le néoréalisme, n’assistions-nous pas également à la mise à mort de l’idole paternelle, sous les yeux de son jeune fils Bruno qui doit, soudain élevé à la dignité d’être responsable après la déchéance du volé devenu voleur, se faire le père de son père, et le prendre par la main, comme un enfant désorienté, sur le chemin du retour ? Mais c’est sans doute chez Fellini que les variations sur la mort du père sont les plus riches. Il est certain que les Vitelloni (1953) sont en premier lieu les fils de leur mère et non de leur père, et qu’Alberto, qui vit chez la mamma en l’absence du père, n’échappera jamais à l’emprise de sa mère, incapable qu’il est d’accéder à l’indépendance, tourmenté par une homosexualité inavouée, mais qui affleure quand Alberto, dont on ne connaît aucun flirt, se travestit en femme pour le carnaval et danse seul jusqu’à l’aube en étreignant le masque d’un grotesque. Il y a du clown chez Alberto, et le clown chez Fellini, comme chez le Bergman de La Nuit des forains, est ce qui reste de la figure du Christ après la mort de Dieu (16) : la passion du clown blanc Frost ne préfigurait-elle pas, dans le film de Bergman, mais en la transposant dans la dérision et la déréliction, la tragédie du Calvaire ? Pourtant, les pères dans les Vitelloni ne sont pas absolument absents : le père de Fausto n’hésite pas à corriger son fils inconsistant et veule, la trentaine passé, le frappant de sa ceinture sans que ce grand dandin ne songe à se révolter. C’est là, il est vrai, une façon un peu primitive d’affirmer l’autorité paternelle, mais il n’en existait sans doute pas d’autre dans l’Italie des années cinquante… Elle ne vaut pas grand-chose, et c’est cette autorité qui se trouve mise à mal de façon plus radicale dans le film que réalisera Fellini tout de suite après La Strada : Il Bidone (1955). Histoire d’un trio de médiocres escrocs qui vivotent en se livrant à des coups tordus. Le plus vieux d’entre eux, le plus revenu de tout aussi, se prénomme Augusto, ce qui est précisément le nom d’un clown, l’enfant maladroit qui fait rire en imitant de travers l’élégance du clown blanc, son complice féérique. Ce dilettante de l’arnaque et de la filouterie justifie à ses propres yeux ses combines douteuses en se persuadant que l’argent dérobé sera consacré aux études de sa fille Patrizia, dont la jeunesse le bouleverse et l’émerveille. C’est pourquoi la scène du père humilié, qui est aussi la mise à mort de l’Auguste, qui aura lieu dans le cinéma où il avait emmené Patrizia, sera, dans Il Bidone, d’une cruauté particulière : reconnu par l’une de ses victimes, Augusto est conduit au commissariat ; il en sortira la nuit tombée, les menottes aux poings, pour un séjour en prison qui ne l’empêchera pas de recommencer ses trafics dès le lendemain de sa libération. Patrizia, dissimulée pendant des heures derrière un arbre, assiste en pleurs à l’évacuation de son père, encadré par deux gendarmes, et disparaissant aussitôt sur la jeep qui le conduit au pénitencier. Il faut ajouter que dans ce film, la mort du père se conjugue à la mort de Dieu, sur un registre il est vrai comique plutôt que tragique. Les trois « bidonistes » ont en effet monté un coup qui ressemble à une saynète de théâtre, ou à un sketch pour l’écran – les larrons sont d’excellents acteurs, et Fellini n’est pas sans reconnaître, en cette bande de combinards, une image dérisoire de l’artiste qui sait captiver les spectateurs par la force de l’illusion. Déguisés en hommes d’Eglise, Augusto et ses comparses abusent la cupidité des pauvres paysans en échangeant leurs économies contre un prétendu trésor qui n’est qu’un gros tas de pacotilles. Cette comédie, qui travestit le prêtre en escroc, raille discrètement le véritable prêtre : si le charlatan déguisé en prêtre peut convaincre si aisément, n’est-ce pas parce que le prêtre est déjà, de lui-même, une sorte de charlatan ? Cinq ans plus tard, et après les magnifiques Nuits de Cabiria (1957), sort en 1960 le film le plus célèbre de Fellini : La Dolce Vita. On n’a peut-être pas assez souligné combien tout le film gravite autour d’une scène primitive, sur laquelle se joue la mort du père associée cette fois encore à la mort de Dieu. Le film ouvre sur le transport par hélicoptère d’un colossal Christ rédempteur, à l’image de celui du pain de sucre de Rio de Janeiro, jusqu’au Vatican où il doit être consacré. Rien de moins pieux que ce transport : Marcello, embarqué dans l’hélicoptère pour réaliser le reportage de cette sainte translation, s’arrête un moment pour draguer de jeunes romaines qui bronzent en toute liberté sur les toits de Rome… Mais la scène la plus virulente contre le fétichisme du catholicisme italien est consacrée aux deux enfants, fille et garçon, la première conduisant le second, qui prétendent avoir des visions de la Sainte Vierge. Un invraisemblable cirque médiatique s’improvise autour des deux jeunes comédiens, qui entraînent la foule avide d’un miracle vers les lieux supposés de l’apparition, et les infirmes qu’on a traînés là dans l’espérance d’une guérison miraculeuse sont abandonnés sous l’averse qui tombe soudain. Le Vatican ne s’y est pas trompé, qui a interdit à ses ouailles d’aller voir cette œuvre dépravée, et a menacé Fellini d’excommunication. Aveuglement de l’Eglise qui n’a pas su reconnaître dans l’art de Fellini la profondeur de l’inspiration chrétienne. Mais laissons la mort de Dieu, trop évidente et presque caricaturale dans La Dolce Vita, et considérons maintenant la mort du père. Si la première est traitée par la comédie, la seconde prend en revanche la forme d’une tragédie. Marcello, journaliste inconséquent qui a renoncé à toutes ses ambitions de jeunesse, lui qui avait autrefois imaginé écrire un roman, et qui se vend aujourd’hui au plus offrant, a un ami qui lui sert de modèle et d’alibi, le dénommé Steiner (Alain Cuny), un intellectuel romain qui s’exprime avec componction et organise chez lui des réunions de pédants qui se donnent des airs de profondeur. Tout, chez Steiner, est aux yeux de Marcello sérénité et méditation, gravité et richesse spirituelle. C’est ce même homme dont il apprendra l’horrible suicide : Steiner s’est donné la mort après avoir assassiné ses deux enfants, dont il parlait pourtant avec tant de paternelle tendresse lors de la soirée littéraire à laquelle il avait invité Marcello. La mort de Steiner précipite la déchéance du jeune journaliste : c’est dans la séquence qui suit immédiatement que Marcello se transforme en organisateur bouffon d’une orgie qui aura lieu dans une villa du bord de mer. Marcello devient alors le metteur en scène appointé des plaisirs de la jeunesse dorée de Rome. Cette abaissement lui fait perdre à jamais l’innocence, et c’est la raison pour laquelle il ne comprendra pas le langage des signes que lui adresse, de l’autre côté de la rivière qui se jette dans la mer, la fillette blonde au visage d’ange.
Mais il est encore, dans La Dolce Vita, une autre mort du père, plus intime, plus bouleversante aussi, que le suicide spectaculaire de Steiner. Marcello, prévenu par Paparazzo, retrouve son père de passage à Rome. C’est un père absent, qui n’était jamais à la maison, et qui faisait pleurer sa mère. Il ne connaît guère son fils et son fils ne le connaît guère. Marcello est bouleversé par cette rencontre imprévue. Il l’emmène dans une boîte de nuit que le père connaît, un cabaret maintenant passé de mode, « on se croirait dans un sépulcre » dit négligemment Paparazzo. Marcello y rencontre une jeune danseuse à laquelle il avait autrefois promis une photo dans son journal, une Française : Fanny. Le père éméché, croyant soudain retrouver sa jeunesse, commande du champagne et roucoule avec Fanny, enchantée et souriante. Il décide de partir chez la jeune danseuse, comme elle l’y invite elle-même. Marcello les rejoint sans se presser, laissant à son père le temps de s’amuser. Quand il arrive, son père vient d’avoir un malaise. Fanny, affolée, veut chercher dans la nuit une pharmacie de garde. Marcello trouve son père en chemise, affalé sur un fauteuil, devant la fenêtre ouverte. Immobile, il récupère lentement. Quand il apprend qu’il est 4 h. du matin, le père de Marcello appelle un taxi et veut prendre le train de 5 h 30. Marcello le supplie de rester une journée à Rome, pour parler enfin avec lui, et faire la connaissance de cet inconnu primordial. Mais le père, fatigué, veut rentrer chez lui, retrouver ses habitudes, cette vie monotone dont il se plaignait en présence de Fanny, au cabaret du Cha Cha Cha… Le père et le fils s’embrassent. Marcello ferme la porte du taxi, le père disparaît, et l’on se doute que c’est pour longtemps. L’acteur qui joue le père de Marcello est Annibale Ninchi, célèbre dans l’histoire du cinéma italien pour avoir incarné Scipion l’Africain dans un film de propagande fasciste sorti en 1937 et tourné par Carmine Gallone. Jeune, Annibale était un héros romain, qui sauvait la patrie en réduisant la résistance de Carthage ; vieux, il n’est plus qu’un homme fatigué, déchu, ayant perdu l’autorité magnifique qui lui fut un moment accordée. Marcello, profondément ému, assiste à cette déchéance, et ne se résigne pas à voir partir cet homme dont il aurait voulu faire un ami, et qui restera à jamais pour son fils un étranger.
Mort de Dieu, mort du père… On ne saurait conclure cette évocation de la crise des modèles qui tourmente secrètement le cinéma des années cinquante et soixante sans évoquer le monument cent fois analysé dans tous les ciné-clubs de l’époque, le chef d’œuvre métaphysique tourné par Ingmar Bergman en 1956 et sorti sur les écrans en 57 : Le Septième Sceau. Ce road movie médiéval rapporte les mésaventures d’un chevalier de retour de la Croisade – on ne sait laquelle : la dernière Croisade, celle de saint Louis, a lieu dans le troisième quart du XIIIe siècle, en un temps qui précède presque d’un siècle la grande épidémie de peste de 1348, qui pourtant sévit dans le pays du chevalier. Peu importe : Antonius Block n’est qu’en apparence un homme du moyen âge, il est en vérité notre contemporain, hanté par le silence de Dieu, ce Dieu qui ne s’est pas révélé à ses yeux lors de sa visite au Saint Sépulcre. De retour dans ses terres, le chevalier orphelin de sa foi traverse une contrée dévastée par la peste. Non celle du XIVe siècle, mais cette autre peste des temps modernes, l’angoisse distillée par l’équilibre fragile de la terreur, la guerre atomique qui hante les cauchemars de l’Europe d’après guerre. Ce film, auquel on accordait une profondeur philosophique souvent exagérée, est un conte plutôt simple – ce qui n'ôte rien, bien au contraire, à sa grande beauté – sur l’absence du divin et la solitude des hommes devant leur mort. Il est la fable noire d’un désespoir religieux, le volet opposé de l’autre volet, lumineux, du diptyque : La Source qui sortira trois ans plus tard, en 1960. Dans La Source, Dieu se manifeste par un miracle, et le scandale de la mort est racheté par l’eau vive qui jaillit sous le cadavre. Image artistique de la création dont le mystère de la mort est la source inépuisable ? Mais dans Le Septième Sceau, aucune consolation ne vient au secours du Croisé sans foi, condamné à mener seul sa partie d’échecs contre la Mort. Rien de plus simple, de plus dépouillé que cette fable : le silence de Dieu est insurmontable, le chevalier veut savoir le mot de la fin, mais il n’y a rien à savoir, la connaissance ne conduit à aucune rédemption, et la Mort elle-même, obscur fonctionnaire étroitement limité à sa tâche funèbre, ne sait pas pour qui elle travaille, ni quelle est la fin suprême de l’extermination des vivants. La sorcière, qu’on dit possédée du Diable, n’est qu’une pauvre fille qu’on martyrise ; le chevalier lui donne, par pitié, un poison qui lui épargnera les souffrances du bûcher. Bergman disait s’être inspiré des fresques du moyen âge, telles qu’il pouvait les contempler dans l’église où son père, pasteur, prêchait ses ouailles. Le moyen âge du Septième Sceau est une image d’Epinal, il en a le charme et la simplicité (17). A l’image de ce chevalier errant, les hommes passent sur la terre et leur voyage n’a pas de but bien déterminé. Chaque personnage définit une attitude possible devant l’énigme de la mort fatale : le serviteur, cynique et effronté, nargue la Mort et « proteste » quand elle vient prendre ses proies. Il est l’athée et le sceptique qui garde sa dignité devant l’absurdité de l’existence humainement vécue, à l’image de l’homme révolté, le héros de Camus. Le chevalier, désabusé, se résigne au non-sens et semble reconnaître le néant de toutes choses. Seul le couple des baladins, Jof et Mia (Joseph et Maria ?), et leur jeune fils, seront sauvés : ils devront leur salut au chevalier, ému par leur innocence, et qui veut les remercier pour un moment de grâce, une scène merveilleuse, la plus lumineuse de ce film sombre, un repas pris ensemble et, offertes par Mia à Antonius, des fraises sauvages dont la saveur avait sans doute pour Bergman le goût de la grâce (Les Fraises sauvages sortent en 1957, la même année que Le Septième Sceau : ce fut une grande époque pour la création cinématographique !). Le chevalier détourne l’attention de la Mort en faisant tomber les pièces sur l’échiquier, ce que la Mort croit être une ruse candide pour se sortir de l’impasse. Il s’agit en réalité de donner l’occasion au couple insouciant des jongleurs de filer en douce. Ainsi, seuls les innocents, qui prennent la vie comme un jeu et vivent dans la joie d’un présent toujours renouvelé, échappent à l’absurde qui accable les mortels. A la fin du film, Jof qui reçoit de l’au-delà des visions, aperçoit la sarabande de la Mort sur la ligne de crête de la montagne, à l’horizon, à l’image des danses macabres qui faisaient frise dans les charniers du XVe siècle : la Mort vient en tête, avec sa large faux et son sablier, et les autres suivent en se tenant par la main, le chevalier Antonius Block, Karin, son épouse fidèle qui l’attendait depuis son départ pour la Croisade, Plog le forgeron et Lisa, son épouse frivole, l’écuyer Jöns et la jeune inconnue qu’il a sauvée du viol et de l’assassinat, et à laquelle revient le mot de la fin : « Tout est consommé », qui sont aussi les derniers mots de Jésus mourant sur la croix (Jean, 19, 20). Le titre du film est emprunté à l’Apocalypse, tiré d’un verset qui est lu solennellement par l’épouse du chevalier, alors que tous sont réunis dans le sombre château du maître dans l’attente de la Mort. Lorsque vient la fin des temps, est-il écrit, Dieu remet à l’Agneau le livre sept fois scellé des destinées du monde. Lorsque le dernier sceau sera descellé, les temps seront achevés, l’apocalypse – qui signifie la révélation – aura lieu, et la faim de connaissance qui anime le chevalier tout au long de son voyage sera enfin désaltérée. Tout le film se déploie en cette attente, il ne renonce nullement à la foi, il est au contraire à l’affût de sa confirmation. Mais dans ce suspens qui précède le mot de la fin, Dieu nous précipite dans un profond silence, qui laisse à chacun le risque du pari, l’espérance du salut et la crainte de la damnation, qui est le triomphe du néant : « Lorsque l’Agneau ouvrit le septième sceau, il se fit un grand silence dans le ciel, environ d’une demi-heure » (Ap., 8, 1). Il semble que Bergman veuille nous signifier que toute l’humanité est à jamais condamnée à vivre pendant cet intervalle temporel circonscrit par deux éternités.
NOTES
1- Emile Zola, Le roman expérimental, édition établie par François-Marie Mourad, GF Flammarion, 2006, p. 52.
2- Il faut lire à ce sujet l’essai riche et toujours remarquable de Jean Borie, Zola et les mythes ou de la nausée au salut, Seuil, 1971.
3- « Comme il lui arrive toujours quand il y a un malaise, l’homme réagit. Mais il réagit mal et il en est malheureux. Dans L’Avventura la catastrophe est une impulsion érotique de ce genre : bon marché, inutile, malheureuse […] Car le héros (quel mot ridicule !) de mon film se rend parfaitement compte de la nature grossière de l’impulsion érotique qui s’empare de lui, de son inutilité » (Pierre Leprohon, Michelangelo Antonioni, présentation et choix de textes, « Cinéma d’aujourd’hui », Seghers, 1969, p. 134-135).
4- Jean-Louis Chrétien, « La réserve de l’Etre », in Heidegger, Cahier de l’Herne, Livre de Poche, p. 233 sq.
5- Gille Deleuze, Cinéma 2. L’Image-temps, Minuit, 1985, p. 8-9.
6- Flaubert, Un cœur simple, dans Trois contes : « A l’église, elle contemplait toujours le Saint-Esprit, et observa qu’il avait quelque chose du perroquet. Sa ressemblance lui parut encore plus manifeste sur une image d’Epinal, représentant le baptême de Notre-Seigneur […] Quand elle exhala son dernier souffle, elle crut voir, dans les cieux entrouverts, un perroquet gigantesque, planant au-dessus de sa tête. » ( Œuvres complètes, Seuil, « L’Intégrale », 1964, tome II p. 176-177).
7- C’est ainsi qu’Emma, traquée par les créanciers, rappelée au réel par « les dures exigences du paiement au comptant », succombe un instant à l’hypnose des choses : « Couchée sur le dos, immobile et les yeux fixes, elle discernait vaguement les objets, bien qu'elle y appliquât son attention avec une persistance idiote. Elle contemplait les écaillures de la muraille, deux tisons fumant bout à bout, et une longue araignée qui marchait au-dessus de sa tête, dans la fente de la poutrelle » (Flaubert, Madame Bovary, dans Œuvres complètes, Seuil, « L’Intégrale », 1964, tome I p. 678)
8- Lettre de Rossellini à Ingrid Bergman, 1948 : « Some time ago...I think it was at the end of February last, I was traveling by car along the Sabine (a region north of Rome). Near the source of the Farfa an unusual scene called my attention. In a field surrounded by a tall barbed-wire fence, several women were turning round just like mild lambs in a pasture. I drew near and understood they were foreign women: Yugoslavs, Polish, Rumanians, Greek, Germans, Latvians, Lithuanians, Hungarians. Driven away from their native countries by the war, they had wandered over half Europe, known the horror of concentration camps, compulsory work and night plunder [pillage]. They had been the easy prey of the soldiers of twenty different nations. Now parked up by the police, they lived in this camp awaiting their return home. A guard ordered me to go away. One must not speak to these undesirable women. At the further end of the field, behind the barbed wires, far away from the others, a woman was looking at me, alone, fair, all dressed in black. Heeding not the calls of the guards, I drew nearer. She only knew a few words of Italian and as she pronounced them, the very effort gave a rosy tint to her cheeks. She was from Latvia [Latvia est le nom letton de la Lettonie]. In her clear eyes, one could read a mute intense despair. I put my hand through the barbed wires and she seized my arm, just like a shipwrecked person would clutch at a floating board. The guard drew near, quite menacing. I got back to my car. The remembrance of this woman haunted me. I succeeded in obtaining authorization to visit the camp. She was no longer there. The Commander told me she had run away. The other women told me she had gone away with a soldier. They could have married and, with him, she could have remained in Italy. He was from the Lipari Islands. »
9- Gilles Deleuze, Cinéma. L’image-mouvement, Minuit, 1983, p. 120.
10- Roberto Rossellini : « Il est exact que chacun des films que je réalise m’intéresse pour une scène déterminée, pour le final, bien sûr, que j’ai déjà dans l’esprit. Dans chaque film, je considère, d’une part, la scène descriptive, comme peut l’être la première partie d’Allemagne année zéro ou la salle de l’hôpital d’Europe 51, et, d’autre part, le fait. Toute ma préoccupation est d’arriver à ce fait […] Et Allemagne année zéro, pour être sincère, a été vraiment fait pour la séquence de l’enfant qui erre seul parmi les ruines. Tout ce qui précède ne m’intéressait pas le moins du monde. » (« Colloquio sul neorealismo », entretien de Roberto Rossellini avec Mario Verdone, Bianco e Nero, N° 2, février 1952, p. 16 ; cité dans Le cinéma, l’art d’une civilisation, 1920-1960, textes choisis et présentés par Daniel Banda et José Moure, « Champs Art », Flammarion, 2011, p. 356).
11- L’Eclipse sort sur les écrans en 1962 ; le débarquement, soutenu et financé par la CIA, des exilés cubains dans la Baie des Cochons a lieu le 17 avril 1961.
12- Entretien dans Les Lettres Françaises du 26 mai 1960, pour la sortie de l’Eclipse : « Que croyez-vous qu’il soit, cet érotisme qui a envahi la littérature et le spectacle ? C’est un symptôme, le plus facile à saisir peut-être, de la maladie dont souffrent les sentiments. Nous ne serions pas érotiques, c'est-à-dire malades d’Eros, si Eros était en bonne santé. Et, en disant en bonne santé, je veux dire juste adéquat à la mesure et à la condition de l’homme » (Pierre Leprohon, Michelangelo Antonioni, présentation et choix de textes, « Cinéma d’aujourd’hui », Seghers, 1969, p. 134).
13- L’île merveilleuse du conte fait à l’enfant évoque, il est vrai, une nature vierge, une mer transparente, et semble offrir à l’homme un lieu où il fait bon vivre. Pourtant le voilier fantôme qui s’approche du rivage, puis s’en éloigne quand l’enfant veut le rejoindre, ce voilier qui évoque celui du Hollandais volant dans Pandora d’Albert Lewin (1955), introduit dans le paradis de l’enfance une menace indéterminée et comme un pressentiment de la mort. La toute jeune fille nage dans une mer cristalline, entre les rochers aux formes organiques, comme l’embryon baigne dans le liquide amniotique. Le bonheur n’est pas dans ce monde, auquel nous livre la naissance, mais dans le ventre maternel, qui nous épargne la peine de vivre.
14- Macbeth, acte V, scène 5 : « I begin to doubt the equivocation of the fiend, that lies like truth. »
15- Gilles Deleuze, Cinéma. L’image-mouvement, Minuit, 1983, p. 280.
16- On sait comment le peintre catholique Georges Rouault a su donner au visage grimé de l’Auguste toute la puissance symbolique jusque là attribuée à la Sainte Face (1871-1958).
17- « J’ai eu l’idée de tourner Le Septième Sceau en contemplant les motifs traités dans les peintures médiévales : les jongleurs errants, la peste, les flagellants, la Mort qui joue aux échecs, les bûchers de sorcières et les Croisades. Le film ne prétend pas donner une image réaliste de la vie en Suède au moyen âge. C’est un essai de poésie moderne, traduisant les expériences de la vie d’un homme moderne, mais formé de façon très libre avec des matières médiévales. Dans mon film, le chevalier revient d’une croisade comme, de nos jours, un soldat revient de la guerre. Au moyen âge, les hommes vivaient dans la terreur de la peste. Aujourd’hui ils vivent dans la terreur de la bombe atomique. Le Septième Sceau est une allégorie dont le thème est fort simple : l’homme, sa recherche éternelle de Dieu, avec la Mort comme seule certitude. Pour un petit garçon comme moi, le prêche était une affaire pour grandes personnes. Pendant que, de la chaire, Père parlait, et que l’assemblée des fidèles priait, chantait ou écoutait, je concentrais mon attention sur le monde secret de l’église, fait de voûtes basses, de murs épais, de parfum d’éternité, de lumière solaire colorée qui tremblait, sur l’étrange végétation des peintures moyenâgeuses et des figures sculptées sur le plafond et sur les murs. » (Jacques Siclier, Ingmar Bergman, « Classiques du cinéma », Editions Universitaires, 1966, p. 81).
Pour lire la suite, cliquer ICI
|
|